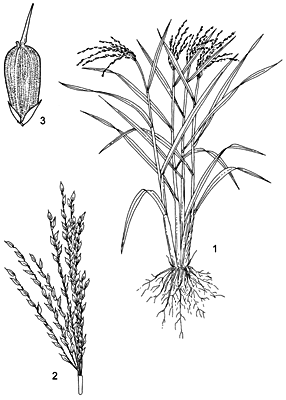Oryza glaberrima (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Céréale / légume sec | |
| Médicinal | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
Oryza glaberrima Steud.
- Protologue: Syn. pl. glumac. 1(1) : 3 (1853).
- Famille: Poaceae (Gramineae)
- Nombre de chromosomes: 2n = 24
Noms vernaculaires
- Riz africain, riz de Casamance (Fr).
- African rice, red rice (En).
Origine et répartition géographique
Oryza glaberrima est dérivé de l’espèce annuelle sauvage Oryza barthii A.Chev. (synonyme : Oryza breviligulata A.Chev. & Roehr.). Oryza barthii poussait probablement abondamment dans les lacs qui existaient vers 8000–4000 avant J.-C. dans la région qui est maintenant le Sahara, et il était récolté comme céréale sauvage. Lorsque le climat est devenu plus sec, Oryza glaberrima, qui a évolué progressivement à partir d’Oryza barthii (probablement vers 1500 avant J.-C. ou plus tard), a été cultivé comme culture pluviale dans les jardins de case des oasis. Lorsque la population s’est réfugiée dans le delta intérieur du fleuve Niger (vers 1500 avant J.-C.) et a fortement augmenté, Oryza glaberrima s’est transformé pour devenir le riz flottant qui est actuellement cultivé.
Le riz africain est aujourd’hui cultivé dans une zone qui s’étend depuis le delta du fleuve Sénégal jusqu’au lac Tchad. Son aire de répartition est limitée au sud-est par les bassins de la Bénoué, du Logone et du Chari, mais on l’a aussi observé sur les îles de Pemba et Zanzibar (Tanzanie). Les régions où le riz africain est cultivé le plus intensément sont les plaines inondables du nord du Nigeria, le delta intérieur du Niger au Mali, certaines régions de Sierra Leone, et les collines situées à la frontière entre le Ghana et le Togo. C’est probablement à l’époque de la traite des esclaves que le riz africain a été introduit dans le Nouveau Monde, où il reste parfois cultivé, par ex. au Brésil, au Guyana, en El Salvador et au Panama.
Usages
Dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, le grain du riz africain est un aliment de base, très apprécié pour son goût et ses qualités culinaires. On l’utilise aussi dans les cérémonies traditionnelles et rituelles, par ex. dans la région de Casamance au sud du Sénégal. Les plus fines parties du son et des brisures sont données en nourriture aux volailles et autre bétail. En Centrafrique, la racine est consommée crue pour soigner la diarrhée.
Production et commerce international
Les statistiques sur la production de riz en Afrique de l’Ouest ne font pas de distinction entre le riz africain et le riz asiatique (Oryza sativa L.). On estime que le riz africain représente moins de 20% de la superficie totale de riz en Afrique de l’Ouest. Comme ce riz est une céréale alimentaire traditionnelle, il n’est pas commercialisé à l’échelle internationale, mais seulement dans la région de production.
Propriétés
La composition du grain entier de riz africain (décortiqué) par 100 g de partie comestible est de : eau 11,3 g, énergie 1524 kJ (364 kcal), protéines 7,4 g, lipides 2,2 g, glucides 77,7 g, fibres 0,4 g, Ca 38 mg, P 294 mg, Fe 2,8 mg, thiamine 0,34 mg et niacine 6,5 mg. Le riz africain blanchi contient par 100 g de partie comestible : eau 11,4 g, énergie 1532 kJ (366 kcal), protéines 6,3 g, lipides 0,3 g, glucides 81,6 g, fibres 0,2 g, Ca 22 mg, P 98 mg, Fe 1,7 mg, thiamine 0,06 mg, niacine 2,0 mg et tryptophane 110 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Le riz africain est supérieur au riz asiatique pour sa teneur en thiamine, qui est une vitamine importante, et en fer. Le degré de gélatinisation dépend de la teneur en amylose, qui varie dans une fourchette de 14–30%, et influe sur la consistance du riz lors de la cuisson et donc sur le choix du consommateur. La plupart des cultivars de riz africain ont un grain rouge et certains sont fortement parfumés.
Falsifications et succédanés
Dans la plupart des régions de l’Afrique de l’Ouest, au moins en agriculture commerciale, le riz africain a été remplacé par le riz asiatique, qui est plus productif, s’égrène moins facilement et a un grain plus mou et plus facile à blanchir. Les petits paysans en Afrique de l’Ouest préfèrent toutefois souvent cultiver le riz africain pour son goût et ses qualités culinaires, sa tolérance à l’inondation et sa résistance à plusieurs maladies et ravageurs.
Description
- Graminée annuelle jusqu’à 120 cm de haut (jusqu’à 5 m pour certains types flottants), souvent en touffe ; les types pluviaux avec chaume simple formant souvent des racines sur les nœuds inférieurs, les types flottants souvent ramifiés et formant également des racines sur les nœuds supérieurs.
- Feuilles alternes, simples ; gaine cylindrique, jusqu’à 25 cm de long, avec des nervilles transversales ; ligule d’environ 4 mm de long, tronquée, membraneuse ; limbe linéaire, plat, de 20–25(–30) cm × 6–9 mm, sagitté à la base, rugueux en dessous.
- Inflorescence : panicule terminale, ellipsoïde, raide et compacte, jusqu’à 25 cm de long, avec des branches racémeuses ascendantes.
- Epillets ellipsoïdes, d’environ 9 mm × 4 mm, plus ou moins persistants, comportant 3 fleurs mais les 2 fleurs inférieures réduites à des lemmes stériles séparées de la lemme de la fleur supérieure fertile bisexuée par un stipe ; glumes absentes ou fortement rudimentaires ; lemme hispiduleuse, 5-nervée, généralement sans arête apicale ; paléole 3-nervée ; lodicules 2 ; anthères 6 ; ovaire supère, avec 2 stigmates plumeux.
- Fruit : caryopse (grain) comprimé latéralement, jusqu’à 9 mm × 3 mm, souvent rougeâtre, bien enveloppé par la lemme et la paléole.
Autres données botaniques
Le genre Oryza comprend environ 20 espèces sauvages réparties dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et 2 espèces cultivées, Oryza sativa et Oryza glaberrima. Plusieurs classifications d’Oryza ont été réalisées. Le genre a récemment été divisé en 3 sections : sect. Padia, sect. Brachyantha et sect. Oryza. La section Oryza est subdivisée en 3 séries : ser. Latifoliae, ser. Australiensis et ser. Sativae. Oryza glaberrima, son ancêtre direct Oryza barthii A.Chev. et l’espèce rhizomateuse vivace Oryza longistaminata A.Chev. & Roehr. sont classés dans la ser. Sativae, avec Oryza sativa. Sur le plan morphologique, Oryza glaberrima se distingue d’Oryza sativa par sa ligule plus courte et sa panicule moins ramifiée.
Croissance et développement
Les plantules du riz africain lèvent généralement en 4–5 jours après le semis. La phase végétative de la plante est composée d’une phase juvénile d’environ 3 semaines suivie par une phase de tallage de 3–4 semaines. La croissance végétative est rapide. Le tallage, un indice de surface foliaire élevé et une surface foliaire spécifique élevée contribuent à sa compétitivité contre les mauvaises herbes. Toutefois, les chaumes ont tendance à être faibles et fragiles, rendant le riz africain sensible à la verse. Le riz africain est autogame. Le cycle de culture varie de 3–6 mois selon le cultivar et le type de culture. Certains cultivars sélectionnés pour les conditions pluviales ont des cycles de culture très courts, plus courts que les cultivars d’Oryza sativa. Les cultivars adaptés aux eaux profondes tolèrent une immersion jusqu’à 2,5 m de profondeur et leurs chaumes peuvent atteindre 5 m de long. Beaucoup de cultivars présentent un certain égrenage.
Ecologie
Le riz africain pousse bien au-dessus de 30ºC, mais au-dessus de 35ºC, la fertilité des épillets diminue considérablement. Les températures inférieures à 25ºC réduisent la croissance et le rendement ; les températures inférieures à 20ºC font de même, mais de manière plus importante. On cultive le riz africain depuis le niveau de la mer jusqu’à 1700 m d’altitude. Il est généralement une plante de jours courts, mais la photosensibilité varie selon les cultivars, depuis des plantes non sensibles jusqu’à des plantes très sensibles. Le riz africain est cultivé sur une large gamme de sols. Bien qu’il préfère des sols alluviaux fertiles, il tolère des sols peu fertiles. Certains cultivars peuvent donner des rendements plus élevés que le riz asiatique sur des sols alcalins et déficitaires en phosphore. Ils sont aussi souvent plus tolérants à la toxicité ferrique. Le riz flottant est planté sur des sols limoneux ou argileux.
Multiplication et plantation
Le riz africain se multiplie par graines. Le poids de 1000 graines est de 20–27 g. La dormance des graines disparaît quelques mois après la maturité ; à des fins expérimentales, on peut lever la dormance en retirant la lemme et la paléole et environ un tiers de l’albumen, permettant la germination en 2–3 jours. Avant le semis, le sol peut être préparé à la houe ou, comme au Sénégal, en Gambie et en Guinée, avec une bêche à longue manche, mais on pratique rarement un travail du sol. Le semis est généralement réalisé à la volée et le repiquage est rare. Pour le riz flottant, la densité de semis est élevée sur un sol fraîchement désherbé et ayant été ou non labouré ou ameubli à la houe. Les cultivars sont choisis en fonction de la durée d’inondation prévue et ont en général une durée de croissance de 4–6 mois.
En Afrique de l’Ouest, depuis le Sénégal jusqu’au nord du Cameroun, où les précipitations excèdent généralement 1000 mm/an, le riz africain est principalement cultivé comme culture pluviale, qui dépend uniquement de la pluie et des eaux de ruissellement. Dans certaines régions, on emploie des cultivars à cycle court qui sont adaptés à des précipitations annuelles d’à peine 700 mm. En Sénégambie, on le sème sur des endroits humides, souvent sous des palmiers, après un simple travail du sol. On l’appelle localement “riz de plateau”. Le “riz de montagne” est cultivé dans toute la zone forestière couvrant l’ouest de la Côte d’Ivoire, le Liberia, le Fouta Djallon et les montagnes de l’est de la Guinée. Il est cultivé en culture itinérante, souvent après une exploitation forestière, et même sur des pentes escarpées. La végétation de sous-étage est coupée et les champs sont brûlés à la fin de la saison sèche. Le semis est le plus souvent pratiqué sans aucun travail du sol. Le riz est cultivé seul ou en association avec d’autres cultures, par ex. le maïs. Après 2–3 ans, le champ est utilisé pour des cultures de rente comme le cacao ou le café, ou laissé en jachère. Les paysans y retournent après 10–20 ans ou plus, selon le degré de reconstitution de la végétation et du sol. Dans de tels champs, des cultivars à cycle très court sont semés et le riz africain n’est que rarement remplacé par le riz asiatique, par ex. dans la zone forestière de Guinée et de l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Les systèmes de riz irrigué dépendent plus de l’eau des rivières que des précipitations et on les trouve dans des régions avec un climat beaucoup plus sec ; le degré de contrôle de l’irrigation est variable. On rencontre le riz de décrue sur des sols hydromorphes en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Nigeria. Les cultivars flottants sont très courants dans le delta intérieur du fleuve Niger au Mali, et sont aussi cultivés au Sénégal, en Gambie, au Niger et au Nigeria. Il pousse parfois très rapidement en longueur lorsque le niveau de l’eau monte, tolérant une submersion de plusieurs jours. Les cultivars utilisés ont un cycle de 4–5 mois.
Le long des rivières au nord du Sénégal et au Mali, dans la partie nord du delta intérieur du fleuve Niger au sud-ouest de Tombouctou, dans une zone allant de Diré et Goundam jusqu’à la série de lacs Faguibine, Gouber et Kamango, le riz est cultivé dans des plaines inondables après la décrue. Dans ce système de culture, le riz est semé sur un sol humide et le développement de la culture dépend de l’eau du sol (“riz de décrue”). Les mauvaises herbes sont peu nombreuses. On y cultive aussi bien Oryza glaberrima qu’ Oryza sativa, avec un cycle de 4–5 mois. Le long de la côte atlantique, par ex. en Sierra Leone, le riz africain est cultivé dans des mangroves.
Gestion
Le désherbage du riz africain dans les aires non inondées se fait manuellement et souvent tardivement. Dans certaines régions, comme la Basse Casamance, la lutte contre les mauvaises herbes est combinée avec la préparation du sol : une première irrigation légère favorise la germination des mauvaises herbes qui peuvent ensuite être éradiquées. La mécanisation et l’application d’engrais sont rarement pratiquées. Pour les cultures de riz de décrue et de riz irrigué, on ne pratique ni la rotation ni la jachère, contrairement à ce qui se fait pour le riz pluvial.
Maladies et ravageurs
La maladie la plus importante et la plus répandue du riz africain est la piriculariose (Pyricularia grisea ; synonymes : Magnaporthe grisea, Pyricularia oryzae). Le virus de la marbrure jaune du riz (RYMV) et des parasites du sol (nématodes) causent souvent des pertes importantes. Il existe peu de mesures de lutte, mais certains cultivars sont résistants à de tels pathogènes. En culture irriguée ou inondée, le problème principal vient des poissons rhizophages (Distichodus, Tilapia), alors que les oiseaux causent de gros dégâts à toutes les cultures de riz. Les enfants armés de cailloux et de frondes protègent un peu les cultures. Les rongeurs, les buffles, les éléphants et les hippopotames peuvent également causer des dommages importants. La cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora), les grillons et les sauterelles sont aussi des ravageurs importants, tout comme les foreurs de tiges qui détruisent l’apex des plantes et empêchent ainsi la formation des inflorescences.
Le riz sauvage annuel (Oryza barthii) est très commun dans les champs de riz irrigué. On peut le reconnaître à ses arêtes rouges, mais il est alors trop tard pour l’enlever. Il est caractérisé par un très fort égrenage, et comme il mûrit souvent avant le riz cultivé, il se multiplie et se disperse dans tout le champ. Il est parfois récolté avec le riz cultivé. Si les graines ne sont pas triées correctement, le riz sauvage infeste le champ en quelques années. Le riz sauvage annuel se croise aisément avec Oryza glaberrima ; les grains rouges qui en résultent s’égrènent plus facilement et doivent être davantage blanchis, ce qui entraine une perte de poids et des coûts plus élevés. En condition d’inondation profonde, le riz sauvage vivace (Oryza longistaminata) est coupé sous la surface de l’eau afin de l’asphyxier.
Récolte
La période de récolte du riz africain s’étale d’octobre à décembre. Le riz pluvial est récolté en premier. Les panicules sont mises en bouquets et empilées dans des greniers surélevés en dessous desquels on entretient un feu dont la fumée éloigne les insectes. Après un battage manuel ou mécanique, le grain peut être stocké en vrac dans des sacs. Le riz flottant est récolté en plusieurs fois, le plus souvent en pirogue, ce qui provoque des pertes considérables.
Rendement
Le rendement du riz africain obtenu en conditions traditionnelles atteint rarement plus de 1 t/ha. Des essais avec des cultivars d’eau profonde menés à Gao et à Tombouctou (Mali) en 1984–1987 ont donné des rendements de 1–4 t/ha.
Traitement après récolte
Le produit du riz africain, qu’il soit stocké avant ou après battage, doit être protégé contre les ravageurs, principalement les insectes et les rongeurs. Le riz doit être séché correctement jusqu’à une teneur en eau de 14% maximum pour obtenir un bon stockage et un haut rendement au décorticage. Le grain du riz africain est plus cassant que celui d’Oryza sativa, le rendant plus difficile à décortiquer.
Ressources génétiques
L’IRD (Institut de recherche pour le développement, l’ancien ORSTOM) et le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ont collecté des riz cultivés et des espèces sauvages apparentées (africains et introduits) dans l’ensemble de leur aire de répartition. Entre 1974 et 1983, plus de 3700 échantillons ont été collectés en Afrique et à Madagascar, parmi lesquels 20% sont Oryza glaberrima et 12% des espèces sauvages apparentées. Ces collections sont gardées au froid (4°C, 20% d’humidité) pour une conservation à moyen terme et en partie congelées à –20ºC pour une conservation à long terme à l’IRD de Montpellier (France). La collection est dupliquée au CIRAD en France et à l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines. L’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) d’Ibadan (Nigeria) maintient près de 2800 entrées, et le Centre du riz pour l’Afrique (ADRAO) de Bouaké (Côte d’Ivoire) près de 1900 entrées. Des collections de ressources génétiques d’Oryza glaberrima sont aussi présentes au Bangladesh Rice Research Institute de Dhaka au Bangladesh (200 entrées) et à l’USDA-ARS National Small Grain Collection d’Aberdeen, Idaho, aux Etats-Unis (174 entrées). En stockage, les graines du riz africain se comportent de façon orthodoxe. Actuellement, il n’y a pas de programme de conservation in situ du riz d’origine africaine, mais cela serait souhaitable.
Sélection
Alors que la variabilité génétique d’Oryza glaberrima est faible comparativement à celle d’Oryza sativa, des formes avec des caractéristiques importantes ont été identifiées : la résistance au RYMV, à la piriculariose (Pyricularia grisea), à la chrysomèle épineuse (Trichispa sericea), à la cécidomyie africaine (Orseolia oryziphora) et à plusieurs foreurs de tiges et aux nématodes, dont Heterodera sacchari, Meloidogyne graminicola et Meloidogyne incognita. Le riz africain montre une résistance à la salinité, à la sécheresse et à la toxicité ferrique et il concurrence bien les mauvaises herbes. Certains cultivars ont montré une résistance partielle ou une tolérance vis-à-vis des plantes parasites du genre Striga. En général, les hybrides entre Oryza glaberrima et Oryza sativa sont hautement stériles en F1 et dans les premières générations. Cependant, dans un programme d’hybridation débuté en 1992, l’ADRAO a réussi à croiser les deux espèces et à obtenir des descendants stables et fertiles par croisement en retour et sélection d’haploïdes doublées. Les descendants interspécifiques, appelés “New Rice for Africa” (NERICA), sont maintenant cultivés par les paysans en Afrique. Ils sont plus productifs qu’ Oryza glaberrima, mais ont retenu ses caractéristiques favorables comme la compétitivité contre les adventices, la résistance aux maladies et ravageurs, la tolérance aux sols pauvres, et la bonne qualité du grain. Peu de programmes ont été entrepris pour améliorer l’espèce Oryza glaberrima en tant que telle.
D’importantes cartes de liaisons génétiques ont été réalisées pour le riz, et l’IRD et l’ADRAO travaillent ensemble dans un programme pour intégrer systématiquement le génome d’Oryza glaberrima dans celui d’Oryza sativa. L’objectif est de suivre l’introgression de petits fragments de génome d’Oryza glaberrima dans la base génétique d’Oryza sativa en utilisant les marqueurs moléculaires.
Perspectives
Depuis environ 30 ans, on a prédit que le riz africain allait disparaître sous la pression des introductions massives de cultivars améliorés d’Oryza sativa. Ceci n’a pas eu lieu, bien qu’on ait effectivement observé, par ex. au Burkina Faso, une forte régression du riz africain. Le maintien du riz africain s’explique par le fait qu’il est fortement apprécié par les peuples de l’Afrique de l’Ouest qui continuent à le cultiver pour son goût et ses propriétés culinaires, et qu’il est bien adapté à des conditions de croissance très particulières, par ex. comme riz flottant.
Les croisements entre Oryza glaberrima et Oryza sativa doivent continuer à inclure des programmes essayant de transférer des fragments de génome. De tels programmes d’amélioration doivent être menés en association avec un programme de conservation des ressources génétiques in situ du riz sauvage et cultivé d’origine africaine. Pour des objectifs spécifiques, certaines régions doivent être identifiées, par ex. la Guinée pour sa diversité de systèmes de riziculture, les régions du sud du Tchad/nord du Cameroun et le delta intérieur du fleuve Niger au Mali pour les contacts entre formes cultivées et sauvages, et la vallée du Ferlo au Sénégal pour l’étude des populations spontanées de l’espèce annuelle Oryza barthii loin de toute culture de riz. L’amélioration de la riziculture africaine devrait viser à élever les rendements et à diminuer la verse, l’égrenage et la fragilité du grain.
Références principales
- Bezançon, G., 1994. Le riz cultivé d’origine africaine Oryza glaberrima Steud. et les formes sauvages et adventices apparentées: diversité, relations génétiques et domestication. ORSTOM, Paris, France (Travaux et Documents Microédités No 115). 232 pp.
- Brenière, J., 1983. The principal insect pests of rice in West Tropical Africa and their control. West African Rice Development Association, Monrovia, Liberia. 87 pp.
- Jones, M., Heinrichs, E., Johnson, D. & Riches, C., 1994. Characterization and utilization of Oryza glaberrima in the upland rice breeding programme. In: WARDA, Annual report 1993. Bouaké, Côte d’Ivoire. pp. 3–13.
- Jones, M.P., Dingkuhn, M., Aluko, G.K. & Semon, M., 1997. Interspecific Oryza sativa L. × O. glaberrima Steud. progenies in upland rice improvement. Euphytica 94(2): 237–246.
- Linares, O.F., 2002. African rice (Oryza glaberrima): History and future potential. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99(25): 16360–16365.
- Lorieux, M., Ndjiondjop, M.N. & Ghesquière, A., 2000. A first interspecific Oryza sativa × Oryza glaberrima microsatellite-based genetic linkage map. Theoretical and Applied Genetics 100: 593–601.
- Lu, B.R., 1999. Taxonomy of the genus Oryza (Poaceae): historical perspective and current status. International Rice Research Notes 24: 4–8.
- National Research Council, 1996. Lost crops of Africa. Volume 1: grains. National Academy Press, Washington D.C., United States. 383 pp.
- Séré, Y. & Sy, A.A., 1997. Affections phytopathogènes majeures du riz au Sahel: analyse et stratégie de gestion. In: Miézan, K. et al. (Editors). Irrigated rice in the Sahel: prospects for sustainable development. WARDA, Mbé, Côte d’Ivoire. pp. 275–287.
- Sumi, A. & Katayama, T.C., 1994. Studies on agronomic traits of African rice (Oryza glaberrima Steud.). 1. Growth, yielding ability and water consumption. Japanese Journal of Crop Science 63: 96–104.
Autres références
- Aluko, G., Martinez, C., Tohme, J., Castano, C., Bergman, C. & Oard, J.H., 2004. QTL mapping of grain quality traits from the interspecific cross Oryza sativa × O. glaberrima. Theoretical and Applied Genetics 109(3): 630–639.
- Bettencourt, E. & Konopka, J., 1990. Directory germplasm collections. Collection. 4: Vegetables Abelmoschus, Allium, Amaranthus, Brassicaceae, Capsicum, Cucurbitaceae, Lycopersicon, Solanum and other vegetables. IBPGR, Rome, Italy. 250 pp.
- Bezançon, G., 1995. Riziculture traditionnelle en Afrique de l’Ouest: valorisation et conservation des ressources génétiques. Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquée (JATBA) 37(2): 3–24.
- Bouharmont, J., Olivier, M. & Dumont de Chassart, M., 1985. Cytological observations in some hybrids between the rice species of Oryza sativa L. and O. glaberrima Steud. Euphytica 34(1): 75–81.
- Buddenhagen, I.W. & Persley, G.J. (Editors), 1978. Rice in Africa. Academic Press, London, United Kingdom. 356 pp.
- Burkill, H.M., 1994. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 2, Families E–I. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 636 pp.
- Catling, D., 1992. Rice in deep water. The MacMillan Press Ltd., London, United Kingdom. 542 pp.
- Chang, T.T., 1995. Rice. In: Smartt, J. & Simmonds, N.W. (Editors). Evolution of crop plants. 2nd Edition. Longman, London, United Kingdom. pp. 147–155.
- Guei, R.G., Adam, A. & Traoré, K., 2002. Comparative studies of seed dormancy characteristics of two Oryza species and their progenies. Seed Science and Technology 30(3): 499–505.
- Hanelt, P. & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001. Mansfeld’s encyclopedia of agricultural and horticultural crops (except ornamentals). 1st English edition. Springer Verlag, Berlin, Germany. 3645 pp.
- Heuer, S., Miézan, K.M., Sié, M. & Gaye, S., 2003. Increasing biodiversity of irrigated rice in Africa by interspecific crossing of Oryza glaberrima (Steud.) × O. sativa indica (L.). Euphytica 132(1): 31–40.
- IPGRI, undated. Directory of Germplasm Collections. [Internet] http://www.ipgri.cgiar.org. February 2005.
- Johnson, D.E., Riches, C.R., Diallo, R. & Jones, M.J., 1997. Striga on rice in West Africa; crop host range and the potential of host resistance. Crop Protection 16(2): 153–157.
- Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968. Food composition table for use in Africa. FAO, Rome, Italy. 306 pp.
- Nwilene, F.E., Williams, C.T., Ukwungwu, M.N., Dakouo, D., Nacro, S., Hamadoun, A., Kamara, S.I., Okhidievbie, O., Abamu, F.J. & Adam, A., 2002. Reactions of differential rice genotypes to African rice gall midge in West Africa. International Journal of Pest Management 48(3): 195–201.
- Plowright, R.A., Coyne, D.L., Nash, P. & Jones, M.P., 1999. Resistance to the rice nematodes Heterodera sacchari, Meloidogyne graminicola and M. incognita in Oryza glaberrima and O. glaberrima × O. sativa interspecific hybrids. Nematology 1(7–8): 745–751.
- Purseglove, J.W., 1972. Tropical crops. Monocotyledons. Volume 1. Longman, London, United Kingdom. 334 pp.
- Rehm, S. & Espig, G., 1991. The cultivated plants of the tropics and subtropics: cultivation, economic value, utilization. CTA, Ede, Netherlands. 552 pp.
- Watanabe, H., Futakuchi, K., Jones, M.P., Teslim, I. & Sobambo, B.A., 2002. Brabender viscogram characteristics of interspecific progenies of Oryza glaberrima Steud and O. sativa L. Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology 49(3): 155–165.
- Ukwungwu, M.N., Williams, C.T. & Okhidievbie, O., 1998. Screening of African rice, Oryza glaberrima Steud, for resistance to the African rice gall midge Orseolia oryzivora Harris & Gagne. Insect Science and its Application 18(2): 167–170.
Sources de l'illustration
- National Research Council, 1996. Lost crops of Africa. Volume 1: grains. National Academy Press, Washington D.C., United States. 383 pp.
- Roshevitz, R.J., 1931. A contribution to the knowledge of rice. Bulletin of Applied Botany, of Genetics and Plant Breeding 27(4): 1–133.
Auteur(s)
- G. Bezançon, Institut de recherche pour le développement (IRD), B.P. 11416, Niamey, Niger
- S. Diallo, ISRA / Zone Fleuve, CRA de Saint-Louis, B.P. 240, Sor Saint-Louis, Senegal
Citation correcte de cet article
Bezançon, G. & Diallo, S., 2006. Oryza glaberrima Steud. In: Brink, M. & Belay, G. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 23 décembre 2024.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.