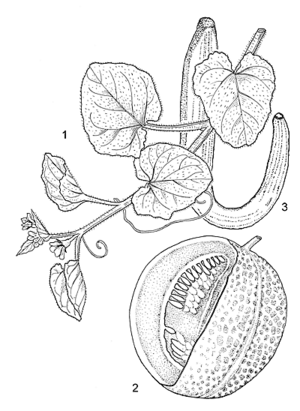Cucumis melo (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Oléagineux | |
| Médicinal | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
Cucumis melo L.
- Protologue: Sp. pl. 2 : 1011 (1753).
- Famille: Cucurbitaceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 24
Noms vernaculaires
- Melon (Fr).
- Melon, muskmelon, cantaloupe (En).
- Melão (Po).
- Mtango, mtango mungunyana, mmumunye (Sw).
Origine et répartition géographique
Le melon est probablement originaire d’Afrique de l’Est, où existent encore des populations sauvages, par ex. au Soudan, en Ethiopie, en Erythrée, en Somalie, en Ouganda et en Tanzanie. Il est peut-être également sauvage en Afrique australe, mais les limites exactes de l’aire de répartition de Cucumis melo sauvage restent floues en raison de la présence fréquente de plantes échappées des cultures. Domestiqué dans l’est de la zone méditerranéenne et en Asie occidentale il y a au moins 4000 ans, le melon s’est par la suite répandu à travers l’Asie. Au cours de cette longue période de culture, de nombreux types se sont développés, avec des fruits de formes variées, à la chair douce ou non. D’importants centres de diversité du melon cultivé se sont créés en Iran, en Ouzbékistan, en Afghanistan, en Chine et en Inde. En Afrique, une variabilité importante est présente au Soudan et en Egypte. Le nom “cantaloup” vient d’une introduction de melon au XVe siècle depuis l’Arménie turque dans la résidence papale de Cantalupi près de Rome. Le melon est aujourd’hui cultivé dans le monde entier. C’est un légume-fruit typique des régions subtropicales et tempérées chaudes.
Le melon est présent dans toutes les régions chaudes et arides de l’Afrique, où il est cultivé tantôt pour son fruit, tantôt pour sa graine.
Plusieurs types non doux de Cucumis melo sont cultivés traditionnellement. Le plus important est le melon serpent ou concombre serpent, qu’on nomme “ajjour”, “faqqus” or “qatta” en arabe. On le trouve dans de nombreuses régions d’Asie, depuis la Turquie jusqu’au Japon, et dans certaines parties de l’Europe (en Italie) et aux Etats-Unis. En Afrique, il semble se limiter au Soudan et au nord de l’Afrique (Egypte, Maroc, Tunisie), où il est assez important. Au Soudan, les fruits immatures d’un type localement connu sous le nom de “tibish” sont utilisés de la même manière que le melon serpent. Certains autres types cultivés en Afrique possèdent une chair amère et sont cultivés pour leurs graines comestibles.
Usages
Les fruits mûrs des cultivars de melon doux se consomment généralement crus pour leur pulpe juteuse et sucrée. On mélange aussi la pulpe à de l’eau et du sucre, ou parfois avec du lait, et on la sert comme boisson rafraîchissante ou transformée en crème glacée. Les fruits immatures des types non doux, dont le melon serpent, s’emploient crus, cuits ou confits au vinaigre ; on les farcit aussi de viande, de riz et d’épices, et on les fait frire à l’huile. Le melon serpent est souvent confondu avec le concombre et utilisé comme celui-ci. On consomme également les graines grillées ; elles contiennent une huile comestible. Les Hausas du Nigeria broient les amandes pour en faire une pâte, dont ils confectionnent des galettes fermentées. Les jeunes feuilles se consomment parfois comme légume cuit et en soupe. Les tiges feuillées ainsi que les fruits fournissent un bon fourrage pour tous les animaux domestiques. A la Réunion et à Maurice, on emploie une décoction de graines et de racines comme diurétique et vermifuge.
Production et commerce international
La production annuelle mondiale du melon est passée de 9 millions de t (sur 700 000 ha) en 1992 à 22 millions de t (sur 1,2 million ha) en 2002. Les principaux pays producteurs sont la Chine avec 400 000 ha, l’Asie occidentale (Turquie, Iran, Irak) avec 200 000 ha, les Amériques (Etats-Unis, Mexique, pays d’Amérique centrale et du Sud) avec 165 000 ha, le nord de l’Afrique (Egypte, Maroc, Tunisie) avec 110 000 ha, l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh) avec 100 000 ha, l’Union européenne (Espagne, Italie, France, Grèce, Portugal) avec 95 000 ha, la Roumanie avec 50 000 ha, le Japon avec 13 000 ha et la Corée avec 11 000 ha.
Chaque pays possède ses cultivars spécifiques et la plus grande partie de la production est vendue sur les marchés locaux. La production destinée à l’export s’est développée dans la région méditerranéenne, aux Etats-Unis, au Mexique, en Australie, à Taïwan et au Japon, sur la base de cultivars hybrides F1 bien adaptés au transport et au stockage.
En Afrique, le melon doux est une denrée de luxe destinée aux marchés urbains et que l’on cultive dans les régions sèches et les hautes terres. On ne dispose pas de statistiques de production pour la plupart des pays, sauf pour le Cameroun (3500 ha) et le Soudan (1200 ha). Le Sénégal et les pays voisins exportent du melon pendant l’hiver en Europe.
Le melon serpent est important au Soudan, où il est destiné à un usage domestique et à la vente sur les marchés locaux. La superficie cultivée avoisine les 4000 ha, avec une production annuelle de 80 000 t. Il n’est pas exporté.
Propriétés
La proportion comestible d’un fruit de melon mûr est de 45–80%. Les fruits (crus et pelés) contiennent, par 100 g de partie comestible : eau 90,2 g, énergie 142 kJ (34 kcal), protéines 0,8 g, lipides 0,2 g, glucides 8,2 g, fibres 0,9 g, Ca 9 mg, Mg 12 mg, P 15 mg, Fe 0,2 mg, Zn 0,2 mg, vitamine A 3382 UI, thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,7 mg, folate 21 μg, acide ascorbique 37 mg (USDA, 2002).
La composition nutritionnelle du melon serpent, par 100 g de partie comestible, est de : eau 94,5 g, énergie 75 kJ (18 kcal), protéines 0,6 g, lipides 0,1 g, glucides 4,4 g, fibres 0,3 g, acide ascorbique 13 mg (Polacchi, W., MacHargue, J.S. & Perloff, B.P., 1982).
La teneur en sucre et le parfum sont des facteurs importants pour la qualité du melon doux. Les esters dérivés d’acides aminés sont des composés importants de sa saveur caractéristique ; en outre, des composés soufrés jouent aussi un rôle. Plusieurs alcools et aldéhydes en C-9, dont le Z-non-6-énal, sont caractéristiques du parfum du melon. Pour obtenir le meilleur parfum, il faut récolter les fruits seulement 2–3 jours avant qu’ils soient complètement mûrs. L’amande comestible des graines contient environ 46% d’une huile jaune et 36% de protéines.
Falsifications et succédanés
En salade, le melon serpent peut être remplacé par le concombre (Cucumis sativus L.). Comme fruit, le melon doux peut être remplacé par la papaye.
Description
- Plante herbacée monoïque, annuelle, grimpante, rampante ou coureuse, à vrilles simples ; système racinaire étendu, réparti principalement dans les 30–40 premiers centimètres du sol, certaines racines descendant à 1 m de profondeur ; tige atteignant 3 m de long, sillonnée ou striée, poilue.
- Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 4–10 cm de long ; limbe orbiculaire ou ovale à réniforme, de 3–15(–20) cm de diamètre, anguleux ou faiblement 5–7-palmatilobé, cordé à la base, faiblement sinué-denté, surfaces poilues.
- Fleurs axillaires, unisexuées ou bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 0,5–3 cm de long ; sépales linéaires, de 6–8 mm de long ; corolle campanulée, lobes presque orbiculaires, atteignant 2 cm de long, jaune ; fleurs mâles en fascicules de 2–4 fleurs, à 3 étamines libres ; fleurs femelles ou bisexuées solitaires, à ovaire infère, ovoïde, stigmate 3-lobé.
- Fruit : baie globuleuse, ovoïde ou oblongue, pesant 0,4–2,2 kg, lisse ou côtelée, peau lisse à rugueuse et brodée, blanche, verte, vert jaunâtre, jaune, brun jaunâtre, mouchetée de jaune ou d’orange sur fond vert ou jaune, chair jaune, rose, orange, verte ou blanche, contenant de nombreuses graines.
- Graines ellipsoïdes comprimées, de 5–12 mm × 2–7 mm × 1–1,5 mm, blanchâtres ou chamois, lisses.
- Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques
La plupart de la trentaine d’espèces de Cucumis sont originaires d’Afrique. Elles possèdent toutes un nombre de chromosomes de 2n = 24, sauf Cucumis sativus L. (le concombre) qui en a 2n = 14 ; cette espèce est probablement originaire d’Asie. Les fruits de Cucumis sativus sont hérissés de tubercules et de verrues à l’état jeune, alors que les ovaires de Cucumis melo sont poilus sans tubercules ni verrues.
Cucumis melo est polymorphe. Les plantes sauvages et adventices sont souvent distinguées sous le nom de subsp. agrestis (Naudin) Pangalo, qui a des ovaires courtement pubescents ainsi que des fleurs et des fruits relativement petits, tandis que les plantes cultivées (subsp. melo) possèdent des ovaires velus et des fleurs et fruits généralement plus gros.
Les plantes cultivées appartiennent à de très nombreux groupes de cultivars différents, dont les plus importants (à fruits doux) pour les maraîchers modernes sont les suivants :
– le Groupe Reticulatus (melon brodé) : fruit globuleux (1–1,8 kg), peau fortement brodée, parfois côtelée, vert jaunâtre à chair orange (italo-américain) ou finement brodée à lisse, vert jaunâtre à chair vert pâle (japonais, méditerranéen, par ex. ‘Galia’ ) ; teneur en sucre élevée (13–15%), parfumé, durée de conservation moyenne.
– le Groupe Cantaloup (cantaloup ou melon musqué) : fruit aplati à globuleux et souvent côtelé (1,2–1,8 kg), peau lisse ou brodée, chair généralement orange, teneur élevée en carotène et en sucre, saveur prononcée, durée de conservation brève, cultivé principalement dans le sud-ouest de l’Europe (par ex. ‘Charentais’) et les Amériques.
– le Groupe Inodorus (melon d’hiver) : fruit ovoïde (1,5–2,5 kg), maturité tardive, peau lisse, ridée ou légèrement brodée, souvent striée ou marbrée, grise, verte ou jaune, chair ferme, blanche ou vert pâle, teneur en sucre élevée mais peu de saveur, durée de conservation longue, principalement cultivé en Iran, en Afghanistan et en Chine, mais également en Espagne, aux Etats-Unis et au Japon ; les cultivars importants sont ‘Casaba’, ‘Honeydew’, ‘Piel de Sapo’, ‘Jaune Canari’ et ‘Chinese Hami’.
Parmi les groupes à fruits non doux utilisés comme légume en Afrique, on peut citer :
– le Groupe Flexuosus (melon serpent) : fruit atteignant 2 m de long, plus de 6 fois plus long que large, peau vert pâle ou rayée de vert pâle et de vert foncé, côtelée ou ridée, chair blanche.
– le Groupe Tibish : fruit petits, ovoïdes à aplatis, sans côtes, peau lisse, vert foncé rayée de vert pâle, chair ferme, blanche, particulièrement important au Soudan ; un type similaire nommé “seinat” au Soudan est cultivé pour sa graine.
Le melon doux cultivé pour les marchés urbains d’Afrique tropicale comprend de nos jours généralement des cultivars hybrides F1 du Groupe Reticulatus (par ex. ‘Galia’) et du Groupe Cantaloup (par ex. ‘Charentais’).
Croissance et développement
Les graines de melon restent viables pendant au moins 6 ans si on les conserve au sec (teneur en eau de 6%) à des températures inférieures à 18ºC. Une prégermination peut améliorer la germination après un long stockage. Les plantules lèvent (2–)4–8(–14) jours après le semis. De nombreuses racines horizontales latérales se développent rapidement à partir de la racine pivotante. Les racines poussent surtout à une profondeur de 30–40 cm. La première vraie feuille apparaît 5–6 jours après le déploiement des cotylédons. Les 2–4 premiers bourgeons axillaires sur la tige principale produisent de vigoureux rameaux primaires, qui inhibent la croissance de la tige principale. Chez la plupart des types, les premiers groupes de fleurs mâles apparaissent sur les 5e–12e nœud des rameaux primaires, tandis que les fleurs bisexuées ou femelles apparaissent sur les rameaux tertiaires, formés à partir du 14e nœud sur les rameaux primaires. Les fleurs ne s’ouvrent qu’une seule journée et ce sont les insectes, principalement des abeilles, qui effectuent la pollinisation. Le fruit est un formidable puits d’assimilats et de minéraux : d’ordinaire, 3–6 fruits seulement se forment par plante, sur les 30–100 fleurs femelles/bisexuées. La courbe de développement du fruit est sigmoïde : la croissance maximale est atteinte 10–40 jours après la floraison. La maturation, pendant laquelle le fruit connaît peu d’expansion supplémentaire, a lieu au cours des 10 derniers jours : les sucres s’accumulent dans la chair des fruits et le tissu brodé à la surface prend forme. Les fruits mûrissent entre 75 jours (cultivars précoces du Groupe Reticulatus et du Groupe Cantaloup) et 120 jours (Groupe Inodorus) après le semis. Chez les fruits du Groupe Reticulatus et du Groupe Cantaloup, l’éthylène joue un rôle essentiel dans le processus de maturation (climactérique) : par ex. pour amollir la chair, faire jaunir la peau et permettre l’abscission du pédicelle. La durée de conservation de ces fruits est courte (< 1 semaine pour ‘Charentais’) à moyenne (2–3 semaines pour ‘Galia’). Les fruits des cultivars du Groupe Inodorus ne produisent pas d’éthylène au cours de leur maturation (non climactérique), et par conséquent leur durée de conservation est longue 3 mois pour ‘Piel de Sapo’). La coloration de la chair et l’accumulation de sucres et d’acides organiques sont des processus de maturation non liés à l’éthylène.
Ecologie
Cucumis melo à l’état sauvage est présent dans les savanes boisées, particulièrement le long des rivières et comme adventice dans les champs et les terrains vagues, jusqu’à 1200 m d’altitude.
Pour sa croissance et sa production, le melon a besoin d’un temps chaud et sec avec beaucoup de soleil. La fourchette de température optimale se situe à 18–28ºC, et en dessous de 12ºC, la croissance est sévèrement ralentie. Le melon supporte facilement plusieurs heures par jour de températures très élevées, jusqu’à 40°C. Le gel tue les plantes instantanément. Chez le melon serpent, on a découvert que l’allongement des tiges était plus important pendant les jours courts de 8 heures que pendant les jours de 16 heures. Une humidité élevée réduit la croissance, a des effets nocifs sur la qualité des fruits et favorise les maladies foliaires. Le melon pousse mieux sur des sols fertiles limoneux, profonds, bien drainés et bien travaillés, où le pH est de 6–7. Il ne supporte pas les sols très acides ou l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation
En général, le melon se sème directement : il faut 2–3 graines par trou, semées à 2–4 cm de profondeur sur buttes ou billons, qu’on éclaircit ultérieurement pour ne laisser qu’une seule plante. L’espacement est de 50–60 cm sur la ligne et de 120–200 cm entre les lignes, ce qui fait une densité de 8000–16 000 plantes à l’ha. Une autre possibilité est de semer en pots en polyéthylène ou dans des cubes de terre et de repiquer soigneusement au champ lorsque les plants sont âgés de 4 semaines, en faisant attention de ne pas endommager le système racinaire. Le poids de 1000 graines est de (8–)25–35 g. La quantité de graines à l’ha est de 1,5–2 kg pour les melons semés directement, et de 0,5 kg pour les melons repiqués. Au Soudan, on sème le melon serpent directement sur des planches surélevées de 2 m de large, dans des trous situés de chaque côté.
Gestion
Le melon se cultive dans des conditions d’altitude normales, à condition de pratiquer une rotation avec des cultures non cucurbitacées pour éviter les maladies transmises par le sol et les nématodes. Le sol doit être bien labouré, hersé et passé au rotavator jusqu’à obtenir une terre bien meuble et bien plane. L’irrigation à la raie ou au goutte à goutte est commune, car ces plantes ont des besoins élevés en eau jusqu’à la maturité des fruits. Mais le melon est moins dépendant de l’arrosage quotidien que le concombre ou la courge. Pendant la saison sèche, on peut donner un litre d’eau par trou de plantation. Au Soudan, une culture établie de melon serpent reçoit un arrosage tous les 10–12 jours pendant la saison pluvieuse chaude (mars–octobre), et tous les 14–18 jours pendant la saison fraîche.
Les besoins en engrais dépendent de la façon dont la culture prospère et des nutriments contenus dans le sol. L’absorption en nutriments correspondant à une récolte de 20 t/ha de fruits est la suivante : 60–120 kg de N, 9–18 kg de P, 100–120 kg de K, 70–100 kg de Ca et 10–30 kg de Mg. Le melon réagit bien aux fumures organiques prodiguées à raison de 25–30 t/ha. Un engrais complet doit être épandu avant le semis ou la plantation, suivi d’une application d’azote en surface lorsque les tiges font 20–30 cm de long. Le melon est particulièrement sensible à la carence en Ca, qui provoque chez les fruits une vitrescence ou un cœur aqueux. Il est également sensible à la carence en molybdène, qui survient sur les sols ferralitiques. Le melon est en outre très sensible à tout un ensemble d’herbicides, dont l’Atrazine, et des résidus d’herbicides de cultures précédentes peuvent même l’endommager.
En production de melon, le paillage est une pratique bien établie. Dans les régions subtropicales, on utilise couramment des bâches de polyéthylène noires, transparentes ou argentées, non seulement pour lutter contre les adventices, mais aussi pour élever ou abaisser la température du sol. Sous les tropiques, les matériaux de paillage les plus répandus sont la paille de riz ou l’herbe et, de plus en plus, le film plastique. Dans les régions où ces matériaux ne sont pas disponibles, il est nécessaire de désherber jusqu’à ce que les plantes commencent à produire de longues tiges. Le binage ou l’arrachage manuel des grandes adventices est une pratique fréquente. On emploie diverses méthodes de taille pour les rameaux primaires et secondaires afin de réguler la croissance végétative et la fructification (3–5 fruits par plante). Le melon serpent se cultive parfois sur un treillage pour obtenir des fruits droits.
Maladies et ravageurs
Plusieurs maladies peuvent affecter le melon. La pourriture noire (Didymella bryoniae) provoque le chancre de la tige et du pédoncule du fruit, la pourriture du fruit et le flétrissement de la plante. Dans des conditions humides et chaudes, c’est une maladie grave. On en vient à bout en utilisant des semences exemptes de maladies, en les désinfectant, en pratiquant une rotation, en employant des fongicides, mais surtout en plantant des cultivars résistants. L’oïdium (Sphaerotheca fuliginea et Erysiphe cichoracearum) peut être combattu à l’aide de fongicides, mais les hybrides F1 modernes offrent une tolérance élevée à la plupart des types. Le mildiou (Pseudoperonospora cubensis), important en climats chauds et humides, peut être combattu avec des fongicides ; certaines souches indiennes de melon offrent une résistance polygénique. La nuile rouge (Colletotrichum lagenarium) peut être maîtrisée en traitant les semences, en pratiquant la rotation et à l’aide de fongicides. La fonte des semis (Pythium sp. et Rhizoctonia sp.) doit être empêchée en traitant les graines avec des fongicides. On lutte contre la pourriture humide (Erwinia tracheiphila) en supprimant les plantes touchées et en éliminant le vecteur (la chrysomèle rayée du concombre) avec des traitements insecticides. La maladie des taches anguleuses (Pseudomonas lachrymans) est surtout une maladie du concombre, mais il arrive qu’elle affecte le melon. La fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) ne peut être évitée qu’au moyen de cultivars résistants. Chez le melon serpent, c’est également un problème grave. Elle est surtout agressive à basses températures (18–20°C) et elle est absente dans les basses terres. Un brusque flétrissement, provoqué par le champignon transmis par le sol Monosporascus cannonballus, est devenu un problème grave dans les régions à climat subtropical, aux sols neutres ou alcalins, où les températures du sol sont élevées (30–35°C) et où l’on a recours au paillage plastique ; il n’a pas encore été signalé en Afrique tropicale mais il constitue une menace potentielle.
Le virus le plus fréquent en conditions tropicales est le virus des taches en anneau de la papaye (PRSV-W, anciennement WMV-1), transmis par les pucerons, contre lequel il existe une bonne résistance. Le virus de la mosaïque du concombre (CMV), le virus de la mosaïque de la pastèque (WMV-2) et le virus de la mosaïque jaune de la courgette (ZYMV), tous trois transmis par les pucerons, surtout par Aphis gossypii, affectent le melon et prédominent en conditions subtropicales ; il existe diverses sources de résistance à ces trois virus ainsi qu’à leur vecteur. Parmi les autres maladies virales du melon, on peut citer le virus de la criblure du melon (MNSV), transmis par un champignon du sol (Olpidium sp.), le virus de la marbrure verte du concombre (CGMMV) et le virus de la frisolée de la betterave (BCTV), transmis par les cicadelles.
Les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) peuvent représenter un problème grave lorsque les melons sont cultivés sans rotation appropriée ; on peut en venir à bout en procédant à la solarisation du sol ou à l’aide de fumigants du sol à large spectre, mais ces derniers sont coûteux et comportent des risques pour l’environnement.
Les ravageurs du melon sont des thrips (Thrips palmi et Frankliniella spp.), l’acarien jaune (Tetranychus urticae), des pucerons (Aphis gossypii), la mouche des fruits du melon (Dacus cucurbitae), la chrysomèle du concombre (Diabrotica spp.), la pyrale (Diaphania indica), la chrysomèle Aulacophora similis et la mouche Bactrocera cucurbitae, particulièrement active sous les tropiques humides et qui fait tomber les jeunes fruits en creusant des galeries dans le pédicelle. Les agriculteurs luttent généralement contre ces ravageurs à l’aide d’insecticides. Toutefois, un usage aveugle d’insecticides ne fait qu’aggraver le problème des ravageurs en détruisant les insectes parasites utiles.
Récolte
Le melon cantaloup et le melon brodé tendent à se séparer de leur pédicelle à la base du fruit à maturité en raison de la formation d’une zone d’abscission. Cette craquelure ou cerne finit par être circulaire, mais la récolte a lieu généralement quand elle est à peine amorcée. Les fruits du Groupe Inodorus ne forment pas de zone d’abscission et leur maturité se signale par un changement de couleur, par ex. un passage du vert au jaune. Les fruits immatures vert pâle du melon serpent se récoltent dès 45–60 jours après le semis. Les fruits récoltés font environ 20 cm de long, ils ont un diamètre de 3 cm, et pèsent 90–100 g. Si on les laisse pour la production de semences, on les récoltera totalement mûrs.
Rendement
Les rendements de melon atteignent 5–40 t/ha, avec une moyenne de 18 t/ha, en fonction du cultivar et des pratiques culturales. Les rendements en graines sont d’environ 300–500 kg/ha pour les variétés-populations et de 100–200 kg/ha pour les cultivars hybrides. Le rendement du melon serpent au Soudan est en moyenne de 20 t/ha.
Traitement après récolte
Le melon destiné au stockage doit être préréfrigéré à 10–15ºC immédiatement après la récolte pour ralentir la maturation. Il est possible de le conserver 10–15 jours à 3–4ºC (90% d’humidité relative), mais des températures inférieures peuvent causer des lésions dues au froid. Le cultivar ‘Honeydew’ ainsi que d’autres melons d’hiver peuvent se conserver à 10–15ºC pour des périodes plus longues, certains cultivars allant jusqu’à 90 jours. Les melons fortement brodés (par ex. le méditerranéen ‘Galia’ et l’américain ‘Western Shipper’) résistent relativement bien à la manutention et au transport. Les melons serpents sont emballés dans des sacs de jute ou de plastique pour être acheminés sur les marchés des villes proches. On les traite de la même manière que les concombres.
Ressources génétiques
La diversité génétique au sein de Cucumis melo est relativement bien préservée dans les collections de ressources génétiques. Les plus vastes de ces collections sont maintenues aux Etats-Unis (North Central Regional Plant Introduction Station, à Ames, IA), en Russie (Institut Vavilov, St.-Pétersbourg), en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS), Pékin), mais de nombreux autres pays détiennent des collections substantielles. En Afrique, d’importantes collections sont détenues au National Horticultural Research Institute d’Ibadan (Nigeria) et à l’Agricultural Research Corporation, de Wad Medani (Soudan). Les collections de Wad Medani comprennent près de 70 entrées de melon serpent et 45 entrées de “tibish”, le melon-légume local. Ces collections pourraient être complétées par des prospections dans les centres secondaires de diversité génétique en Afghanistan, en Inde, en Chine, au Pakistan et en Soudan. Certains groupes de cultivars à petits fruits, proches des types sauvages, semblent constituer d’excellentes sources de résistance aux maladies les plus importantes du melon.
Sélection
Une bonne partie de l’amélioration du melon porte sur la sélection massale et généalogique au sein de variétés-populations. Toutefois, celles-ci cèdent rapidement le pas aux cultivars hybrides F1, en particulier en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et au Taïwan. Le développement de lignées pures chez le melon est facile, car il n’y a pratiquement pas de dépression consanguine après des autofécondations répétées. En contrepartie, les hybrides entre lignées pures présentent peu de vigueur hybride. Néanmoins, ces hybrides F1 ont des avantages importants comme l’uniformité du type de plante et de fruit et la recombinaison des caractéristiques favorables de différents types de melons en un seul génotype : qualité du fruit (forme arrondie, bon goût, teneur élevée en sucre, cavité placentaire réduite), longue durée de conservation, adaptation à des climats humides et, surtout, résistance aux maladies et ravageurs.
La plupart des cultivars présentent des fleurs mâles et bisexuées sur une même plante, et la production de semences d’hybrides F1 nécessite la castration des fleurs bisexuées, suivie d’une pollinisation manuelle. Des types monoïques permettraient la production de semences hybrides grâce à une pollinisation par les abeilles, car la lignée femelle peut être induite temporairement à produire uniquement des fleurs femelles par des pulvérisations d’éthrel. Toutefois, le passage aux hybrides F1 monoïques est ralenti par le fait que chez le melon la monoécie est liée à une forme allongée et à une grande taille des fruits, alors que chez le cantaloup et le melon brodé, on cherche à obtenir des fruits ronds et compacts. Mais les hybrides F1 monoïques se répandent de plus en plus de nos jours.
Les principaux objectifs de sélection du melon serpent sont la résistance aux maladies et aux insectes, ainsi qu’une meilleure qualité de fruit. La sélection pour la résistance est la première des priorités parce que le fruit se consomme le plus souvent cru, ce qui rend le recours aux produits chimiques risqué, surtout lorsque les restrictions ne sont pas observées. Lorsque c’est la qualité qui est visée, la sélection cherche à produire des cultivars à fruits minces et tendres destinés à être consommés crus en salades vertes.
Lors d’une récente évaluation de matériel génétique de melon collecté au Soudan, on a découvert plusieurs entrées de melon serpent dont certains individus étaient résistants à Sphaerotheca fuliginea et à certains types de Fusarium. Les croisements avec le melon ordinaire sont faciles et se produisent spontanément. La résistance au Fusarium a aussi été détectée dans certaines entrées appartenant au Groupe Tibish et dans les populations sauvages de Cucumis melo, connues localement au Soudan sous le nom de “humaid”. La résistance à certaines maladies d’origine virale, en particulier le ZYMV, a été également observée dans certaines entrées de “humaid”.
Perspectives
Le melon est un fruit apprécié par la plupart des consommateurs et sa production continuera à prendre de l’importance, grâce à une meilleure adaptation aux conditions chaudes et humides. Le facteur qui limite la production du melon est la multitude des maladies (surtout des virus) et des ravageurs. De nouvelles techniques de biologie cellulaire (fusion de protoplastes) et moléculaire (transformation génétique, marqueurs ADN) sont maintenant accessibles aux sélectionneurs de melon. Elles permettent maintenant d’exploiter les ressources génétiques provenant d’autres espèces de Cucumis pour la résistance aux maladies et aux ravageurs, ainsi que pour d’autres caractéristiques impossibles à obtenir au moyen de l’hybridation interspécifique classique.
De par son adaptation aux climats chauds et secs, il serait intéressant d’élargir la culture du melon serpent à des régions d’Afrique en dehors du Soudan. On doit porter plus d’attention à la prospection de ressources génétiques et à la sélection.
Références principales
- Ezura, H., Akashi, Y., Kato, K. & Kuzuya, M., 2002. Genetic characterization of long shelf-life in Honeydew (Cucumis melo var. inodorus) melon. Acta Horticulturae 588: 369–372.
- Montforte, A.J., Garcia-Mas, J. & Arús, P., 2003. Genetic variability in melon based on microsatellite variation. Plant Breeding 122: 153–157.
- Odet, J. (Editor), 1991. Le melon. 2nd Edition. Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes (CTIFL), Paris, France. 293 pp.
- Paje, M.M. & van der Vossen, H.A.M., 1993. Cucumis melo L. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 153–157.
- Pitrat, M. & Risser, G., 1992. Le melon. In: Gallais, A. & Bannerot, H. (Editors). Amélioration des espèces végétales cultivées. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris, France. pp. 448–459.
- Pitrat, M., Hanelt, P. & Hammer, K., 2000. Some comments on infraspecific classification of cultivars of melon. Acta Horticulturae 510: 29–36.
- Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997. Cucurbits. CAB International, Wallingford, United Kingdom. 226 pp.
- Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997. World vegetables: principles, production and nutritive values. 2nd Edition. Chapman & Hall, New York, United States. 843 pp.
- Shinohara, S. (Editor), 1984. Vegetable seed production technology of Japan. Volume 1. Shinohara's Authorized Agricultural Consulting Engineer Office, Tokyo, Japan. 432 pp.
- Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962. Cucurbits - botany, cultivation and utilization. Leonard Hill, London, United Kingdom. 249 pp.
Autres références
- Andres, T.C., 2003. Web site for the plant family Cucurbitaceae and home of the cucurbit network. [Internet] http://www.cucurbit.org/family.html. May 2004.
- El Tahir, I.M. & Pitrat, M., 1999. Tibish, a melon type from Sudan. Cucurbit Genetics Cooperative Report 22: 21–23.
- Fisher, C. & Scott, T.R., 1997. Food flavours: biology and chemistry. The Royal Society of Chemistry, Turpin Distribution Services, Letchworth, United Kingdom. 165 pp.
- Jones, B., Pech, J.C., Bouzayen, M., Lelièvre, J.M., Guis, M., Romajaro, F. & Latché, A., 2001. Ethylene and developmentally-regulated processes in ripening climacteric fruit. Acta Horticulturae 553: 133–138.
- Karchi, Z., 2000. Development of melon culture and breeding in Israel. Acta Horticulturae 510: 13–17.
- Mirghani, K.A. & El Tahir, I.M., 1997. Indigenous vegetables of Sudan: production, utilization and conservation. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 117–121.
- More, T.A., 2002. Enhancement of muskmelon resistance to disease via breeding and transformation. Acta Horticulturae 588: 205–211.
- Oluoch, M.O. & Welbaum, G.E., 1996. Effect of postharvest washing and post-storage priming on viability and vigour of six-year -old muskmelon (Cucumis melo L.) seeds from eight stages of development. Seed Science and Technology 24(2): 195–209.
- Polacchi, W., MacHargue, J.S. & Perloff, B.P., 1982. Food composition tables for use in the Middle East. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. 265 pp.
- Purseglove, J.W., 1968. Tropical Crops. Dicotyledons. Longman, London, United Kingdom. 719 pp.
- Stepansky, A., Kovalski, I. & Perl-Treves, R., 1999. Intraspecific classification of melons (Cucumis melo L.) in view of their phenotypic and molecular variation. Plant Systematics and Evolution 217: 313–333.
- Tindall, H.D., 1983. Vegetables in the tropics. Macmillan Press, London, United Kingdom. 533 pp.
- USDA, 2002. USDA nutrient database for standard reference, release 15. [Internet] U.S. Department of Agriculture, Beltsville Human Nutrition Research Center, Beltsville Md, United States. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp. June 2003.
- Wyllie, S.G., Leach, D.N., Wang, Y.-M. & Shewfelt, R.L., 1995. Key aroma compounds in melons: their development and cultivar dependence. In: Rousseff, R.L. & Leahy, M.M. (Editors). Fruit flavors: biogenesis, characterization and authentification. American Chemical Society, Washington D.C., United States. pp. 248–257.
- Zheng, X.Y., Wolff, D.W. & Crosby, K.M., 2002. Genetics of ethylene biosynthesis and restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) of ACC oxidase and synthase genes in melon (Cucumis melo L). Theoretical and Applied Genetics 105: 397–403.
Sources de l'illustration
- Hassib, M., 1938. Cucurbitaceae in Egypt. Faculty of Science, Fouad 1 University, Cairo, Egypt. 173 pp.
- Paje, M.M. & van der Vossen, H.A.M., 1993. Cucumis melo L. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 153–157.
Auteur(s)
- H.A.M. van der Vossen, Steenuil 18, 1606 CA Venhuizen, Netherlands
- I.M. El Tahir, Plant Genetic Resources Unit, Agricultural Research Corporation, P.O. Box 126, Wad Medani, Sudan
- M.O. Oluoch, AVRDC Regional Center for Africa, P.O. Box 10, Duluti, Arusha, Tanzania
Consulté le 18 décembre 2024.