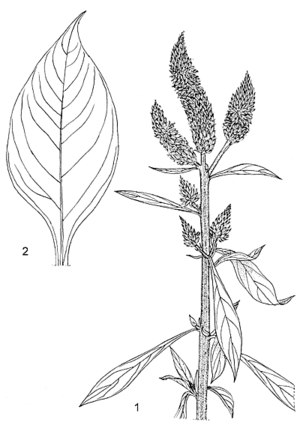Celosia argentea (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Glucides / amidon | |
| Médicinal | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
- Protologue: Sp. pl. 1 : 205 (1753).
- Famille: Amaranthaceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 36, 72, 108
Noms vernaculaires
- Célosie, célosie argentée, crête de coq (Fr).
- Celosia, Lagos spinach, soko, quail grass, cock’s comb (En).
- Amaranto branco (Po).
Origine et répartition géographique
La grande diversité de Celosia argentea en Afrique tropicale fait penser que l’espèce est originaire de cette région. Celosia argentea est une adventice très répandue à travers l’Afrique tropicale, du Sénégal à la Somalie vers l’est, et jusqu’au nord de l’Afrique du Sud et aux îles de l’océan Indien vers le sud ; c’est un légume traditionnel dans l’ouest et le centre de l’Afrique. C’est un des principaux légumes-feuilles dans le sud-ouest du Nigeria, où il est connu comme “soko yòkòtò” en yoruba, ce qui signifie “qui rend les maris heureux et gros”. Il est également extrêmement important dans le sud du Bénin, très apprécié au Togo, au Ghana et au Cameroun, et répertorié comme légume dans plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. En dehors de l’Afrique, il se rencontre en Asie et en Amérique tropicale et subtropicale. Les formes ornementales de Celosia argentea à inflorescences fasciées (crête de coq) sont probablement originaires d’Inde. Elles sont très cultivées comme plantes ornementales dans les régions tropicales et subtropicales, et en été dans les régions tempérées.
Usages
La célosie est utilisée principalement comme légume-feuilles. Les feuilles et tiges tendres sont cuites en soupes, sauces ou ragoûts, mélangées à nombreux ingrédients dont d’autres légumes comme les oignons, piments et tomates, et de la viande ou du poisson et de l’huile de palme. Les feuilles de célosie sont tendres et se défont facilement même après une cuisson brève. La soupe est consommée accompagnée de maïs, riz, manioc ou igname comme aliment principal. Les jeunes inflorescences sont aussi consommées comme herbe potagère.
Au Kenya, les Massaïs utilisent l’extrait liquide des feuilles et des fleurs pour laver le corps des convalescents. La plante entière est utilisée comme antidote contre les morsures de serpent et les racines pour traiter les coliques, la gonorrhée et l’eczéma. En Ethiopie et R.D. du Congo, les graines sont utilisées comme médicament contre la diarrhée, et en Ethiopie les fleurs sont utilisées pour traiter la dysenterie et les troubles musculaires. En Chine, les feuilles sont utilisées comme remède dans le traitement des plaies infectées, des blessures et des éruptions cutanées, et en Chine et au Japon les extraits de graines ont été traditionnellement utilisés comme traitement thérapeutique pour les yeux et les maladies hépatiques. En Inde, les feuilles mélangées avec du miel sont appliquées sur des zones enflées ou des abcès, et les graines sont très utilisées dans le traitement du diabète sucré. En Asie du Sud-Est, les fleurs sont utilisées comme médicament pour la dysenterie, l’hémoptysie et les problèmes de menstruation. En R.D. du Congo, la plante est associée à des croyances occultes et des pratiques de sorcellerie. La célosie peut aussi servir à nourrir le bétail. Les formes à inflorescences fasciées, jaunes à rouges, sont très cultivées en plates-bandes dans les jardins et comme fleurs coupées. Elles sont aussi cultivées en Afrique.
Production et commerce international
La célosie est cultivée sur de petites parcelles dispersées dans les jardins familiaux, les champs cultivés et les zones urbaines et péri-urbaines, ce qui rend difficile l’estimation de la superficie cultivée, mais celle-ci doit se chiffrer en milliers d’hectares. C’est un légume de grande valeur économique, particulièrement durant la saison sèche, qui obtient des prix de marché similaires à ceux de l’amarante (Amaranthus cruentus L.). Au Bénin et au Nigeria, les jeunes plantes de célosie sont vendues en petites bottes (0,5–1,0 kg) sur les marchés et dans la rue. Il n’y a pas de commerce international répertorié, mais de petites quantités sont parfois exportées du Nigeria vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour la vente aux communautés africaines résidentes.
Propriétés
La composition de Celosia argentea est, par 100 g de partie comestible : eau 83,8 g, énergie 185 kJ (44 kcal), protéines 4,7 g, lipides 0,7 g, glucides 7,3 g, fibres 1,8 g, Ca 260 mg, P 43 mg, Fe 7,8 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). C’est un légume-feuilles vert foncé avec une haute teneur en micronutriments, comparable à l’amarante (Amaranthus cruentus). Les jeunes feuilles récoltées 5–7 semaines après le semis possèdent la meilleure valeur nutritive et sont spécialement riches en Fe, vitamine A et vitamine C. Les feuilles contiennent de l’acide phytique (120 mg/100g) et de l’acide oxalique (20 mg/100g). La forte teneur en acide oxalique rend les feuilles moins indiquées pour la consommation à l’état cru. La composition est fortement influencée par les facteurs du milieu, comme la fertilité du sol, l’application d’engrais et l’âge de la plante à la récolte.
Dans des essais en Inde, les graines de Celosia argentea ont réduit le glucose sanguin chez des rats à diabète induit par l’alloxane. Des extraits aqueux de graines ont montré des propriétés antimétastasiques et immunomodulatrices dans des essais sur la souris. Un polysaccharide acide, la célosiane, isolé à partir des graines, s’est avéré être un puissant agent antihépatotoxique dans les modèles de lésions chimique et immunologique du foie chez les animaux. Les peptides antimitotiques bicycliques célogentines A–C et moroïdine ont été isolés à partir des graines, et une protéine antivirale a été isolée des feuilles.
Celosia argentea contient des bétacyanines rouges et des bétaxanthines jaunes qui sont à l’essai comme colorants alimentaires. Plusieurs glycopyranosyls ont été isolés à partir de la célosie, dont la citrusine C qui a des propriétés de dépigmentation de la peau. La graine de Celosia argentea contient une huile épaisse connue sous le nom de “celosia oil” en Inde.
Falsifications et succédanés
Dans les plats, les légumes-feuilles préparés de la même manière, spécialement les amarantes et d’autres espèces de Celosia, peuvent être utilisés comme succédanés de Celosia argentea.
Description
- Plante herbacée annuelle érigée jusqu’à 2 m de haut ; tige côtelée, glabre, avec jusqu’à 25 rameaux ascendants par plante.
- Feuilles alternes, simples, sans stipules ; pétiole indistinctement démarqué ; limbe ovale à lancéolé-oblong ou étroitement linéaire, jusqu’à 15(–20) cm × 7(–9) cm, effilé à la base, aigu à obtus et brièvement mucroné à l’apex, entier, glabre, à nervures pennées.
- Inflorescence : épi dense à fleurs nombreuses, conique au début puis cylindrique, jusqu’à 20 cm de long, muni de bractées, argenté à rose, complètement ou partiellement stérile et de nombreuses couleurs chez les formes ornementales.
- Fleurs petites, bisexuées, régulières, 5-mères ; tépales libres, étroitement elliptiques-oblongs, de 6–10 mm de long ; étamines fusionnées à la base ; ovaire supère, 1-loculaire, style filiforme jusqu’à 7 mm de long, stigmates 2–3, très courts.
- Fruit : capsule ovoïde à globuleuse de 3–4 mm de long, à déhiscence circulaire, contenant quelques graines.
- Graines lenticulaires, de 1–1,5 mm de long, noires et brillantes, légèrement réticulées.
Autres données botaniques
Le genre Celosia comprend environ 50 espèces et est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Celosia argentea est de loin l’espèce cultivée la plus appréciée et la plus répandue. Il y a trois types principaux de Celosia argentea cultivés comme légumes au Nigeria et au Bénin : des cultivars à larges feuilles vertes appelés “Soko green” ; des cultivars à larges feuilles avec une pigmentation anthocyanique sur le limbe des feuilles et des parties de la tige, appelés “Soko pupa” ; et des cultivars avec des feuilles étroites vert foncé à texture dure et floraison précoce. “Soko pupa” donne la couleur rouge de ses anthocyanes à la soupe, ce qui le rend moins apprécié que “Soko green”. Des cultivars améliorés de “Soko green” à larges feuilles vert pâle sont plus vigoureux.
Des types ornementaux de Celosia argentea avec des inflorescences fasciées ont été décrits comme Celosia cristata L. et considérés par la suite comme une variété ou une forme de Celosia argentea. Elles sont tétraploïdes (2n = 36), rarement dodécaploïdes (2n = 108), alors que les plantes sauvages sont habituellement octoploïdes (2n = 72) et rarement tétraploïdes (en Inde).
Croissance et développement
La plantule lève 5–7 jours après le semis. La croissance végétative commence lentement mais la floraison peut survenir déjà 6–7 semaines après le semis. Des cultivars améliorés ont une croissance végétative plus précoce mais fleurissent plus tardivement, 12–14 semaines après le semis. La floraison précoce des cultivars locaux et des types sauvages les rend moins attractifs pour les consommateurs et plus appropriés à une seule récolte par arrachage, tandis que les cultivars améliorés peuvent être aussi bien récoltés par arrachage que par cueillettes échelonnées. La floraison est retardée par la coupe des parties végétatives tendres. La pollinisation s’effectue par le vent et les insectes, en particulier les abeilles et les mouches, qui visitent les fleurs régulièrement. La maturation des graines commence à la partie basale de l’inflorescence et progresse graduellement vers le sommet. En conséquence, les graines des parties basales de l’inflorescence sont plus vigoureuses que celles des parties centrales et apicales. Les graines sont mûres 10–20 semaines après le semis et tombent lorsque l’inflorescence est sèche. Elles restent dormantes à la surface du sol jusqu’au début de la saison des pluies suivante.
Ecologie
La célosie pousse bien dans les zones de forêts humides des basses terres à des températures diurnes de 30–35°C et des températures nocturnes de 23–28°C et jusqu’à une altitude de 1700 m. La croissance est fortement ralentie à des températures inférieures à 20°C, et en conséquence elle ne pousse pas bien dans la région des savanes de l’Afrique de l’Ouest à la saison de l’harmattan. La célosie vient bien sous un ombrage partiel, spécialement en situation sèche. La célosie présente une photosynthèse en C3 ; ce qui fait que sa croissance optimale se produit à environ 60% de la pleine lumière solaire, et rend la célosie particulièrement indiquée pour la production en jardin familial ombragé.
Un sol limoneux et sablonneux bien drainé permet une croissance optimale, mais la célosie vient bien aussi dans des terrains marécageux. Au Nigeria et au Bénin, elle est fréquemment produite durant la saison sèche dans des systèmes de culture appelés “fadama”, c’est-à-dire sur les sols hydromorphes des bords de rivières et des zones à inondation saisonnière. Un avantage additionnel est que l’inondation élimine le problème du nématode à galles Meloidogyne. La célosie tolère des sols modérément salins de 25–50 mM de NaCl. Elle est modérément résistante à la sécheresse et se développe bien avec les faibles apports d’eau de la saison sèche, mais une sécheresse sévère induit une floraison précoce. Le besoin en eau durant la saison des pluies est de 500–1000 mm.
Multiplication et plantation
La célosie est cultivée sur des planches plates ou surélevées, ou en billons. Elle est multipliée par graines, aussi bien en semis direct que par repiquage. Le poids de 1000 graines est de 1,0–1,1 g. En semis direct, utilisé pour la récolte par arrachage des jeunes plantes entières, une densité de 6–9 g par 10 m2 est pratiquée pour le semis en ligne ou à la volée. Les semences sont parfois mélangées à du sable fin pour obtenir une répartition uniforme de la semence. Le semis direct conduit à une utilisation excessive de semences, une trop forte densité de plantation, une conduite difficile, une faible croissance végétative et un faible rendement. Le repiquage demande moins de semences. La graine est alors semée dans des planches de pépinière et les plants sont repiqués après 2–3 semaines. Pour une récolte par coupes, les plants sont bien espacés (15 cm × 15 cm sur les planches), alors que pour une récolte unique par arrachage, un espacement de 10 cm × 10 cm suffit. Comparé au semis direct, le repiquage donne des plantes plus uniformes et vigoureuses. La conduite de la culture, par ex. le désherbage et l’application d’engrais, est aussi facilitée avec le repiquage ; le rendement est élevé et la qualité de la plante meilleure. La célosie est souvent produite en culture associée avec d’autres légumes, le manioc ou l’igname. Pour la production de semences, un certain nombre de plantes sont mises de côté après la première récolte. Ces plantes sont coupées à plus faible hauteur pour encourager la production de pousses latérales. Le rendement en graines est de 200–700 kg/ha.
Gestion
Aucun désherbage n’est nécessaire si la terre est bien préparée avant le semis, et que la récolte se fait par arrachage. Si l’on utilise des cultivars améliorés plantés à densité plus faible pour des récoltes échelonnées, 1–2 désherbages sont nécessaires avant le début de la floraison. En culture en mélange, la célosie concurrence mieux les adventices que la corète potagère (Corchorus olitorius L.), mais moins que l’amarante. L’irrigation est facultative pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, selon la sévérité de la chaleur et l’évapotranspiration, 2 irrigations par semaine sont recommandées, apportant un total de 45 mm d’eau. La célosie tolère mieux un sol sec que l’amarante. Elle répond bien aux engrais ; une application de base de fertilisant n’est pas nécessaire si elle est cultivée sur des sols riches. Pour une croissance végétative optimale sur des sols pauvres ou modérément fertiles, l’application d’un engrais complet NPK à une dose de 400 kg/ha en un seul apport est nécessaire si la récolte a lieu par arrachage, et 600 kg divisé en deux applications égales si la récolte est pratiquée par cueillettes successives. Un engrais organique, comme du fumier de poule, de la bouse de vache ou des déchets domestiques, à une dose de 25–40 t/ha, constitue une alternative appropriée aux engrais minéraux. L’engrais organique non seulement favorisera la croissance mais réduira aussi la population et les effets des nématodes à galles.
Maladies et ravageurs
La célosie est sensible à plusieurs champignons du feuillage, dont les attaques peuvent être sévères lorsque l’humidité de l’air est élevée et en temps de pluies, donnant un feuillage de mauvaise qualité. Cercospora celosiae donne des taches grises bordées de rouge sur les feuilles. La rouille blanche (Albugo bliti) forme des pustules blanches sur la face inférieure des feuilles. Les autres maladies qui affectent la qualité des feuilles sont l’alternariose (Alternaria spp.) et la pourriture charbonneuse (Macrophomina phaseolina, Curvularia spp.), qui donne des taches sombres sur les feuilles. La pourriture humide ou pourriture des tiges provoquée par Choanephora cucurbitarum, la maladie principale qui affecte l’amarante pendant la saison humide, est parfois grave dans des plantations denses de célosie. Rhizoctonia solani et Pythium aphanidermatum causent la fonte des semis. La célosie est très sensible aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.) qui provoquent des galles sur les racines, une croissance démesurée, des feuilles petites et couleur chocolat ainsi qu’une baisse de rendement jusqu’à 40%. Il est donc recommandé de ne pas cultiver la célosie continuellement et de ne pas lui faire succéder des plantes sensibles aux nématodes à galles comme le gombo, l’aubergine gboma, la corète potagère, la laitue ou la tomate. Il existe une variabilité parmi les cultivars pour le degré de sensibilité aux nématodes à galles, mais aucun cultivar résistant n’a été signalé. Cependant l’application d’une grande quantité d’engrais organique ainsi que les inondations annuelles réduisent les populations de nématodes. Les chenilles de Hymenia recurvalis et de Psara bipunctalis se nourrissent des feuilles. L’utilisation de pesticides appropriés permet de les combattre. La pulvérisation devrait commencer dès l’apparition des chenilles et être répétée une fois par semaine pendant trois semaines. Les sauterelles et les pucerons provoquent de faibles dégâts chez la célosie.
Récolte
La célosie est récoltée aussi bien par arrachage que par coupes échelonnées des tiges, qui favorisent la production de pousses latérales pour des coupes ultérieures. Les producteurs combinent parfois les deux méthodes, en pratiquant d’abord un éclaircissage par arrachage pour encourager une croissance vigoureuse des plantes laissées en place, qui sont ensuite récoltées par coupes échelonnées. Selon la fertilité du sol et l’humidité, la culture est prête à l’arrachage 4–5 semaines après le semis direct ou environ 4 semaines après le repiquage. La première coupe est pratiquée à une hauteur de 10–15 cm, laissant un nombre suffisant de bourgeons axillaires pour la production de pousses latérales. Les coupes suivantes sont pratiquées à intervalles de 2 semaines, permettant 4–5 récoltes avant le début de la floraison. La floraison est retardée par les coupes régulières. Les cultivars traditionnels ont une floraison plus précoce que les cultivars améliorés et pour cette raison se prêtent moins à une récolte par coupes échelonnées.
Rendement
Dans un essai au Nigeria, le rendement d’une culture bien conduite récoltée par arrachage a été de 47 t/ha alors que des récoltes échelonnées ont donné 57 t/ha. Les coupes échelonnées ont aussi donné un produit de meilleur qualité, moins de déchets non comestibles et un meilleur résultat économique. Bien que la célosie soit un légume-feuilles productif, son rendement est inférieur à celui de l’amarante.
Traitement après récolte
Les plantes récoltées sont liées en bottes après que les racines aient été lavées. Elles sont alors aspergées d’eau pour les maintenir fraîches pour la commercialisation. Si elles sont récoltées tard dans la soirée, les plantes sont disposées sur le toit pour la nuit et ainsi maintenues fraîches par la rosée nocturne. Au marché, les plantes sont liées en bottes de petite taille de 0,5–1,0 kg pour la vente. Elle sont couvertes de tissus de jute et régulièrement arrosées. La durée de vie en rayon des plantes arrachées est prolongée de 2–3 jours en maintenant les racines dans une bassine d’eau.
Ressources génétiques
Une collection de ressources génétiques de Celosia est maintenue au NIHORT, à Ibadan (Nigeria) et plusieurs collections de travail sont maintenues ailleurs en Afrique de l’Ouest. Celosia argentea est l’une des 24 espèces légumières identifiées par l’IBPGR en 1979, comme sujettes à une érosion génétique tout en étant importante localement, ou venant en seconde priorité à l’échelle mondiale. Des collections de ressources génétiques sont nécessaires pour la conservation, l’évaluation et la sélection de cultivars améliorés.
Sélection
La célosie a fait l’objet de peu de travail d’amélioration. Des sélections au Nigeria ont été effectuées parmi les cultivars locaux et améliorés, sur la base de la taille et de la forme des feuilles et de la période de floraison. Des lignées ont été sélectionnées pour la faible coloration rouge ou violette des feuilles. Des cultivars complètement verts ont été sélectionnés au Bénin et au Nigeria et sont maintenant généralement utilisés. Les cultivars améliorés sont plus efficaces en terme de production de feuilles et de superficie de feuilles par plante que les cultivars locaux non sélectionnés.
Perspectives
Celosia argentea est un légume nutritif et facile à cultiver, qui est important pour le sud du Nigeria et du Bénin et présente un potentiel pour d’autres régions de basses terres. Les cultivars nigérians améliorés sont à maturité tardive et adaptés aux récoltes échelonnées, et ils ont de hauts rendements lorsqu’ils sont bien cultivés. Des cultivars précoces à croissance rapide pour la récolte par arrachage devraient être sélectionnés. Un travail d’amélioration des plantes devrait viser le développement de cultivars résistants aux maladies et ravageurs, particulièrement aux nématodes à galles. La recherche devrait également se concentrer sur le développement de pratiques culturales adaptées à la culture pure ou associée, incluant l’irrigation. Il faudrait aussi disposer de systèmes de conservation simples et bon marché pour prolonger la durée de vie au rayon du produit récolté, ainsi que pour assurer une bonne qualité commerciale des feuilles.
Références principales
- Babatola, J.O. & Ogunware, J.B., 1978. Effects of the root-knot nematode, Meloidogyne incognita on growth and yield of three local vegetables. In: Proceedings of the first annual conference of Horticultural Society of Nigeria (HORTSON), Ibadan, Nigeria, November 1–3, 1978. pp. 95–105.
- Badra, T., 1993. Lagos spinach. In: Williams, J.T. (Editor). Pulses and vegetables: underutilized crops. Chapman & Hall, London, United Kingdom. pp. 131–163.
- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.
- Grubben, G.J.H., 1975. La culture de l’amarante, légume-feuilles tropical, avec référence spéciale au Sud-Dahomey. Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 75–6. Wageningen, Netherlands. 223 pp.
- Grubben, G.J.H., 1977. Tropical vegetables and their genetic resources. IBPGR, Rome, Italy. 197 pp.
- Martin, F.W. & Ruberté, R.M., 1975. Edible leaves of the tropics. Agency for International Development Department of State, and the Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, United States. 235 pp.
- Prem Nath & Denton, L., 1980. Leafy vegetables in Nigeria. Plant Genetic Resources Newsletter 42: 14–17.
- Schippers, R., 1997. Appendix 1. Selected indigenous cultivated vegetables from West and East Africa. In: Schippers, R. & Budd, L. (Editors). Proceedings of a workshop on African indigenous vegetables, Limbe, Cameroon, January 13–18, 1997. Natural Resources Institute, Chatham, United Kingdom. pp. 137–147.
- Schippers, R.R., 2000. African indigenous vegetables. An overview of the cultivated species. Natural Resources Institute/ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, Chatham, United Kingdom. 214 pp.
- Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 136 pp.
Autres références
- Aletor, M.V.A. & Adeogun, O.A., 1995. Nutrient and anti-nutrient components of some tropical leafy vegetables. Food Chemistry 53: 375–397.
- Babatola, J.O., 1988. Influences of organic manures and urea on the nematode pests of Celosia argentea. NIHORT Research Bulletin No 3. National Horticultural Research Institute, Ibadan, Nigeria. 10 pp.
- Cai, Y., Sun, M., Schliemann, W. & Corke, H., 2001. Chemical stability and colorant properties of betaxanthin pigments from Celosia argentea. Journal of Agricultural and Food Chemistry 49: 4429–4435.
- Hase, K., Basnet, P., Kadota, S. & Namba, T., 1997. Immunostimulating activity of celosian, an antihepatotoxic polysaccharide isolated from Celosia argentea. Planta Medica 63(3): 216–219.
- Hayakawa, Y., Fujii, H., Hase, K., Ohnishi, Y., Sakukawa, R., Kadota, S., Namba, T. & Saiki, I., 1998. Anti-metastatic and immunomodulating properties of the water extract from Celosia argentea seeds. Biological and Pharmaceutical Bulletin 21(11): 1154–1159.
- Ikeorgu, J.E.G., 1990. Glasshouse performance of three leafy vegetables grown in mixture in Nigeria. Scientia Horticulturae 43: 181–188.
- Ifon, E.T. & Bassir, O., 1979. The nutritive value of some Nigerian leafy green vegetables. Part 1: Vitamin and mineral content. Food Chemistry 4(4): 263–267.
- Keshinro, O.O. & Ketiku, A.O., 1979. Effect of traditional cooking methods on the ascorbic acid content of some Nigerian leafy and fruit vegetables. Food Chemistry 4: 303–310.
- Khoshoo, T.N. & Pal, M., 1973. The probable origin and relationships of the garden cockscomb. Botanical Journal of the Linnean Society 66(2): 127–141.
- Kogbe, J.O.S., 1980. Effects of poultry manure on the yield components of Celosia argentea. Vegetables for the Hot Humid Tropics 5: 54–60.
- Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968. Food composition table for use in Africa. FAO, Rome, Italy. 306 pp.
- NIHORT, 1983. Annual Report of the National Horticultural Research Institute. NIHORT, Ibadan, Nigeria. 101 pp.
- NIHORT, 1985. Annual Report of the National Horticultural Research Institute. NIHORT, Ibadan, Nigeria. 67 pp.
- Nwanguma, E.I., 1997. Preliminary studies on the effect of organic manure in the control of root knot nematode, Meloidogyne incognita and growth of okra and tomato in South-Western Nigeria. In: Adejoro, M.A. & Aiyelaagbe, I.O.O. (Editors). Proceedings of the 15th annual conference of the Horticultural Society of Nigeria (HORTSON). National Horticultural Research Institute, Ibadan, Nigeria. pp. 166–168.
- Okigbo, B.N., 1983. Fruits and vegetable production and extension services in Africa. Acta Horticulturae 123: 23–36.
- Prem Nath & Denton, L., 1979. Vegetable germplasm in Nigeria. Plant Genetic Resources Newsletter 39: 24–25.
- Sawabe, A., Nomura, M., Fujihara, Y., Tada, T., Hattori, F., Shiohara, S., Shiomomura, K., Matsubara, Y., Komemushi, S., Okamoto, T. & Kawamura, S., 2001. Cosmetic substances for skin depigmentation from African dietary leaves, Celosia argentea L. Bulletin of the Institute of Comprehensive Agricultural Science, Kinki University 9: 143–146.
- Schliemann, W., Cai, Y., Degenkolb, T., Schmidt, J. & Corke, H., 2001. Betalains of Celosia argentea. Phytochemistry 58: 159–165.
- van Epenhuijsen, C.W., 1974. Growing native vegetables in Nigeria. FAO, Rome, Italy. 113 pp.
- van Sloten, D.H., 1980. Vegetable genetic resources. Plant Genetic Resources Newsletter 44: 20–25.
Sources de l'illustration
- Grubben, G.J.H., 1975. La culture de l’amarante, légume-feuilles tropical, avec référence spéciale au Sud-Dahomey. Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 75–6. Wageningen, Netherlands. 223 pp.
Auteur(s)
- O.A. Denton, National Horticultural Research Institute, P.M.B. 5432, Idi-Ishin, Ibadan, Nigeria
Consulté le 18 décembre 2024.