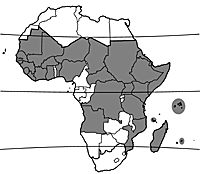Lawsonia inermis (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Colorant / tanin | |
| Huile essentielle / exsudat | |
| Médicinal | |
| Bois d'œuvre | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
- Protologue: Sp. pl. 1 : 349 (1753).
- Famille: Lythraceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 30
Synonymes
- Lawsonia alba Lam. (1789).
Noms vernaculaires
- Henné (Fr).
- Henna, Egyptian privet (En).
- Hena, hésia (Po).
- Mhina, muhina (Sw).
Origine et répartition géographique
L’origine de Lawsonia inermis est inconnue. Les données linguistiques accréditent la thèse d’une origine dans la région du Baloutchistan (Iran/Pakistan) jusqu’en Inde occidentale, où il pousse toujours à l’état sauvage. De là, il se serait propagé vers l’est jusqu’au reste de l’Inde et à l’Indonésie, et vers l’ouest jusqu’au Proche-Orient où il devint l’une des plantes phares de l’islam. Toutefois, il était déjà mentionné dans la Bible pour son parfum (“kopher”) ainsi que dans l’ancienne Egypte (“kwpr”). Plus tard, il suivit les armées et les marchands islamiques depuis l’Arabie jusqu’à l’Espagne, l’Afrique du Nord, Madagascar, les Moluques, l’Indochine et le Japon. On le trouve désormais partout dans les régions tropicales et subtropicales. Le henné est cultivé essentiellement dans les jardins familiaux et sa production commerciale se limite à quelques endroits en Inde, au Pakistan, en Iran, en Egypte, en Libye, au Niger et au Soudan. En Afrique, il s'est souvent naturalisé, notamment sur des sols alluviaux le long des rivières. A Madagascar, il est devenu tellement commun le long de certaines rivières qu’il n’a pas besoin d’être cultivé.
Usages
Le henné est l’un des plus anciens produits de beauté du monde et ses feuilles servent à colorer les ongles, à peindre ou décorer la paume des mains et la plante des pieds, et à teindre les cheveux. Des manuscrits prouvant l’utilisation du henné remontent à plus de 2500 ans. Le henné a une grande importance dans l’islam, où il est utilisé dans de nombreuses cérémonies, notamment le mariage. Cette dernière utilisation a également été adoptée par l’hindouisme et le bouddhisme. L’usage du henné pour teindre la paume des mains et la plante des pieds des femmes mariées s’est répandu à travers la majeure partie du monde musulman ainsi qu’en Inde. Parmi les préparatifs à la cérémonie du mariage, les mains et les pieds de la mariée sont souvent très minutieusement décorés, selon la croyance que le henné purifie et protège ; les dessins varient d’une région et d’une culture à l’autre, indiquant par exemple la bonne santé, la fertilité, la sagesse et l'instruction spirituelle. Dans certaines parties d’Afrique, on privilégie les grands dessins noirs, géométriques. Dans le monde entier, le henné sert de base aux teintures capillaires. Une vaste gamme de nuances allant du blond acajou brillant au châtain et au noir profond et intense peut être obtenue par l’emploi d’additifs ou en combinant le traitement avec d’autres. C’est l’indigo qui est ajouté le plus souvent pour donner une couleur noire. Cet emploi du henné n’est pas limité aux femmes. En effet, en Iran et en Afghanistan, les hommes l’utilisent souvent pour teindre leur barbe et leurs cheveux blancs. Il sert même à teindre les crins des chevaux des dignitaires lors de grandes parades. Partout en Asie du Sud-Est, en Indochine et jusqu’au Japon, le henné sert essentiellement aux femmes pour se teindre les ongles, mais ailleurs cet usage n’est que secondaire.
Pour préparer la teinture destinée à la peau, aux ongles et aux cheveux, on mélange des feuilles fraîches ou séchées ou encore de la poudre de henné avec de l’eau additionnée de jus de citron et de chaux pour obtenir une pâte. En fonction de l’usage, de la couleur désirée et de l’endroit, des substances telles que du gambier, de la poudre de noix d’arec, de l’indigo ou de l’alun peuvent être ajoutées. On applique la pâte soigneusement sur la peau ou les ongles, ou bien on s’en frictionne les cheveux, puis on laisse agir 6–12 heures, la tête recouverte d’un linge humide ou parfois d’une feuille de bétel. La couleur est solide et ne part pas au lavage ; on doit la laisser s’effacer à la longue. Jadis, le henné était abondamment utilisé pour teindre la soie, la laine et dans une moindre mesure le coton, sans mordançage ou après un bain de mordant, en plongeant les fibres textiles dans un bain de henné brûlant additionné de jus de citron. Diverses couleurs oranges et rouges pouvaient être obtenues en ajoutant d’autres ingrédients. Ce colorant servait souvent de couleur de fond sur laquelle était ensuite appliqué de l’indigo pour obtenir un noir profond et grand teint. Le cuir marocain est d’ailleurs encore teint au henné.
L’emploi d’un parfum de fleurs de henné est en grande partie limité à l’Egypte, au nord de l’Inde et à Java. De couleur verdâtre, il est obtenu par macération des fleurs dans l’huile (de préférence de l’huile de ben, Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, qui ne rancit pas facilement). Le henné est largement cultivé dans les jardins en tant que plante ornementale ou de haie, et est apprécié pour le parfum puissant et agréable de ses fleurs, qui n’est pas sans rappeler celui de la rose thé (Rosa chinensis Jacq.). Le bois de henné est finement grainé, dur, et a longtemps servi à fabriquer des piquets de tente et des manches d’outils en Inde, mais on l’utilise aussi comme bois de chauffage. Les fibres des rameaux ainsi que l’écorce du tronc sont utilisées au Kenya en vannerie, les brindilles servant quant à elles de brosses à dents en Indonésie.
En médicine traditionnelle, le henné passe pour une panacée. Seules seront mentionnées ici les utilisations médicinales confirmées par des essais cliniques. Les extraits de feuilles ont un effet astringent sur la peau, la rendant quelque peu hydrophobe. Cet effet, associé avec une action légèrement bactéricide et fongicide, en fait un médicament utile à usage externe pour lutter contre de nombreuses affections de la peau et des ongles. La teinture de cheveux au henné tue efficacement les poux. En médicine arabe et indienne, des préparations à base de feuilles, et contenant parfois d’autres parties de la plante (la racine), sont utilisées de manière efficace pour déclencher l’accouchement, comme abortif et emménagogue. Une décoction de feuilles et de racines est efficace contre certaines formes de diarrhée. En Côte d’Ivoire et dans le nord du Nigeria, les feuilles sont utilisées pour traiter la trypanosomiase.
Production et commerce international
De grosses quantités de henné étant produites à la maison ou pour les marchés locaux, et le henné étant généralement classé dans des rubriques qui incluent divers autres produits, il s’avère impossible d’obtenir des estimations précises sur la production. Les exportations annuelles de feuilles séchées et de poudre d’Inde, d’Egypte et du Soudan se sont élevées à 6000–8000 t pour la période 1975–1980. Le total des exportations annuelles doit dépasser 10 000 t et Dubaï et Singapour sont d’importants entrepôts. Rien que pour le Soudan, les exportations annuelles sont estimées à 1000 t. En 1992, les prix mondiaux ont fluctué entre 250–700 US$/t, en fonction essentiellement de la qualité et de l’approvisionnement total. La demande de henné est montée en flèche entre 1960 et 1980, mais a marqué le pas depuis lors. Les principaux importateurs sont les pays arabes (l’Arabie saoudite avec environ 3000 t/an), la France (250 t/an), la Grande-Bretagne (100 t/an) et les Etats-Unis (plusieurs centaines de t/an). Traditionnellement, le Niger entretient un lien d’exportation avec l’Algérie.
Dans le commerce international, on distingue 3 sortes de henné : le vert, le noir et le neutre, mais leur composition n’est pas toujours claire. Le henné vert est fait à partir de jeunes feuilles, ce qui donne un rouge profond. Le henné noir peut être un henné contenant un taux élevé de lawsone dans les feuilles (c’est la qualité la plus chère), mais il peut s’agir aussi de henné mélangé à des feuilles d’Indigofera ou au composé chimique paraphénylènediamine (PPD) pour teindre les cheveux en noir. Le henné neutre peut être le henné de moins bonne qualité, mais parfois il sert également à indiquer n’importe quel colorant naturel des cheveux, par ex. les feuilles de Senna italica Mill. sans aucune feuille de henné.
Propriétés
Le principe colorant que l’on trouve dans le henné est la lawsone ou 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone (naphthalènedione), qui est présente dans les feuilles sèches à une concentration de 0,5–2%. Elle s’attache fortement aux protéines, ce qui rend la teinture très solide. D’autres composants du henné tels que les flavonoïdes (la lutéoline, l’acacétine) ainsi que l’acide gallique contribuent en tant que mordants organiques au processus de coloration ; les glucides (la gélatine végétale, le mucilage) confèrent à la pâte de henné la consistance voulue pour se fixer sur les cheveux et pourraient aussi jouer un rôle dans la pénétration de la lawsone dans les cheveux et les autres tissus. La tige contient des quantités variables de tanins. Par distillation à la vapeur, les fleurs donnent 0,01–0,02% d’huile essentielle (l’huile de henné), qui contient essentiellement des α- et β-ionones, pouvant servir de base en parfumerie. Les graines renferment environ 10% d’une huile non siccative, visqueuse, composée principalement d’acides oléique, linoléique et stéarique. Cette huile n’a pas d'importance commerciale, mais elle est utilisée, par exemple en Ouganda, pour s’oindre le corps.
Le henné a montré des effets anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques, mais il peut avoir des effets secondaires tels que l’anémie hémolytique en cas de carence en une enzyme, la glucose-6-phosphate déshydrogénase. Des tests effectués sur les rats ont révélé que des extraits d’écorce avaient des activités hépatoprotectrices et anti-oxydantes. Des extraits de henné ont montré également des activités molluscicides et trypanocides. Un extrait de feuilles a révélé des effets antitumoraux et tuberculostatiques lors de tests sur des souris. Il a montré un large spectre fongitoxique au cours de tests sur diverses dermatophytoses, ce qui a été attribué à la lawsone. En Inde, des préparations à base de henné ont révélé une activité antifertilité.
Falsifications et succédanés
La falsification de feuilles de henné séchées et entières est quasiment impossible car elle est facilement détectable. Les feuilles de henné de qualité médiocre d’un point de vue commercial contiennent souvent un fort pourcentage de déchets sous forme de brindilles, de fruits et d’autres plantes. La plupart des falsifications interviennent dans la poudre de henné, qui peut renfermer de la poudre de feuilles d’autres espèces, du sable, de la poudre de coquillages et des colorants, et une analyse microscopique s’impose, pour identifier des détails que le véritable henné ne peut présenter. On utilise des colorants pour falsifier la qualité du henné, par exemple souvent le vert diamant et le jaune auramine, même si tous deux sont interdits dans l’alimentation et les médicaments.
Parfois, le terme henné est employé par référence à n’importe quelle teinture capillaire, bien souvent sans aucun rapport avec le véritable henné. Bon nombre de produits naturels et chimiques sont utilisés mélangés avec du henné, par ex. pour modifier la couleur des cheveux (brou de noix, bois de campêche, curcuma, indigo, luzerne, thé, mordants, tanins, colorants synthétiques), pour renforcer la coloration (brou de noix, camomille, luzerne, pelures d’oignon, sauge, séné), comme parfum (boutons floraux de Myrtus communis L., clou de girofle, eau de rose) ou pour améliorer la pénétration du colorant (par ex. jus de citron, lait aigre ou levure de bière). La paraphénylènediamine présente dans le “henné noir” peut provoquer de graves irritations cutanées et des brûlures de peau.
Description
- Arbuste ou petit arbre fortement ramifié, glabre, atteignant 6(–12) m de haut, à écorce marron-grise et jeunes rameaux quadrangulaires, vieilles plantes présentant parfois de petits rameaux à extrémités épineuses de 3,5 cm de long.
- Feuilles opposées décussées, simples et entières, presque sessiles ; stipules minuscules ; limbe elliptique à oblong ou largement lancéolé, de 1–8,5 cm × 0,5–4 cm, cunéiforme à la base, aigu à arrondi à l’apex, pennatinervé.
- Inflorescence : panicule terminale de grande taille, pyramidale, atteignant 25 cm de long, à nombreuses fleurs.
- Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères, odorantes ; pédicelle de 2–4 mm de long ; calice avec un tube atteignant 2 mm de long et des lobes ovales étalés de 2–3 mm de long ; pétales orbiculaires à obovales, de 1,5–4 mm × 4–5 mm, normalement blanchâtres, parfois rougeâtres ; étamines 8, insérées par paires sur le bord du tube du calice, filets de 4–5 mm de long ; ovaire supère, 4-loculaire, style érigé, atteignant 5 mm de long, stigmate capité.
- Fruit : capsule globuleuse de 4–8 mm de diamètre, violet-vert, indéhiscente ou s’ouvrant irrégulièrement, contenant de nombreuses graines.
- Graines 4-angulaires, de 2–3 mm de long, à tégument épais.
Autres données botaniques
Lawsonia comprend seulement 1 espèce. Les cultivars de henné peuvent avoir des fleurs blanches ou rouges, et de petites ou de grandes feuilles. On dit souvent que le henné à petites feuilles est d’une qualité et d’une efficacité supérieures au henné à grandes feuilles. Parmi les cultivars à petites feuilles, on trouve ‘Filalia’ et ‘Touatia’ au Maroc et ‘Gabsia’ en Libye et en Tunisie. ‘Trabelsia’ est un cultivar à grandes feuilles. La taille de la feuille dépend également des apports d’eau. En saison sèche et en zone sèche, les feuilles peuvent être 5–6 fois plus petites qu’en période de pluie ou que dans des endroits humides.
Croissance et développement
Le henné peut atteindre la taille d’un grand arbuste ou même d’un petit arbre, mais en général il est cultivé comme de la luzerne (Medicago sativa L.), c’est-à-dire comme une plante pérenne à vie courte, atteignant 70 cm de haut.
Ecologie
Le henné a besoin de températures élevées (la moyenne quotidienne optimale étant d’environ 25°C) pour germer, croître et se développer. Il s’adapte à une large gamme de conditions. Il tolère des sols pauvres, pierreux et sableux, mais s’adapte aussi bien à des sols argileux lourds et fertiles. Il tolère une humidité de l’air basse de même que la sécheresse. On rencontre souvent des plantes naturalisées non seulement dans les lits de rivières temporairement inondés et les ripisylves, mais aussi sur les versants des collines et dans des crevasses, jusqu’à 1350 m d’altitude.
Multiplication et plantation
Lorsqu’il est cultivé commercialement, le henné est soit semé puis repiqué, soit multiplié par bouturage ou microbouturage. En Afrique du Nord, la terre est soigneusement préparée par un labour jusqu’à une profondeur de 40 cm, et une forte fumure. Les champs sont ensuite aplanis et préparés pour l’irrigation par submersion. En Inde, où la production est moins intensive, la terre n’est retournée que quelques fois. A cause de leur tégument dur, les graines de henné doivent pré-germer avant d’être semées. Elles sont d’abord mises à tremper durant 3–7 jours, pendant lesquels l’eau est changée quotidiennement. Elles sont ensuite mises en petits tas et conservées en conditions humides et chaudes pendant quelques jours. Il faut veiller à évacuer l’excès d’eau. Lorsque le tégument s’est ramolli et que la graine a commencé à gonfler, elle est prête à être semée en pépinière. Durant les premiers jours après le semis, le sol doit rester bien humide et des irrigations quotidiennes sont souvent nécessaires. Lorsque les plantes ont environ 40 cm de haut, elles sont arrachées, rabattues à environ 15 cm et repiquées. Les densités de plantation s’échelonnent entre 20 000 et 200 000 plantes/ha, en fonction de la disponibilité en eau. Il faut compter 3–5 kg de graines par ha. Pour une multiplication par bouturage, on utilise des rameaux à 6–8 bourgeons.
Gestion
Pour une production commerciale intensive, comme en Afrique du Nord, la culture est irriguée pendant la saison sèche et fortement fumée. En Inde, la culture se pratique sur une plus grande échelle, de manière moins intensive, souvent sans irrigation et rarement avec engrais. Les champs sont binés une ou deux fois par an et désherbés le cas échéant. Les plantes produisent leur plus fort rendement les 4–8 premières années après la plantation, mais restent souvent au champ 12–25(–40) ans. Le henné absorbe des quantités considérables de nutriments du sol. Un rendement de 1000 kg de feuilles sèches enlève 180–190 kg N, 100–150 kg K2O et 10–30 kg P2O5.
Maladies et ravageurs
Très peu de maladies et de ravageurs attaquent le henné. Une pourriture noire des racines provoquée par Corticium koleroga et une maladie des taches foliaires causée par la bactérie Xanthomonas lawsoniae ont été signalées dans l'ouest de l'Inde.
Récolte
Les plantes sont généralement récoltées 2–4 fois par an à partir de la deuxième année en culture intensive. La récolte débute 1 ou 2 ans plus tard en culture extensive. A la première récolte, les plantes sont coupées à environ 10–15 cm du sol, ensuite elles sont coupées au niveau du sol. La récolte s’effectue lorsque les boutons floraux commencent à apparaître.
Rendement
On dispose sur les rendements de très peu de statistiques dignes de foi. En culture irriguée, le henné peut produire 2500–3000 kg/ha par an de feuilles sèches, et jusqu’à 4000 kg/ha dans des conditions optimales. En culture pluviale en Inde septentrionale, des rendements de 700–1500 kg/ha sont obtenus.
Traitement après récolte
Dans de nombreuses régions, les feuilles fraîches sont cueillies dans le jardin familial au fur et à mesure des besoins et utilisées telles quelles. Dans le monde arabe et en Inde, les rameaux feuillés sont récoltés et mis à sécher, puis les feuilles sont séparées des rameaux en tapant dessus ; les bâtons secs peuvent être laissés autour du champ en guise de haie. Le séchage (jusqu’à environ 10% d’humidité) doit être rapide et se faire de préférence à l’ombre pour conserver la couleur verte des feuilles, gage de bonne qualité. Des feuilles vertes séchées sont privilégiées pour la coloration des mains et des pieds, des feuilles marron (séchées moins rapidement) pour les cheveux. En raison des meilleures conditions de séchage, les feuilles récoltées durant la saison sèche et chaude sont de meilleure qualité que celles issues de la saison des pluies. Pour l’exportation, les feuilles séchées sont conditionnées en balles de 50 kg (à destination de l’Europe occidentale) ou bien les feuilles réduites en poudre sont mises en cartons de 25–50 kg avec des sachets de 100–500 g destinés à la vente directe au détail (sur les marchés du Proche-Orient). La plupart des négociants préfèrent les feuilles séchées, car leur falsification est moins facile. Les demandes de qualité et de pureté varient énormément d’un pays à l’autre et d’un usage à l’autre. Si l’odeur joue aussi son rôle, on préfère un mélange de feuilles et de fleurs ; si on souhaite une coloration noire, on préfèrera un mélange de feuilles de henné et d’indigo. Dans tous les cas, le henné doit être entreposé dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
Ressources génétiques
Il ne semble pas exister de collections de ressources génétiques de henné. La collecte est fortement recommandée pour sauvegarder l’immense variation génétique que présentent les cultivars traditionnels, et qui est souvent associée avec le lieu de production.
Sélection
La sélection doit se concentrer sur des cultivars fiables dotés d’un rendement et d’une qualité élevés et adaptés à divers milieux écologiques.
Perspectives
Du fait de sa très faible toxicité et de ses traditions solidement enracinées, le henné est l’un des rares colorants naturels à faire l’objet d’une demande toujours considérable. La recherche actuelle de colorants naturels inoffensifs pourrait élargir ses utilisations présentes. Si l’on accordait plus d’importance à la sélection de cultivars ayant une teneur en lawsone élevée et à l’amélioration des techniques de séchage et de traitement, il serait possible d’étendre la production commerciale du henné à des zones plus humides. En effet, la production commerciale serait réalisable dans la plupart des pays d’Afrique, mais il faut être très vigilant quant à la qualité, aux impératifs de l’emballage ainsi qu’aux structures commerciales.
Références principales
- Aubaile Sallenave, F., 1982. Les voyages du henné. Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquée 29: 123–178.
- Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp.
- Cardon, D., 2003. Le monde des teintures naturelles. Belin, Paris, France. 586 pp.
- Green, C.L., 1995. Natural colourants and dyestuffs. Non-wood forest products 4. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. (6 separately numbered chapters and an appendix; also available on internet http://www.fao.org/ docrep/V8879E/ V8879e00.htm). December 2007.
- Kolarkar, A.S., Singh, N. & Shankarnarayanan, K.A., 1981. Note on Mehendi (Lawsonia inermis L.) cultivation in normal and degraded lands of western Rajastan. Indian Journal of Soil Conservation 9: 71–74.
- Lemordant, D. & Forestier, J.P., 1983. Usages médicinaux traditionels et propriétés pharmacologiques de Lawsonia inermis L., Lythracées. Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquée 30: 69–89.
- Lemordant, D. & Forestier, J.P., 1983. Commerce et henné. Identification, contrôle, fraudes, additifs. Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquée 30: 283–310.
- Oyen, L.P.A., 1991. Lawsonia inermis L. In: Lemmens, R.H.M.J. & Wulijarni-Soetjipto, N. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 3. Dye and tannin producing plants. Pudoc, Wageningen, Netherlands. pp. 83–86.
- Scarone, F., 1939. Le henné dans le monde Musulman. L’Agronomie Coloniale 28: 97–107, 129–140.
- Verdcourt, B., 1994. Lythraceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 62 pp.
Autres références
- Beentje, H.J., 1994. Kenya trees, shrubs and lianas. National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya. 722 pp.
- Boutique, R., 1967. Lythraceae. In: Flore du Congo, du Ruanda et du Burundi. Spermatophytes. Jardin botanique national de Belgique, Brussels, Belgium. 27 pp.
- CSIR, 1962. The wealth of India. A dictionary of Indian raw materials and industrial products. Raw materials. Volume 6: L–M. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India. 483 pp.
- Decary, R., 1946. Plantes et animaux utiles de Madagascar. Annales du Musée Colonial de Marseille, 54e année, 6e série, 4e volume, 1er et dernier fascicule. 234 pp.
- Fernandes, A., 1978. Lythraceae. In: Launert, E. (Editor). Flora Zambesiaca. Volume 4. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 276–323.
- Gilbert, M.G. & Thulin, M., 1993. Lythraceae. In: Thulin, M. (Editor). Flora of Somalia. Volume 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae (Annonaceae-Fabaceae). Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. pp. 194–198.
- Gilbert, M.G., 2000. Lythraceae (including Punicaceae). In: Edwards, S., Mesfin Tadesse, Demissew Sebsebe & Hedberg, I. (Editors). Flora of Ethiopia and Eritrea. Volume 2, part 1. Magnoliaceae to Flacourtiaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 394–408.
- Gurib-Fakim, A., Guého, J. & Bissoondoyal, M.D., 1996. Plantes médicinales de Maurice, tome 2. Editions de l’Océan Indien, Rose-Hill, Mauritius. 532 pp.
- Keay, R.W.J., 1954. Lythraceae. In: Keay, R.W.J. (Editor). Flora of West Tropical Africa. Volume 1, part 1. 2nd Edition. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. pp. 163–166.
- Kerharo, J. & Adam, J.G., 1974. La pharmacopée sénégalaise traditionnelle. Plantes médicinales et toxiques. Vigot & Frères, Paris, France. 1011 pp.
- Kokwaro, J.O., 1993. Medicinal plants of East Africa. 2nd Edition. Kenya Literature Bureau, Nairobi, Kenya. 401 pp.
- Perrier de la Bâthie, H., 1954. Lythracées (Lythraceae). Flore de Madagascar et des Comores (plantes vasculaires), familles 147–151. Firmin-Didot et cie., Paris, France. 26 pp.
- Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962. The medicinal and poisonous plants of southern and eastern Africa. 2nd Edition. E. and S. Livingstone, London, United Kingdom. 1457 pp.
- Wolf, R., Wolf, D., Matz, H. & Orion, E., 2003. Cutaneous reaction to temporary tattoos. Dermatology Online Journal 9(1): 3.
Sources de l'illustration
- Oyen, L.P.A., 1991. Lawsonia inermis L. In: Lemmens, R.H.M.J. & Wulijarni-Soetjipto, N. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 3. Dye and tannin producing plants. Pudoc, Wageningen, Netherlands. pp. 83–86.
Auteur(s)
- G. Aweke, P.O. Box 4278, Addis Ababa, Ethiopia
- Suzanne Tapapul Lekoyiet, c/o Wolfgang Heutzen, District Agriculture Office, P.O. Box 19, Kilifi, Kenya
Citation correcte de cet article
Aweke, Getachew & Tapapul Lekoyiet, Suzanne, 2005. Lawsonia inermis L. In: Jansen, P.C.M. & Cardon, D. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 18 décembre 2024.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.