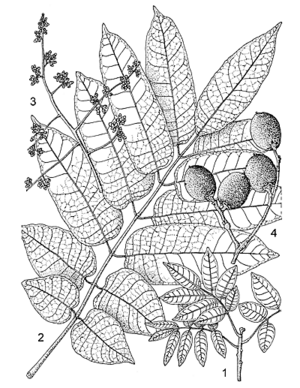Canarium madagascariense (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Céréale / légume sec | |
| Fruit | |
| Stimulant | |
| Huile essentielle / exsudat | |
| Médicinal | |
| Bois d'œuvre | |
| Bois de feu | |
| Ornemental | |
| Sécurité alimentaire | |
Canarium madagascariense Engl.
- Protologue: A.DC., Monogr. phan. 4: 111 (1883).
- Famille: Burseraceae
Synonymes
- Canarium pulchebracteatum Guillaumin (1909).
Noms vernaculaires
- Ramy, aramy (Fr).
- Mpafu, mbani (Sw).
Origine et répartition géographique
Canarium madagascariense est présent en Tanzanie, au Mozambique et à Madagascar.
Usages
A Madagascar, où Canarium madagascariense est connu sous le nom de “ramy”, le bois est utilisé pour la fabrication de pirogues, de boîtes, pour la caisserie, la construction, les manches d’outils, les allumettes, le mobilier ordinaire et les parties cachées des beaux meubles, les placages, le contreplaqué, les panneaux de fibres et les panneaux de particules. Il conviendrait également pour les menuiseries, les boiseries intérieures, le tournage, et quelquefois pour la parqueterie, les poteaux et les pilotis. Sec, le bois de cœur sert à faire des torches, et le bois à fabriquer du charbon de bois.
Les fruits sont consommés, notamment par les enfants, de même que les graines grillées que l’on mange comme l’arachide. La résine sert de colle pour calfater les bateaux, et pour piéger les oiseaux et les petits mammifères. Elle a été utilisée pour les parfums et les peintures et l’est toujours dans la confection de l’encens qui est employé lors des cérémonies religieuses. C’est un stimulant dont l’activité se voit renforcée lorsqu’on la met à mariner dans l’alcool. La résine sert en médecine à traiter les troubles urinaires, les caries dentaires, les rhumatismes, les lésions, et comme désinfectant. Après l’avoir chauffée, on en inhale la vapeur pour soigner les maux de tête et d’autres douleurs, et un bain de vapeur protègerait quant à lui des infections. La résine est quelquefois employée comme insecticide. Canarium madagascariense est utilisé comme arbre d’ornement et d’ombrage.
Production et commerce international
De temps à autre, Madagascar exporte du bois.
Propriétés
Le bois de cœur est brun rosé ; il n’est pas nettement distinct de l’aubier grisâtre, qui atteint 5 cm d’épaisseur. Sur une coupe fraîche, le bois a souvent un reflet bleuâtre. Le fil peut être droit mais il est assez souvent contrefil ou spiralé, le grain moyen à grossier. Le bois est lustré et contient une oléorésine.
Le bois a une densité de 510–690 kg/m³ à 12% d’humidité. Il sèche bien à l’air. Des planches de 25 mm d’épaisseur peuvent sécher jusqu’à 30% d’humidité en 2 mois dans les basses terres humides de Madagascar, contre environ 1 mois en altitude. Les taux de retrait sont élevés, de l’état vert à anhydre ils sont de (2,8–)5,1–8,0% dans le sens radial et de (6,4–)7,5–10,8% dans le sens tangentiel.
A 12% d’humidité, le module de rupture est de 105–162 N/mm², le module d’élasticité de 10 300–14 800 N/mm², la compression axiale de 41–56(–65) N/mm², le cisaillement de 5–12 N/mm², le fendage de (6–)12–23 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de (1,8–)2,2–4,0.
Le bois est parfois difficile à scier à cause de la présence de silice en proportion élevée, mais se travaille généralement bien, avec seulement un léger désaffûtage des lames de coupe. Il se cloue bien, mais les caractéristiques de tenue des clous sont médiocres. Il se colle facilement, se peint et se teint bien, les caractéristiques de déroulage sont bonnes, mais l’emploi d’enduit bouche-pores est recommandé.
Le bois n’est pas durable, car il est sensible aux attaques d’insectes, notamment de termites, et de champignons. L’aubier est sensible aux Lyctus. Le bois de cœur est extrêmement rebelle à l’imprégnation, alors que l’aubier peut être traité avec des produits de préservation. Le bois résiste à l’eau de mer.
La pulpe du fruit est légèrement sucrée et contient jusqu’à 60% de matière grasse.
Description
- Arbre caducifolié, dioïque, de moyenne à assez grande taille atteignant 37 m de haut ; fût rectiligne, dépourvu de branches jusqu’à une hauteur de 27 m, atteignant 200 cm de diamètre, souvent à contreforts ; surface de l’écorce lisse ou rugueuse, fissurée, brune ou grisâtre, écorce contenant une résine à l’odeur de térébenthine, blanche, claire virant au jaunâtre en durcissant ; cime arrondie, à branches étalées ; jeunes branches, pétiole, rachis et inflorescence couverts de poils ferrugineux.
- Feuilles alternes, composées imparipennées à 2–9 paires de folioles, jusqu’à 25(–55) cm de long ; stipules absentes ; pétiole atteignant 7 cm de long ; pétiolules de 0,5–3 cm de long, poilus ; folioles opposées, ovales-oblongues à oblongues, de 4–20 cm × 2,5–10 cm, les paires inférieures de petite taille et souvent en forme de stipules, arrondies à légèrement cordées à la base, vaguement acuminées à l’apex, à bord entier ou ondulé, glabres, mais nervure médiane densément poilue au-dessous, pennatinervées à 7–20 paires de nervures latérales.
- Inflorescence : panicule terminale ou axillaire, étalée, atteignant 35 cm de long (inflorescences femelles plus petites que les mâles), fleurs par grappes de 6–15.
- Fleurs unisexuées, régulières ; pédicelle de 1(–6) mm de long ; calice de 2–4(–8) mm de long, campanulé, 3-lobé, densément poilu à l’extérieur ; pétales 3, libres, oblongs, d’environ 5(–10) mm × 3(–8) mm, carénés, blancs, poilus à l’extérieur ; étamines 6, de 2–3 mm de long, réduites chez les fleurs femelles ; ovaire supère, 3-loculaire, absent ou atrophié chez les fleurs mâles.
- Fruit : drupe ovoïde-ellipsoïde atteignant 5,5 cm × 3 cm, violette à maturité, indéhiscente, à pulpe jaune, aromatique, charnue, renfermant un noyau trigone de 2–3 cm × 1,5–2 cm, pourvu de 3 petites crêtes sur chaque côté, contenant jusqu’à 3 graines.
- Graines comprimées, étroitement ovoïdes, atteignant 2,5 cm × 1 cm, brunes.
- Plantule à germination épigée ; cotylédons divisés en 3 folioles linéaires-elliptiques, folioles latérales parfois également profondément divisées.
Autres données botaniques
Le genre Canarium comprend près de 80 espèces réparties dans les régions très humides des tropiques de l’Ancien Monde ; il est très commun en Asie du Sud-Est, mais ne compte que 3–4 espèces en Afrique tropicale. Néanmoins, le genre est à l’heure actuelle en cours de révision, et selon des estimations préliminaires, une trentaine d’espèces seraient présentes à Madagascar, la plupart devant encore être décrites.
Canarium madagascariense est extrêmement variable, à tel point qu’il a quelquefois été divisé en plusieurs espèces et types de bois (comme le “ramy blanc” et le “ramy rouge”). Au sein de Canarium madagascariense, on a tenté de distinguer plusieurs sous-espèces, avec la subsp. madagascariense (synonymes : Canarium liebertianum Engl., Canarium multiflorum Engl.) que l’on rencontre en Afrique de l’Est et à Madagascar, la subsp. obtusifolium (Scott-Elliot) Leenh. (synonymes : Canarium boivinii Engl., Canarium obtusifolium Scott-Elliot) et la subsp. bullatum Leenh. présente uniquement à Madagascar.
Canarium paniculatum
Canarium paniculatum (Lam.) Benth. ex Engl. (nom vernaculaire : “bois colophane”) est un arbre qui atteint 25 m de haut et dont le fût mesure jusqu’à 2 m de diamètre. Il est endémique de Maurice, où on le trouve parfois dans les vestiges de forêts primaires en altitude. Son bois a été utilisé en construction. Sa résine est connue sous le nom d’ “élémi de Maurice”. On applique un cataplasme de feuilles ainsi que la résine sur les parties du corps atteintes de rhumatismes ; on applique aussi un cataplasme de feuilles sur les ulcérations. Des extraits de la tige, du bois et de l’écorce ont montré une activité antibactérienne. Canarium paniculatum est désormais particulièrement menacé et classé comme “en danger” dans la Liste rouge 2007 de l’UICN.
Anatomie
Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :
- Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes.
- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7–10 μm) ; 27 : ponctuations intervasculaires grandes (≥ 10 μm) ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres) ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100–200 μm ; 47 : 5–20 vaisseaux par millimètre carré ; 56 : thylles fréquents.
- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65 : présence de fibres cloisonnées ; 68 : fibres à parois très fines ; 69 : fibres à parois fines à épaisses.
- Parenchyme axial : 75 : parenchyme axial absent ou extrêmement rare ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 92 : quatre (3–4) cellules par file verticale.
- Rayons : 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4–12 rayons par mm. Eléments sécrétoires et variantes cambiales : 130 : canaux radiaux.
- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées des rayons.
Croissance et développement
A Madagascar, Canarium madagascariense fleurit principalement en octobre–janvier. Tant les fruits que les graines sont une composante importante du régime alimentaire des lémuriens et des autres petits mammifères.
Ecologie
A Madagascar, Canarium madagascariense est répandu mais disséminé dans les forêts humides et sèches, notamment en bordure de cours d’eau, depuis le niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude. En Tanzanie, il est rare dans les vestiges de forêts sur sols sablonneux dans les vallées larges, depuis le niveau de la mer jusqu’à 300 m d’altitude, dans des endroits où la pluviométrie annuelle moyenne avoisine les 1000 mm.
Gestion
Dans un inventaire de la forêt mené au nord-ouest de Madagascar (220 m d’altitude), une parcelle d’un hectare contenait 34 arbres de Canarium madagascariense ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 cm.
Ressources génétiques
Canarium madagascariense semble au bord de l’extinction en Tanzanie, alors qu’il n’apparaît pas menacé à Madagascar.
Perspectives
A Madagascar, Canarium madagascariense est un arbre à usages multiples très précieux, et en dépit de la durabilité médiocre de son bois, c’est une essence indigène prisée pour l’exploitation forestière commerciale à Madagascar, en raison de la taille imposante de l’arbre. Il serait judicieux d’explorer les possibilités qu’offrirait la plantation de cette espèce, mais on ne dispose d’aucune information sur les techniques de multiplication et les pratiques de gestion adaptées. C’est pourquoi il convient d’approfondir les recherches dans ces domaines.
Références principales
- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.
- Guéneau, P. & Guéneau, D., 1969. Propriétés physiques et mécaniques des bois malgaches. Cahiers scientifiques No 2, Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 51 pp.
- Gillett, J.B., 1991. Burseraceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 95 pp.
- Guéneau, P., Bedel, J. & Thiel, J., 1970–1975. Bois et essences malgaches. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 150 pp.
- Leenhouts, P.W., 1959. Revision of the Burseraceae of the Malaysian area in a wider sense. 10a. Canarium Stickm. Blumea 9(2): 275–647.
- Parant, B., Chichignoud, M. & Rakotovao, G., 1985. Présentation graphique des caractères des principaux bois tropicaux. Tome 5. Bois de Madagascar. CIRAD, Montpellier, France. 161 pp.
- Perrier de la Bâthie, H., 1946. Burséracées (Burseraceae). Flore de Madagascar et des Comores (plantes vasculaires), famille 106. Imprimerie Officielle, Tananarive, Madagascar. 50 pp.
- Raharimampionona, J., 2003. Canarium madagascariense. Ravintsara 1(3): 15.
- Raharimampionona, J., Phillipson, P.B., Daly, D.C. & Lowry, P.P., 2007. Taxonomic studies on Burseraceae in Madagascar. Abstracts of the 18th AETFAT congress, Yaoundé, Cameroon, 26 February–2 March 2007. p. 44.
- Sallenave, P., 1971. Propriétés physiques et mecaniques des bois tropicaux. Deuxième supplément. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 128 pp.
Autres références
- Andriamahery, M., 1994. Aperçu sur l’utilisation des plantes médicinales par la communauté rurale de la région d’Andasibe. Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en médecine, Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine Université d'Antananarivo, Madagascar. 74 pp.
- Andriamihaja, S., 1986. Essai d’inventaire des plantes medicino-dentaires malgaches (Tome I). Rapport du Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle & Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique pour le Développement de la République Malagasy. 316 pp.
- Boiteau, P., Boiteau, M. & Allorge-Boiteau, L., 1999. Dictionnaire des noms malgaches de végétaux. 4 Volumes + Index des noms scientifiques avec leurs équivalents malgaches. Editions Alzieu, Grenoble, France.
- Coode, M.J.E., 1979. Burséracées. In: Bosser, J., Cadet, T., Julien, H.R. & Marais, W. (Editors). Flore des Mascareignes. Familles 64–68. The Sugar Industry Research Institute, Mauritius, l’Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, Paris, France & Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 8 pp.
- d’Amico, C. & Gautier, L., 2000. Inventory of a 1-ha lowland rainforest plot in Manongarivo (NW Madagascar). Candollea 55(2): 319–340.
- Gachathi, N., 1999. Recent advances on classification and status of the main gum-resin producing species in the family Burseraceae. In: Mugah, J.O., Chikamai, B.N., Mbiru, S.S. & Casadei, E. (Editors). Conservation, management and utilization of plant gums, resins, and essential oils. Proceedings of a Regional conference for Africa held in Nairobi, Kenya 6–10 October 1997. pp. 18–22.
- Grenfell, S., 1999. Complexe Manongarivo / Tsaratanana. Plan de gestion. Rapport de l'Association National pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP). pp. 39–42.
- Guéneau, P., 1971. Bois de Madagascar. Possibilités d’emploi. Centre Technique Forestier Tropical, Antananarivo, Madagascar. 75 pp.
- Gurib-Fakim, A. & Brendler, T., 2004. Medicinal and aromatic plants of Indian Ocean Islands: Madagascar, Comoros, Seychelles and Mascarenes. Medpharm, Stuttgart, Germany. 568 pp.
- Gurib-Fakim, A., Marie, D. & Narod, F., 2005. The pharmacological properties of the isolated bioactive compounds from endemic medicinal plants of Mauritius. Acta Horticulturae 675: 133–137.
- Holloway, L., 2004. Ecosystem restoration and rehabilitation in Madagascar. Ecological Restoration 22(2): 113–119.
- InsideWood, undated. [Internet] http://insidewood.lib.ncsu.edu/search/. May 2007.
- Lovett, J.C., Ruffo, C.K., Gereau, R.E. & Taplin, J.R.D., 2007. Field guide to the moist forest trees of Tanzania. [Internet] Centre for Ecology Law and Policy, Environment Department, University of York, York, United Kingdom. http://celp.org.uk/projects/tzforeco/. January 2008.
- Raharimampionona, J., 2006. Canarium. A Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar. [Internet] http://www.efloras.org/ florataxon.aspx?flora_id=12&taxon_id=105501. January 2008.
- Rahelinoro, F.M., 1994. Etude des plantes médicinales utilisées dans la lutte contre la “fièvre” dans la réserve spéciale de Manongarivo et environs - Ambanja. Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en médecine, Etablissement d’Enseignement Supérieur des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine, Université d’Antananarivo, Madagascar. 70 pp.
- Sallenave, P., 1964. Propriétés physiques et mécaniques des bois tropicaux. Premier supplément. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 79 pp.
- Strahm, W., 1998. Canarium paniculatum. In: IUCN. 2007 Red list of threatened species. [Internet] http://www.iucnredlist.org. January 2008.
- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan, 248 pp.
- Vasey, N., 1997. How many red ruffed lemurs are left? International Journal of Primatology 18(2): 207–216.
- Wild, H., 1963. Burseraceae. In: Exell, A.W., Fernandes, A. & Wild, H. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 2, part 1. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. pp. 263–285.
Sources de l'illustration
- Perrier de la Bâthie, H., 1946. Burséracées (Burseraceae). Flore de Madagascar et des Comores (plantes vasculaires), famille 106. Imprimerie Officielle, Tananarive, Madagascar. 50 pp.
Auteur(s)
- M. Brink, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands
Citation correcte de cet article
Brink, M., 2008. Canarium madagascariense Engl. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 22 décembre 2024.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.