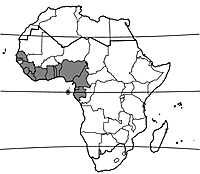Baphia nitida (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Colorant / tanin | |
| Médicinal | |
| Bois d'œuvre | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Auxiliaire | |
| Fibre | |
Baphia nitida Lodd.
- Protologue: Bot. Cab. 4(7) : t. 367 (1820).
- Famille: Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
- Nombre de chromosomes: 2n = 44
Noms vernaculaires
- Bois de cam, bois rouge (Fr).
- Camwood (En).
Origine et répartition géographique
Baphia nitida se rencontre depuis le Sénégal jusqu’au Gabon. Il est souvent cultivé près des villages, autrefois comme bois tinctorial notamment en Sierra Leone et au Liberia, et de nos jours le plus souvent comme arbre d’ombrage ornemental, et pour former des haies de clôture.
Usages
Le bois de cœur (bois de cam) et les racines de Baphia nitida fournissent une teinture rouge qui était jusqu’à une date récente utilisée localement pour teinter le raphia et les tissus de coton. Le nom de “bois de cam” vient très probablement du nom de “kam” en langue temne ou bulom en Sierra Leone. Le bois de cam a été exporté à grande échelle vers l’Europe à partir du XVIIe siècle et vers l’Amérique du Nord à partir du XVIIIe siècle, et a constitué l’une des principales teintures de “bois rouge” utilisées pour la laine, le coton et la soie. Il était considéré par les teinturiers européens et américains comme ayant un pouvoir colorant 3–4 fois plus élevé que les autres bois rouges “insolubles” qu’ils utilisaient. Dans l’industrie lainière, le bois de cam était utilisé non seulement pour obtenir des teintes rouges mais également une large gamme de teintes allant du rougeâtre au brun foncé, comme le “gris souris” (“drab”), le “brun boueux” (“muddy brown”) et la “fumée de Londres” (“London smoke”), le plus souvent en combinaison avec d’autres bois tinctoriaux. En petites quantités, il entrait dans la composition de formules de couleurs vert bronze, et on l’utilisait comme teinture de fond, suivi par un bain de teinture de bois de campêche (Haematoxylum campechianum L.). On l’a utilisé jusqu’au début du XXe siècle dans l’industrie lainière pour obtenir des couleurs gris foncé et noires. C’était une source importante de couleurs rouge vif à rouge foncé dans la grande industrie européenne des cotons imprimés, par ex. pour teindre les bandanas en “mock Turkey red”, et on l’utilisait aussi, principalement au Royaume-Uni, pour teindre la soie en rose, “brun acide” et “bordeaux clair”. En Afrique occidentale, le bois de cœur réduit en poudre est couramment utilisé comme peinture corporelle rouge, et on en fait une pâte qui est très utilisée comme cosmétique pour la peau, par ex. au Liberia, en Côte d’Ivoire et au Ghana. Utilisé en peinture corporelle, il est réputé avoir des pouvoirs magiques : les guérisseurs guérés et krous en Côte d’Ivoire l’utilisent pour des cérémonies religieuses, et au Ghana les guerriers qui avaient tué un ennemi ou un léopard se peignaient le front avec du bois de cam pour des danses rituelles.
En trempant les racines séchées et broyées dans de l’eau, on obtient un liquide rouge qui est utilisé pour peindre les meubles. Dans le sud du Bénin et le sud-ouest du Nigeria, les masques cérémoniels yoroubas sont peints en rouge foncé avec une décoction du bois.
Le bois de Baphia nitida est utilisé en construction sous forme de poteaux et de chevrons, et il sert à confectionner des moyeux de roue, des ustensiles tels que cannes, mortiers, pilons, manches et instruments agricoles. Il était autrefois exporté en Europe pour le tournage et l’ébénisterie. On plante Baphia nitida comme arbre ornemental pour l’ombrage, ou en haies de clôture. Les feuilles sont employées comme fourrage, et dans le sud du Ghana on recommande de le propager dans les zones d’élevage en raison de sa bonne appétibilité, de sa disponibilité continue et de sa haute teneur en protéines. Au Nigeria, les graines sont consommées par les Igbos, et les rameaux sont utilisés comme bâtons à mâcher. Dans certaines régions, l’arbre est considéré comme sacré, doté du pouvoir de protéger contre les mauvais esprits et d’attirer les bons. Au Nigeria, les Tivs utilisent la teinture rouge pour colorer en rouge l’intérieur d’une gourde préparée pour servir de ruche, afin d’inciter les essaims à s’y installer, et les chasseurs de miel yoroubas se frottent le corps avec la pâte colorante pour prévenir les piqûres d’abeilles.
On utilise les feuilles ou du jus extrait des feuilles contre les dermatoses parasitaires, et on boit une infusion de feuilles pour soigner l’entérite et autres affections gastro-intestinales. Au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Nigeria, les feuilles et l’écorce sont considérées comme hémostatiques et anti-inflammatoires, et on les emploie pour soigner les plaies et blessures. En Côte d’Ivoire, on absorbe les feuilles réduites en poudre avec du vin de palme ou de la nourriture pour soigner les maladies vénériennes, et on utilise du jus des feuilles comme collyre contre la jaunisse. Un extrait de jeunes feuilles additionné de sel et de piment est utilisé en gouttes nasales contre les maux de tête. Au Nigeria, le bois de cœur réduit en poudre sert à préparer une pommade avec du beurre de karité (tiré des graines de Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.), que l’on applique sur les articulations raidies et gonflées, les foulures et les affections rhumatismales. En Sierra Leone, on boit une décoction d’écorce pour soulager les douleurs cardiaques, et l’écorce et les feuilles servent à préparer un lavement contre la constipation. Au Nigeria et au Ghana, les racines séchées et pilées, mélangées avec de l’eau et de l’huile, fournissent un médicament contre un champignon semblable à la teigne qui attaque les pieds. L’écorce des racines, finement moulue et mélangée à du miel, sert à soigner l’asthme. En Côte d’Ivoire, on boit un extrait de feuilles de bois de cam et de Senna occidentalis (L.) Link contre l’asthme, tandis qu’au Bénin on absorbe une décoction de feuilles contre la jaunisse et le diabète ; en mélange avec des feuilles de Morinda lucida Benth., c’est un traitement contre la stérilité des femmes et les règles douloureuses. En traitement externe, en association avec Cissus quadrangularis L., on l’emploie contre les fractures osseuses. Une décoction d’écorce sert à soigner l’épilepsie.
Production et commerce international
Jusque vers les années 1950, on exportait de grandes quantités de bois de cam, notamment de la Sierra Leone et du Liberia vers l’Europe et les Etats-Unis, tant pour la teinture que comme bois de tournage et d’ébénisterie. Cette exportation se faisait sous forme de billes courtes plutôt que de poudre ou d’extrait, en principe pour faciliter le contrôle de qualité.
Propriétés
La teinture se trouve dans le bois de cœur, qui est souvent de faibles dimensions. Elle y est à des degrés variables de concentration, pouvant aller jusqu’à 23%. Elle est soluble dans l'alkali et dans l’alcool, et beaucoup moins dans l’eau. Les principales substances tinctoriales sont les dimères isoflavonoïdes-flavonoïdes que sont les santalines A et B et les santarubines A, B et C, mais divers autres composés tels que acide baphique, baphiine, désoxysantarubine, homoptérocarpine, maackiaïne, ptérocarpine et santal participent probablement aux propriétés colorantes. Dans l’Index des couleurs, la teinture porte le numéro 75560, et elle est classée comme Rouge naturel 22, en même temps que d’autres bois rouges.
Une teinte rouge peut apparaître sur une blessure de l’écorce, et celle-ci trempée dans l’eau produit aussi une teinture rouge.
Dans les feuilles on trouve des saponines, des hétérosides flavonoïdes et des tanins véritables. Une pommade préparée à partir des feuilles a montré une activité anti-inflammatoire sur des souris et des rats, ce qui justifie son usage externe en médecine traditionnelle. Des extraits de feuilles fraîches inhibent la digestion chez les souris et les rats, et montrent des effets antidiarrhéiques. Des extraits de feuilles ont également montré une action analgésique chez les souris.
La teneur totale en matière sèche de feuilles et de jeunes rameaux broutés par des bovins au Ghana était d’environ 20%. Au Nigeria, on a trouvé par 100 g de matière sèche approximativement : protéines brutes 19 g, extrait à l’éther 2,5 g, cendres 4,3 g, fibres brutes 23 g, extractif non azoté 51 g, fibres détergentes acides 57 g, lignine 13 g, cellulose 29 g, Ca 0,4 g, Mg 0,2 g, K 1 g, P 0,2 g, Fe 23 mg, Cu 20 mg et Zn 5 mg.
Sur une coupe fraîche, l’aubier est blanc jaunâtre, dégageant une odeur désagréable, fonçant à peine au séchage. Le bois de cœur est brun pâle à l’état frais, virant rapidement au rouge ou orange foncé par exposition à l’air. Il est extrêmement dur, lourd et durable, à fil serré et à grain fin. Il se sculpte et se tourne bien, et se rabote aisément.
Falsifications et succédanés
Les succédanés du bois de cam sont les teintures obtenues à partir d’autres bois rouges insolubles, tels que le bois de cam du Bénin (Baphia pubescens Hook.f.) et le padouk (Pterocarpus soyauxii Taub. et Pterocarpus erinaceus Poir.) provenant d’Afrique, le bois de santal (Pterocarpus santalinus L.f.) de l’Inde, et le narra (Pterocarpus indicus Willd.) de Myanmar et des Philippines.
Description
- Arbuste érigé à tiges multiples ou petit arbre atteignant 9 m de hauteur, portant des rameaux glabres ou densément pubescents.
- Feuilles alternes, simples et entières ; stipules rapidement caduques ; pétiole de 1–4 cm de long, fortement épaissi à la base et au sommet ; limbe ovale, elliptique, obovale ou lancéolé, de 5–21 cm × 3–9 cm, à base arrondie à cunéiforme, à apex acuminé, légèrement coriace, presque glabre, pennatinervé.
- Fleurs en fascicules axillaires, portant 1–5 fleurs, bisexuées, papilionacées ; pédicelle fin, de 3–17 mm de long ; calice spathacé, de 8–10 mm de long, glabre mais avec une touffe de poils bruns à l’apex ; corolle à étendard suborbiculaire, de 1–2 cm de diamètre, blanche avec un centre jaune, ailes et carène blanches avec un sac près de la base ; étamines 10, filets inégaux, libres, jusqu’à 7 mm de long ; ovaire supère, sessile, glabre, portant parfois une rangée de poils argentés le long du bord dorsal, 1-loculaire, style courbé, filiforme, stigmate petit.
- Fruit : gousse comprimée de 8–16,5 cm × 1–1,5 cm, pointue aux deux extrémités, contenant 1–4 graines.
- Graines à contour presque circulaire, de 1–1,5 cm de diamètre, brunes.
Autres données botaniques
Le genre Baphia comprend environ 45 espèces, pour la plupart confinées à l’Afrique tropicale, la majorité étant présentes au Nigeria et au Cameroun.
Baphia pubescens
Le bois de cam du Bénin, Baphia pubescens Hook.f. (synonyme : Baphia bancoensis Aubrév.), a une répartition analogue à celle de Baphia nitida, mais s’étendant à la R.D. du Congo, et leurs noms vernaculaires et leurs usages sont plus ou moins interchangeables. Son bois de cœur est également une source de teinture rouge, mais il a été moins exploité. Baphia pubescens diffère de Baphia nitida par ses feuilles, qui sont poilues en dessous, et par son ovaire poilu.
Baphia massaiensis
Dans le nord de la Namibie, on emploie les racines de Baphia massaiensis Taub. subsp. obovata (Schinz) Brummitt comme source de teinture rouge servant à teinter le cuir. Les racines sont broyées, mélangées avec de l’eau, et les peaux sont trempées dans le bain de teinture pendant environ une journée. Autrefois les panses de bœuf que les femmes employaient comme tablier étaient teintes de la même façon, puis tannées et étendues pour les faire sécher. Baphia massaiensis se rencontre depuis le sud de la R.D. du Congo et la Tanzanie jusqu’au nord de l’Afrique du Sud ; il diffère de Baphia nitida par ses longues bractéoles, son ovaire pubescent et l’apex des feuilles qui est habituellement arrondi ou obtus. C’est une espèce extrêmement variable.
Ecologie
Baphia nitida pousse souvent en sous-étage dans les parties les plus humides des régions côtières, dans la forêt pluviale, la forêt secondaire et sur les terres de culture abandonnées, du niveau de la mer jusqu’à 600 m d’altitude.
Multiplication et plantation
Le bois de cam est facile à cultiver, et on peut le multiplier par graines et par boutures. Pour un résultat optimum, les boutures doivent être prélevées sur des parties suffisamment jeunes.
Traitement après récolte
Pour l’utilisation en teinture, on sépare l’aubier du tronc, et on débite le bois de cœur à la scie ou à la hache en morceaux de 30–50 cm de long que l’on fait sécher. Une fois sec, le bois est prêt pour le transport. Pour extraire la teinture, on coupe le bois en morceaux beaucoup plus petits, ou bien on le pulvérise. Etant donné que la teinture ne se dissout pas bien dans l’eau, on fait bouillir le bois pendant 1,5–2 heures dans une solution d’alcool à 45% ou dans une solution de carbonate de sodium (30 g pour 100 g de bois). La solution qui en résulte est ensuite diluée avec de l’eau jusqu’à obtenir la concentration désirée du bain de teinture, qui diffère selon le type de fibres ou de textile à teindre et selon la couleur désirée. En utilisant différents mordants, appliqués avant et après le bain de teinture, et différents mélanges avec d’autres bois tinctoriaux, on peut obtenir une large gamme de couleurs depuis le rouge jusqu’au brun, au vert, au gris, au violet et au noir.
Ressources génétiques
Baphia nitida est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives
Baphia nitida est un arbre à usages multiples : son bois est une source de colorants rouges solides et il est un bois d’œuvre intéressant, son jeune feuillage est une source de fourrage, et le bois comme le feuillage sont utilisés en médecine traditionnelle. Le bois d’œuvre et le fourrage semblent être les deux usages les plus importants à présent, mais l’intérêt croissant pour les teintures naturelles pourrait restaurer la valeur du bois de cam au niveau qu’elle avait autrefois. L’extraction de colorants dans les pays où il pousse, pour produire des extraits liquides ou en poudre, apporterait une forte valeur ajoutée, et permettrait d’utiliser le bois résiduel comme combustible.
Références principales
- Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp.
- Cardon, D., 2003. Le monde des teintures naturelles. Belin, Paris, France. 586 pp.
- Irvine, F.R., 1961. Woody plants of Ghana, with special reference to their uses. Oxford University Press, London, United Kingdom. 868 pp.
- Onwukaeme, N.D., 1995. Anti-inflammatory activities of flavonoids of Baphia nitida Lodd. (Leguminosae) on mice and rats. Journal of Ethnopharmacology 46(2): 121–124.
- Onwukaeme, D.N. & Lot, T.Y., 1992. The effects of Baphia nitida Lodd (Leguminosae) extract on the gastrointestinal tract of rats and mice. Phytotherapy Research 6(3): 129–132.
- Soladoye, M.O., 1985. A revision of Baphia (Leguminosae - Papilionoideae). Kew Bulletin 40: 291–386.
- Ubani, O.N. & Tewe, O.O., 2001. The nutritive value of some tree/shrub leaves as feed for goats. Tropical Science 41: 13–15.
Autres références
- Adjanohoun, E.J. & Aké Assi, L., 1979. Contribution au recensement des plantes médicinales de Côte d’Ivoire. Centre National de Floristique, Abidjan, Côte d’Ivoire. 358 pp.
- Adjanohoun, E.J., Adjakidjè, V., Ahyi, M.R.A., Aké Assi, L., Akoègninou, A., d’Almeida, J., Apovo, F., Boukef, K., Chadare, M., Cusset, G., Dramane, K., Eyme, J., Gassita, J.N., Gbaguidi, N., Goudote, E., Guinko, S., Houngnon, P., Lo, I., Keita, A., Kiniffo, H.V., Kone-Bamba, D., Musampa Nseyya, A., Saadou, M., Sodogandji, T., De Souza, S., Tchabi, A., Zinsou Dossa, C. & Zohoun, T., 1989. Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques en République Populaire du Bénin. Agence de Coopération Culturelle et Technique, Paris, France. 895 pp.
- Barnes, P., 1998. Herbage yields and quality in four woody forage plants in a subhumid environment in Ghana. Agroforestry Systems 42(1): 25–32.
- Mathieson, D.W., Millard, B.J., Powell, J.W. & Whalley, W.B., 1973. The chemistry of the ‘insoluble’ redwoods. Part 11. Revised structures of santalin and santarubin. Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1: Organic and Bio-organic Chemistry 2: 184–188.
- Onwukaeme, D.N. & Lot, T.Y., 1991. A pharmacological evaluation of Baphia nitida Lodd (Leguminosae) ethanolic extract on rats and mice. Phytotherapy Research 5(6): 254–257.
- Rodin, R.J., 1985. The ethnobotany of the Kwanyama Ovambos. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 9: 1–163.
- Surowiec, I., Nowik, W. & Trajanowicz, M., 2004. Identification of ‘insoluble’ red dyewoods by high performance liquid chromatography – photodiode array detection (HPLC-PDA) fingerprinting. Journal of Separation Science 27: 209–216.
- Ubani, O.N., Tewe, O.O. & Moody, L., 2000. Anti-nutritive and toxic factors in trees and shrubs used as browse. Tropical Science 40: 159–161.
Sources de l'illustration
- Soladoye, M.O., 1985. A revision of Baphia (Leguminosae - Papilionoideae). Kew Bulletin 40: 291–386.
Auteur(s)
- D. Cardon, CNRS, CIHAM-UMR 5648, 18, quai Claude-Bernard, 69365 Lyon, Cedex 07, France
- P.C.M. Jansen, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands
Citation correcte de cet article
Cardon, D. & Jansen, P.C.M., 2005. Baphia nitida Lodd. In: Jansen, P.C.M. & Cardon, D. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 3 avril 2025.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.