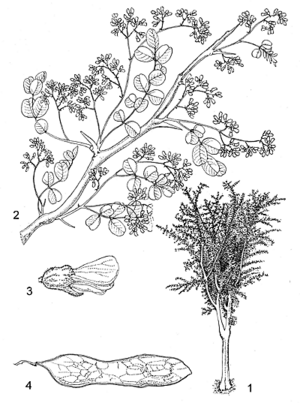Dalbergia melanoxylon (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Glucides / amidon | |
| Médicinal | |
| Bois d'œuvre | |
| Bois de feu | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Auxiliaire | |
| Statut de conservation | |

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
- Protologue: Fl. Seneg. tent. : 227, t. 53 (1832).
- Famille: Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
- Nombre de chromosomes: 2n = 20
Noms vernaculaires
- Grenadille d’Afrique, ébénier du Sénégal (Fr).
- African blackwood, African ebony, African grenadillo, African ironwood, Senegal ebony, zebra wood (En).
- Grenadilha, pau preto (Po).
- Mpingo, kikwaju (Sw).
Origine et répartition géographique
Dalbergia melanoxylon est répandu depuis le Sénégal jusqu’à l’Erythrée, l’Ethiopie et le Kenya, et vers le sud jusqu’à la Namibie, au Botswana, au nord de l’Afrique du Sud et au Swaziland. Il a été introduit en Inde et en Australie.
Usages
Le bois de cœur de Dalbergia melanoxylon (noms commerciaux : African blackwood, African ebony, grenadille d’Afrique, ébène du Sénégal, ébène du Mozambique) était déjà employé par les anciens Egyptiens pour fabriquer des objets façonnés et des meubles tels que trônes et lits d’apparat. Il est très estimé pour les sculptures intriquées, la marqueterie et les ustensiles tels que les équipements de précision, et c’est un des bois favoris pour les instruments de musique, spécialement pour les instruments à vent tels que clarinettes, hautbois, flûtes et cornemuses, en raison de sa couleur sombre, de sa stabilité et de la clarté du son. Les luthiers l’emploient pour les touches, le cordier, la mentonnière, la volute et le bouton. En Afrique, les sculptures en bois de Dalbergia melanoxylon sont très populaires sur les marchés pour touristes, et atteignent des prix élevés. Dans ces sculptures, l’aubier blanc jaunâtre est souvent conservé, contrastant avec le bois de cœur noirâtre. C’est un bois excellent également pour le tournage, et on l’employait autrefois pour la parqueterie. A l’échelle locale, on l’utilise parfois en construction pour les chevrons et les poteaux, et pour des objets tels que cannes de marche, maillets, baguettes de tambour, pointes de flèche, pilons, coupes, assiettes et peignes. Le bois est également utilisé pour la production de charbon de bois et comme bois de feu, bien que sa flamme soit très chaude et puisse endommager les marmites.
Le feuillage et les fruits sont broutés par le bétail, mais non par les chevaux. Les fleurs sont une bonne source de nectar pour les abeilles, et donnent un miel ambre foncé et très parfumé. L’arbre fournit un bon paillis, et peut améliorer le sol par fixation d’azote. On peut l’employer pour prévenir l’érosion en raison de son système racinaire très développé. Il est également utile en brise-vent et en haie vive.
Au Sénégal, l’écorce de la tige et des racines est employée en médecine traditionnelle pour traiter la diarrhée en combinaison avec des fruits de baobab ou de tamarinier. La fumée des racines est inhalée pour le traitement des maux de tête, de la bronchite et des rhumes. Au Soudan, les patients souffrant de rhumatismes sont exposés à la fumée d’un feu de tiges. En Afrique de l’Est, on emploie une décoction des racines pour prévenir les fausses couches, et comme anthelminthique et aphrodisiaque, ainsi que pour le traitement de la blennorragie, des maux d’estomac et des douleurs abdominales. Une décoction d’écorce ou de la poudre d’écorce est employée pour traiter les blessures, et une décoction de feuilles pour soulager les douleurs articulaires. On utilise le jus des feuilles pour traiter les inflammations de la bouche et de la gorge. En outre, des décoctions d’écorce et du jus des feuilles sont des ingrédients de mélanges servant à traiter diverses affections.
Production et commerce international
Le bois de Dalbergia melanoxylon est commercialisé sur le marché international en petits volumes mais à des prix très élevés. La valeur des exportations de bois semi-ouvrés a été estimée en 2002 à US$ 2–3 millions. Les principaux exportateurs sont la Tanzanie et le Mozambique. Le volume annuel moyen d’exportation de grenadille d’Afrique de la Tanzanie au cours de la période 1990–2000 a été de 73,5 m³, principalement sous la forme de petits billots, et en 2000 le prix moyen a été de US$ 10 900 par m³. En 1999, on a estimé qu’il avait été exporté 250 000 sculptures d’une valeur totale de US$ 970 000. Les exportations annuelles moyennes de bois rond de la province de Cabo Delgado au Mozambique (qui produit environ 60% du total du Mozambique) dans la période 1990–2000 ont été de 720 m³. Dans le passé, le Sénégal, le Kenya et le Malawi ont produit des quantités considérables de grenadille d’Afrique, en particulier pour la sculpture artisanale, mais les peuplements ont été considérablement appauvris et les sculpteurs utilisent souvent maintenant d’autres bois, ou utilisent de la grenadille provenant de Tanzanie (au Kenya) ou du Mozambique (au Malawi). L’Afrique du Sud importe des billots aussi bien que des sculptures pour le marché du tourisme, en particulier du Mozambique. La grenadille d’Afrique est principalement exporté vers l’Europe (environ 70%). Les autres importateurs sont les pays d’Asie (environ 20%) et les Etats-Unis (10%). La valeur totale au détail des instruments et produits d’artisanat contenant de la grenadille d’Afrique a été estimée en 2002 à US$ 100 millions.
Propriétés
Le bois de cœur est brun très foncé à noir violacé, parfois avec des raies noires, et contraste abruptement avec l’aubier qui est blanc jaunâtre et d’une épaisseur d’environ 1 cm. Le fil est droit, le grain très fin et régulier. La surface du bois est huileuse.
Le bois est très lourd ; l’aubier a une densité d’environ 1180 kg/m³, et le bois de cœur de 1230–1330 kg/m³ à 12% d’humidité. Le bois est très dur, mais cassant et fissile, et il a la réputation d’avoir souvent des défauts. Il doit être séché à l’air très lentement et complètement pendant 2–3 ans. Les taux de retrait de l’état vert à anhydre sont d’environ 2,9% dans le sens radial et 4,8% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est très stable en service ; sa grande tolérance aux fluctuations des conditions climatiques, alliée à sa nature huileuse, en font un excellent bois pour la fabrication des instruments à vent.
A 12% d’humidité, le module de rupture est de 186–267 N/mm², le module d’élasticité de 12 100–20 600 N/mm², la compression axiale de 69–75 N/mm², le fendage de 27 N/mm, la dureté de flanc Chalais-Meudon de 13–24, et la dureté Janka en bout de 17 850 N.
Le bois est difficile à scier en raison de sa dureté ; les dents de scie s’émoussent rapidement, et il est nécessaire d’utiliser des lames au carbure de tungstène. Il est assez difficile à raboter, mais donne une belle surface lustrée. Des avant-trous sont nécessaires pour le clouage et le vissage. Le bois répond au perçage pour les vis presque aussi bien que les métaux. Les garnitures métalliques sont protégées de la corrosion par la surface huileuse du bois. Les caractéristiques de collage sont assez bonnes, et les caractéristiques de teinture de l’aubier sont bonnes.
Le bois de cœur est très durable, mais l’aubier est sensible aux attaques de bostryches. Le contact avec la fine sciure produite lors du travail du bois peut causer une dermatite allergique de contact. On a supposé que des constituants quinonoïdes, (R)- et (S)-4-méthoxydalbergione, pourraient être les composés responsables. La valeur énergétique du bois est très élevée.
Des extraits d’écorce de Dalbergia melanoxylon ont montré une action antibactérienne et antifongique, ce qui justifie l’application traditionnelle pour le nettoyage des blessures.
Falsifications et succédanés
Le bois de Dalbergia melanoxylon est considéré comme supérieur pour la fabrication des clarinettes, et pratiquement toutes les clarinettes de haute qualité sont faites en grenadille d’Afrique. Cependant, dans le passé, on a employé d’autres bois, en particulier l’ébène d’Amérique (Brya ebenus (L.) DC.) provenant des Indes occidentales, le buis (Buxus spp.), l’ébène (Diospyros spp.), et parfois des Dalbergia spp. d’Amérique tropicale.
Description
- Arbuste ou petit arbre épineux, caducifolié, jusqu’à 12(–20) m de haut, souvent à tiges multiples et très branchu ; fût généralement court, dépourvu de branches jusqu’à 2(–3,5) m de haut, souvent noueux et cannelé, jusqu’à 50(–100) cm de diamètre ; surface de l’écorce blanchâtre à gris pâle ou brun grisâtre, mince, lisse mais devenant rugueuse et fissurée ou écailleuse, écorce interne rose orangé ; cime irrégulière, ouverte ; jeunes rameaux groupés aux nœuds, certains se développant et d’autres restant courts avec une épine terminale, initialement à pubescence courte mais devenant bientôt glabrescents, gris blanchâtre.
- Feuilles disposées en spirale, composées imparipennées avec 7–13(–17) folioles ; stipules de 2–6 mm de long, caduques ; pétiole et rachis presque glabres ; pétiolules de 1–2 mm de long ; folioles alternes à opposées, obovales à elliptiques, de 1–5(–5,5) cm × (0,5–)1–3(–5) cm, coriaces, courtement pubescentes sur la face inférieure mais glabrescentes.
- Inflorescence : panicule terminale ou axillaire de 2–12 cm de long, à ramifications lâches, courtement pubescente à presque glabre, portant de nombreuses fleurs.
- Fleurs bisexuées, papilionacées, de 4–6 mm de long, presque sessiles ; calice campanulé, de 2–3(–4) mm de long, lobes plus courts que le tube, lobe inférieur plus long, lobes supérieurs fusionnés ; corolle blanchâtre, à étendard obovale et à ailes et carène munies d’un onglet ; étamines généralement 9, soudées en tube, mais libres dans leur partie supérieure ; ovaire supère, à stipe distinct à la base, style court.
- Fruit : gousse plate, elliptique à oblongue, papyracée, de 3–7 cm × 1–1,5(–2) cm, à stipe de 3–7 mm de long, glabre, brun grisâtre, à nervation lâche, indéhiscente, renfermant 1–2(–4) graines.
- Graines réniformes.
Autres données botaniques
Dalbergia est un grand genre pantropical qui comprend quelque 250 espèces. L’Asie tropicale et l’Amérique tropicale en ont environ 70 espèces chacune, l’Afrique continentale une cinquantaine, et Madagascar un peu plus d’une quarantaine.
Dalbergia hostilis
Dalbergia hostilis Benth. est une liane épineuse ou un arbuste rampant que l’on rencontre de la Guinée-Bissau à la R.D. du Congo et à l’Angola. Son bois ressemble à celui de Dalbergia melanoxylon, mais il n’est disponible qu’en petites pièces, que l’on utilise pour faire des cannes de marche, des manches d’outils et des petits instruments. En Afrique centrale, on absorbe une décoction de ses racines pour traiter la blennorragie, une macération des épines pour traiter la tuberculose, et des cendres de ramilles mélangées à de l’huile de palme et à du sel pour traiter la toux. En Côte d’Ivoire, on emploie des morceaux de tige contre les maux de dents.
Dalbergia oblongifolia
Le bois de cœur noirâtre de Dalbergia oblongifolia G.Don., liane répartie de la Sierra Leone au Bénin et au Gabon, est également utilisé pour faire des cannes de marche, des manches d’outils et de petits instruments. On applique des cataplasmes de feuilles sur les blessures et les brûlures.
Dalbergia microphylla
Dalbergia microphylla Chiov. est un arbuste légèrement épineux réparti dans le sud de l’Ethiopie, la Somalie, le Kenya et le nord de la Tanzanie. En Afrique de l’Est, son bois est utilisé pour la construction de cases traditionnelles, pour faire des instruments agricoles, ainsi que comme bois de feu et pour la production de charbon de bois. Dalbergia microphylla est employé en Ethiopie comme arbre d’ombrage pour les cultures et comme fourrage, et les Pokots du Kenya mâchent les feuilles pour traiter les ulcères de la bouche.
Dalbergia obovata
Les tiges de Dalbergia obovata E.Mey., liane atteignant 30 m de long ou arbuste à petit arbre jusqu’à 6 m de haut que l’on rencontre de la Tanzanie jusqu’à l’est de l’Afrique du Sud, sont employées pour faire les nasses traditionnelles et les murs de case tressés, et le bois lourd, rougeâtre, sert à faire des cannes et des tabourets. On administre une infusion de racines pour traiter les maux d’estomac et les maux de dents. L’écorce est employée pour traiter les bouches endolories chez les bébés, tandis que la cendre d’écorce est ajoutée au tabac à priser, l’écorce est également utilisée pour faire des cordages. Dalbergia obovata est une plante ornementale de jardin intéressante avec ses inflorescences et infrutescences spectaculaires. Il est brouté par le bétail.
Dalbergia ealaensis
Les tiges de Dalbergia ealaensis De Wild., grande liane de la forêt dense d’Afrique centrale, sont employées pour la construction de cases en R.D. du Congo.
Anatomie
Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :
- Cernes de croissance : (1 : limites de cernes distinctes) ; (2 : limites de cernes indistinctes ou absentes).
- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4–7 μm) ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7–10 μm) ; (27 : ponctuations intervasculaires grandes (≥ 10 μm)) ; 29 : ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50–100 μm ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100–200 μm ; 45 : vaisseaux de deux classes de diamètre distinctes, bois sans zones poreuses ; 47 : 5–20 vaisseaux par millimètre carré ; (48 : 20–40 vaisseaux par millimètre carré) ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cœur.
- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois très épaisses.
- Parenchyme axial : 77 : parenchyme axial en chaînettes ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; (79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)) ; (80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré) ; (82 : parenchyme axial aliforme) ; 86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; (89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales) ; 90 : cellules de parenchyme fusiformes ; 91 : deux cellules par file verticale.
- Rayons : 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; 106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées ; 115 : 4–12 rayons par mm.
- Structure étagée : 118 : tous les rayons étagés ; 120 : parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés.
- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 138 : cristaux prismatiques dans les cellules couchées des rayons ; 142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial.
Croissance et développement
Les semis sont exigeants en lumière, et la régénération est absente en forêt fermée. La régénération est souvent abondante après un défrichement dans des régions où Dalbergia melanoxylon est commun, résultant non seulement de l’installation de semis mais également de rejets de souches et de drageons. Des feux réguliers réduisent considérablement la régénération. Les arbres poussent lentement. On a estimé qu’ils n’atteignaient une taille suffisante pour fournir une quantité appréciable de bois de cœur qu’à 70–100 ans. Cependant, dans une forêt claire naturelle en Tanzanie, l’accroissement annuel moyen en diamètre sur une période de 4 ans a été de près de 1 cm, et un accroissement en diamètre de 1,5 cm/an a été enregistré pour des arbres cultivés. Au Malawi, des sujets de Dalbergia melanoxylon ont atteint en moyenne 3 m de haut 7 ans après la plantation ; au Sénégal et dans le nord du Cameroun cette hauteur a été de 2,8 m, les arbres les plus hauts atteignant une hauteur de 4 m. En Casamance (Sénégal ; pluviométrie annuelle 1400 mm), certains arbres avaient une hauteur de 3 m à l’âge de 45 mois. Dans une végétation naturelle en Tanzanie, la hauteur moyenne des arbres était de 8,9 m et le diamètre de fût moyen de 22 cm, avec une hauteur maximum de 19 m et un diamètre maximum de 68,5 cm. Les semis forment un système racinaire étendu, qui leur permet de survivre durant la longue saison sèche et en cas de feu. Les racines portent des nodules qui contiennent des bactéries fixatrices d’azote. Les arbres ont souvent des tiges multiples, et le nombre moyen de tiges par arbre sur les stations brûlées est plus grand que sur celles exemptes de feux. Les arbres perdent leurs feuilles durant la saison sèche, et la nouvelle pousse commence au début de la saison des pluies. Les inflorescences se développent juste avant ou en même temps que la repousse du feuillage. Les fleurs sont pollinisées par les abeilles. Les fruits mûrissent environ 7 mois après la floraison. Les arbres ont généralement une abondante production annuelle de graines.
Ecologie
En Afrique orientale et australe, Dalbergia melanoxylon se rencontre le plus souvent en sous-étage dans la forêt claire de miombo, dominée par Brachystegia, Julbernardia et Isoberlinia spp. On le trouve souvent sur des sites secs et rocheux et sur des termitières, mais il est très commun près de l’eau ou dans des vallées mal drainées. On le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’à 1350 m d’altitude, en Ethiopie jusqu’à 1900 m, dans des régions recevant une pluviométrie annuelle moyenne de 700–1200 mm, sur des sols limono-sableux à argileux y compris des vertisols. En Afrique du Sud, Dalbergia melanoxylon préfère des sols argileux, moyennement lessivés, alcalins et légèrement sodiques. Les arbres arrivés à maturité sont assez tolérants au feu, bien qu’ayant une écorce mince (environ 3,5 mm) et tendre ; les jeunes semis sont très sensibles au feu. Dans la zone sahélienne d’Afrique de l’Ouest, de nombreux sujets de Dalbergia melanoxylon sont morts lors des sécheresses des années 1970.
Multiplication et plantation
Dalbergia melanoxylon peut être multiplié par graines, boutures ou drageons. On récolte parfois aussi les semis naturels pour les planter. Les gousses doivent être récoltées peu après leur maturation, lorsqu’elles ont pris une couleur grisâtre, afin d’éviter les dégâts d’insectes. Il est difficile d’extraire les graines des gousses ; en général celles-ci sont brisées en tronçons renfermant une seule graine, et on les trempe dans l’eau pendant environ 6 heures avant de les semer. Il y a 16 000–42 000 graines par kg. Normalement les semences restent viables pendant environ 6 mois, mais elles se conservent bien dans un lieu sec et frais exempt d’insectes. A 3°C et à 9–12% d’humidité, elles peuvent se conserver plusieurs années. Elles germent 8–20 jours après le semis, avec un taux de germination de 50–60%. Un prétraitement des semences n’est pas nécessaire, cependant un trempage dans l’eau accélère la germination. Le mieux est d’élever les semis dans un mélange de sable et d’argile. Ils doivent rester à l’ombre durant la germination, mais on peut les placer en plein soleil 2 semaines après le semis. Les semis doivent être arrosés au moins une fois par jour pendant les 2 semaines suivant leur installation initiale, et ensuite tous les 1–2 jours. Les semis peuvent être élevés en récipients, mais il est alors recommandé d’effectuer un rabattage fréquent des racines (toutes les 2–3 semaines). On peut les mettre en place sur le terrain après 4–7 mois, lorsqu’ils ont environ 30–35 cm de hauteur, de préférence à la saison des pluies. En Tanzanie, on a utilisé des stumps âgés de 2 ans, comprenant 12 cm de racine et 2 cm de tige pour planter au début ou vers le milieu de la saison des pluies, avec ensuite des désherbages intensifs. Les résultats ont montré que tant les stumps que les plants issus de semis sont de bons matériels de plantation, avec des taux de survie moyens à élevés, mais après 7,5 années les plants issus de stumps avaient un taux de survie nettement meilleur que les plants issus de semis. Les boutures de racines avaient des taux de survie très faibles. L’espacement initial est de 2–4 m × 2–4 m.
Gestion
Dans des parcelles de contrôle en Tanzanie, on a trouvé une densité moyenne de sujets spontanés adultes de Dalbergia melanoxylon de 8,5 arbres/ha. Ils tendent à pousser en bouquets. La régénération est en général satisfaisante dans les conditions naturelles lorsque la végétation n’est pas brûlée.
Un désherbage complet est important dans les plantations jusqu’à ce que le diamètre au collet atteigne 5 cm. Une ombre moyenne fournie par des sujets de Pinus caribaea Morelet a eu pour effet une forme de fût améliorée. Un élagage latéral favorise le développement d’un fût net. Les arbres peuvent être traités en taillis, mais on a signalé que le pouvoir de rejeter était réduit au moment où les arbres atteignent la taille prescrite pour l’exploitation.
En Inde et en Australie occidentale, où Dalbergia melanoxylon a été introduit, il s’est naturalisé. En Australie occidentale, il s’est comporté comme une adventice très agressive, et il a été rapidement éradiqué.
Maladies et ravageurs
Certaines grumes montrent une pourriture du cœur causée par une infection cryptogamique après un dommage par le feu. Les grumes peuvent présenter des galeries creusées par des larves de capricornes. De nombreux animaux herbivores, y compris des grands mammifères, se nourrissent des feuilles et des jeunes pousses.
Récolte
En Tanzanie, les grumes d’au moins 70 cm de long et 22 cm de diamètre sont considérées comme exploitables par les scieries, mais la longueur moyenne des grumes exemptes de défauts visibles et transformées dans ces scieries est de 2 m, et la longueur maximale de 8 m. Peu après l’abattage, il peut se produire de sérieuses fentes en bout, mais on peut les prévenir par l’application immédiate d’un enduit spécial. Les mois secs de mai–septembre sont les plus favorables pour l’abattage en Tanzanie.
Rendement
Dans une comparaison entre forêts côtières et continentales en Tanzanie, on a montré que les forêts de l’intérieur avaient un volume total de bois de Dalbergia melanoxylon double, soit 10 m³/ha contre 5 m³/ha pour les forêts côtières. Le volume marchand est toutefois bien inférieur : 4,4 m³/ha et 1,7 m³/ha respectivement. En outre, la qualité du bois est généralement meilleure pour la grenadille d’Afrique récoltée dans les régions intérieures plus sèches, probablement en raison de la croissance plus lente.
Traitement après récolte
Les grumes ont en général un petit diamètre (moins de 40 cm) et sont souvent courbes ou tordues. Cela rend le sciage difficile, et les scieries produisent une grande quantité de déchet. Le taux de récupération des sciages de grenadille d’Afrique sciée en vue de l’exportation en Tanzanie a été évalué à seulement 9%.
Ressources génétiques
Dans de nombreuses régions, les arbres de Dalbergia melanoxylon sont abattus sélectivement pour leur bois précieux. Au Sénégal, Dalbergia melanoxylon est protégé par la loi, mais il est toujours utilisé pour la sculpture. Au Mali, il est encore assez commun, mais il est maintenant soumis à une forte pression en raison des sécheresses successives et de l’abattage à grande échelle. Au Soudan, il a été classé en 2000 comme espèce en danger. Au Kenya, les stocks commerciaux de Dalbergia melanoxylon sont maintenant presque totalement épuisés, et en Tanzanie on considère l’espèce comme menacée, ou du moins non exploitable commercialement dans un avenir proche, après une étude de présence et de volume sur pied ; il est protégé par la loi en Tanzanie, mais des permis d’abattage peuvent être obtenus. Au Malawi, il était répandu dans les basses terres, mais la densité de population humaine y est élevée et les effectifs d’arbres ont considérablement diminué depuis quelques années. Au Malawi, il a été évalué à titre préliminaire comme espèce en danger. Il est inclus dans la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées, où il est classé comme espèce à faible risque mais près d’être menacée. L’enlèvement constant des sujets les plus âgés et les plus grands avec des fûts rectilignes pourra se traduire par une sérieuse érosion génétique ainsi que par l’absence de régénération naturelle.
Perspectives
Dalbergia melanoxylon fournit l’un des bois les plus précieux d’Afrique. Il y a une longue tradition d’utilisation de ce bois pour des objets artistiques, et il a une grande valeur tant économique que culturelle. Le commerce international de grenadille d’Afrique est relativement stable depuis des dizaines d’années, et il n’y a pas de raison immédiate d’inquiétude. Toutefois, l’amenuisement constant des effectifs d’arbres âgés presque partout dans l’aire de répartition de Dalbergia melanoxylon ne pourra être stoppé que par l’instauration de méthodes d’exploitation conservatrices, dont la mise au point nécessitera davantage de recherche sur les taux de croissance et sur la multiplication. Cette ressource importante et typiquement africaine (c’est l’arbre national de la Tanzanie) doit être sauvée pour les générations futures de sculpteurs sur bois et d’artistes. Sa valeur élevée sur le marché est d’un côté une incitation à mettre en place des méthodes rationnelles de récolte, mais d’un autre côté c’est un encouragement à l’exploitation illicite. Un suivi de l’exploitation de grenadille d’Afrique semble justifié, bien que des tentatives faites en 1994 de l’inclure dans les listes de la CITES (Annexe II) aient échoué au motif du manque d’information sur la situation exacte de l’espèce. Il est nécessaire d’intéresser les populations locales à la mise au point d’une gestion forestière appropriée. Il y a déjà des initiatives pour replanter Dalbergia melanoxylon dans des zones d’où il a disparu, par ex. par l’ “African Blackwood Conservation Project” (ABCP) en Tanzanie. Cependant, la lenteur de la croissance rend les plantations peu attrayantes d’un point de vue économique. En outre, des conditions de croissance optimales semblent réduire la qualité du bois, se traduisant par une couleur plus claire et une densité plus faible du bois de cœur.
Références principales
- Ball, S.M.J., 2004. Stocks and exploitation of East African blackwood Dalbergia melanoxylon: a flagship species for Tanzania’s miombo woodlands? Oryx 38(3): 266–272.
- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.
- CAB International, 2005. Forestry Compendium. Dalbergia melanoxylon. [Internet] http://www.cabicompendium.org/fc/datasheet.asp?ccode=dag_me&country=0. January 2007.
- Gundidza, M. & Gaza, N., 1993. Antimicrobial activity of Dalbergia melanoxylon extracts. Journal of Ethnopharmacology 40(2): 127–130.
- Jenkins, M., Oldfield, S. & Aylett, T., 2002. International trade in African blackwood. Fauna & Flora International, Cambridge, United Kingdom. 32 pp.
- Katende, A.B., Birnie, A. & Tengnäs, B., 1995. Useful trees and shrubs for Uganda: identification, propagation and management for agricultural and pastoral communities. Technical Handbook 10. Regional Soil Conservation Unit, Nairobi, Kenya. 710 pp.
- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.
- Nshubemuki, L., 1993. Dalbergia melanoxylon: valuable wood from a neglected tree. NFT Highlights No 93–05. 2 pp.
- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan, 248 pp.
- World Agroforestry Centre, undated. Agroforestree Database. [Internet] World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya. http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp. January 2007.
Autres références
- Arbonnier, M., 2004. Trees, shrubs and lianas of West African dry zones. CIRAD, Margraf Publishers Gmbh, MNHN, Paris, France. 573 pp.
- ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux), 1986. Tropical timber atlas: Part 1 – Africa. ATIBT, Paris, France. 208 pp.
- Beentje, H.J., 1994. Kenya trees, shrubs and lianas. National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya. 722 pp.
- Bekele-Tesemma, A., Birnie, A. & Tengnäs, B., 1993. Useful trees and shrubs for Ethiopia: identification, propagation and management for agricultural and pastoral communities. Technical Handbook No 5. Regional Soil Conservation Unit/SIDA, Nairobi, Kenya. 474 pp.
- Betti, J.L., 2004. An ethnobotanical study of medicinal plants among the Baka pygmies in the Dja biosphere reserve, Cameroon. African Study Monographs 25(1): 1–27.
- Bredenkamp, G.J., 1986. Ecological profiles of potential bush encroacher species in the Manyeleti Game Reserve, Transvaal, South Africa. South African Journal of Botany 52(1): 53–59.
- Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp.
- Chudnoff, M., 1980. Tropical timbers of the world. USDA Forest Service, Agricultural Handbook No 607, Washington D.C., United States. 826 pp.
- Coates Palgrave, K., 1983. Trees of southern Africa. 2nd Edition. Struik Publishers, Cape Town, South Africa. 959 pp.
- Elkhalifa, K.F., 2003. Nursery establishment of abanus (Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.). Arab Gulf Journal of Scientific Research 21(3): 153–157.
- Gillett, J.B., Polhill, R.M., Verdcourt, B., Schubert, B.G., Milne-Redhead, E., & Brummitt, R.K., 1971. Leguminosae (Parts 3–4), subfamily Papilionoideae (1–2). In: Milne-Redhead, E. & Polhill, R.M. (Editors). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 1108 pp.
- Hines, D.A. & Eckman, K., 1993. Indigenous multipurpose trees for Tanzania: uses and economic benefits for people. FAO Forestry Paper, Rome, Italy.
- InsideWood, undated. [Internet] http://insidewood.lib.ncsu.edu/search/. May 2007.
- Kamundi, D., 2000. A red data list assessment for Dalbergia melanoxylon in Malawi. SABONET News 5(1): 35.
- Kokwaro, J.O., 1993. Medicinal plants of East Africa. 2nd Edition. Kenya Literature Bureau, Nairobi, Kenya. 401 pp.
- Malimbwi, R.E., Luoga, E.J., Hofstad, O., Mugasha, A.G. & Valen, J.S., 2000. Prevalence and standing volume of Dalbergia melanoxylon in coastal and inland sites of Southern Tanzania. Journal of Tropical Forest Science 12(2): 336–347.
- Mugasha, A.G., 1983. The effect of planting season, different planting materials and weeding methods on early performance of Dalbergia melanoxylon at Kwamarukanga, Korogwe, Tanzania. Tanzania Silviculture Research Note No 43. 14 pp.
- Mugasha, A.G. & Mruma, S.O., 1983. Growth of Dalbergia melanoxylon in natural woodland and trial plots in Tanzania. Tanzania Silviculture Technical Note No 59. 11 pp.
- Palmer, E. & Pitman, N., 1972–1974. Trees of southern Africa, covering all known indigenous species in the Republic of South Africa, South-West Africa, Botswana, Lesotho and Swaziland. 3 volumes. Balkema, Cape Town, South Africa. 2235 pp.
- Thulin, M., 1989. Fabaceae (Leguminosae). In: Hedberg, I. & Edwards, S. (Editors). Flora of Ethiopia. Volume 3. Pittosporaceae to Araliaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 49–251.
- van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000. People’s plants: a guide to useful plants of southern Africa. Briza Publications, Pretoria, South Africa. 351 pp.
Sources de l'illustration
- Gillett, J.B., Polhill, R.M., Verdcourt, B., Schubert, B.G., Milne-Redhead, E., & Brummitt, R.K., 1971. Leguminosae (Parts 3–4), subfamily Papilionoideae (1–2). In: Milne-Redhead, E. & Polhill, R.M. (Editors). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 1108 pp.
- Maundu, P. & Tengnäs, B. (Editors), 2005. Useful trees and shrubs for Kenya. World Agroforestry Centre - East and Central Africa Regional Programme (ICRAF-ECA), Technical Handbook 35, Nairobi, Kenya. 484 pp.
Auteur(s)
- R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands
Citation correcte de cet article
Lemmens, R.H.M.J., 2008. Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 31 mai 2025.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.