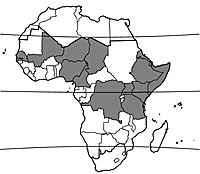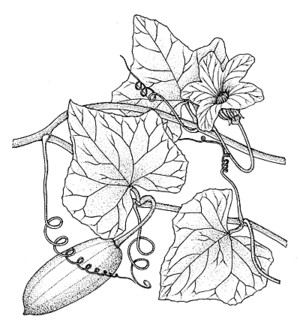Coccinia grandis (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Fruit | |
| Légume | |
| Médicinal | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
Coccinia grandis (L.) Voigt
- Protologue: Hort. suburb. Calcul. : 59 (1845).
- Famille: Cucurbitaceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 24
Noms vernaculaires
- Tindola, courge écarlate (Fr).
- Ivy gourd, scarlet-fruited gourd, tindori (En).
- Ruho (Sw).
Origine et répartition géographique
Coccinia grandis est présent à l’état sauvage depuis le Sénégal jusqu’à la Somalie et vers le sud jusqu’à la Tanzanie ; on le trouve également en Arabie saoudite, au Yémen et en Inde. Il s’est naturalisé dans certaines régions du Mozambique et de l’île Maurice et il a été introduit dans de nombreuses autres régions tropicales et subtropicales ; en Australie, en Floride et dans des îles du Pacifique comme Hawaii, il est considéré comme une adventice nuisible et envahissante. Il est cultivé en Asie, depuis l’Inde jusqu’à l’Indonésie. En Afrique de l’Est, au Kenya en particulier, on le cultive principalement pour les consommateurs d’origine indienne.
Usages
Les fruits mûrs et rouges des cultivars à saveur douce se consomment crus ; on peut aussi les peler, les couper en morceaux et les préparer en ragoût avec des oignons et des tomates. On peut ajouter d’autres légumes, comme l’aubergine écarlate, la gourde, la papengaye, le gombo et des légumes secs. On ajoute de la viande lorsqu’on en a. Ce plat peut être servi avec du pain, du sorgho, ou tout autre féculent. Il est connu en Afrique de l’Est sous le nom de “tindori”. Les fruits immatures servent à faire des soupes et des curries, et ces usages sont largement répandus en Ethiopie et en Inde. Les cultivars à fruits amers sont surtout utilisés pour leurs feuilles et leurs pousses. Celles-ci sont particulièrement prisées en Thaïlande, où on les consomme frites ou cuites à l’eau. Les Mursis d’Ethiopie consomment aussi les feuilles en légume. Les graines sont mastiquées en Ethiopie et au Kenya, mais jetées en Afrique de l’Ouest et en Ouganda.
Les fruits, les tiges et les feuilles possèdent des usages médicinaux ; ils servent par exemple à réduire la tension artérielle et à soigner les abcès. Les racines ont la réputation de guérir les maladies liées aux problèmes du système endocrinien, comme le diabète sucré ; au Niger, on s’en sert pour traiter les troubles intestinaux. Cette plante guérirait l’inflammation des bronches, les mucoses respiratoires et les affections de la peau. Dans certains villages en Inde, on cultive le tindola pour ses vertus médicinales. Les chèvres, les moutons, les bovins, les ânes et les chameaux mangent la plante.
Production et commerce international
Au Kenya, la production de tindola est destinée aux communautés asiatiques et à l’exportation. Les principales régions de production sont l’Ukambani et le Makuyu. Le Kenya exporte régulièrerement sur Londres, mais on ne dispose pas de données sur les quantités. Dans la plupart des autres pays d’Afrique, les fruits et les feuilles de tindola sont récoltés surtout dans la nature ; mais il arrive qu’ils soient cultivés dans les jardins familiaux, comme près de Kabale, en Ouganda.
Propriétés
Par 100 g de partie comestible, les fruits contiennent : eau 93,5 g, énergie 75 kJ (18 kcal), protéines 1,2 g, lipides 0,1 g, glucides 3,1 g, fibres 1,6 g, Ca 40 mg, P 30 mg, Fe 1,4 mg, thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,08 mg, niacine 0,7 mg et acide ascorbique 1,4 mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997). On ne dispose d’aucune donnée fiable sur la composition des feuilles.
Description
- Plante herbacée dioïque vivace atteignant 20(–30) m de long, rampante ou grimpante à vrilles simples, à rhizome tubérisé ; tige verte côtelée longitudinalement à l’état jeune, se tachetant de blanc en vieillissant et devenant finalement ligneuse.
- Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 1–5 cm de long ; limbe à contour largement ovale à pentagonal ou orbiculaire, de 3–12 cm × 3–15 cm, faiblement à profondément 3–5-palmatilobé, cordé à la base, bord entier ou sinué et souvent à dents rougeâtres glanduleuses distinctes, glabre, ponctué.
- Fleurs axillaires, unisexuées, 5-mères, à réceptacle tubulaire de 3–7 mm de long, sépales linéaires, atteignant 6 mm de long, corolle campanulée, à lobes atteignant 2 cm × 1,5 cm, jaune-orange ; fleurs mâles solitaires ou appariées, rarement par 3–4 en courte grappe, pédicelle de 1–7 cm de long, étamines 3, unies en colonne ; fleurs femelles solitaires, pédicelle atteignant 2,5 cm de long, ovaire infère, cylindrique, atteignant 1,5 cm de long, 1-loculaire, style de 3 mm de long, stigmate 3-lobé.
- Fruit : baie ellipsoïde ou rarement sphérique de 3–7 cm × 1–3,5 cm, charnue, vert rayé de blanc à l’état jeune et virant au rouge à maturité, contenant de nombreuses graines.
- Graines piriformes asymétriques, comprimées, d’environ 6 mm × 3 mm, bord relativement épais et cannelé.
Autres données botaniques
Le genre Coccinia est placé dans la tribu Benincaseae et comprend environ 30 espèces, toutes confinées à l’Afrique tropicale à l’exception de Coccinia grandis.
En Ethiopie, l’anchote (Coccinia abyssinica (Lam.) Cogn.) est cultivé principalement pour son rhizome tubérisé et charnu, mais ses jeunes pousses se consomment aussi comme légume cuit.
Au Malawi, les enfants consomment les fruits de Coccinia rehmannii Cogn., même si on les dit susceptibles de provoquer des douleurs oculaires ; le tubercule féculent se mange grillé.
Les feuilles de Coccinia trilobata (Cogn.) C.Jeffrey constituent un aliment de famine, mais certaines tribus du Kenya, par ex. dans la région du Mbeere, les utilisent parfois comme condiment. Les fruits seraient toxiques.
Croissance et développement
Les boutures commencent à former de nouvelles feuilles et de nouvelles pousses au bout d’un mois environ. Des drageons apparaissent au bout d’un mois encore, et au bout d’un autre mois, la plante commence à fleurir et à fructifier. Les plantes de tindola fleurissent abondamment et produisent de nombreux fruits. Les fleurs ne se développent que sur les rameaux et jamais sur la tige principale. On peut récolter les jeunes fruits environ une semaine après la floraison. Il s’écoule jusqu’à 5 mois entre la plantation et la première récolte. Il est préférable de récolter toutes les semaines, aussi longtemps qu’il y a assez d’humidité pour que la plante produise de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. On peut laisser cette culture au champ jusqu’à 10 ans ; au-delà, son rendement décline et les cultivateurs doivent la remplacer. Mais il peut être plus économique de replanter au bout de 4 ans. A l’état sauvage, les plantes peuvent atteindre 20 ans ou plus, et la tige peut s’étendre sur 30 m et avoir un diamètre de 7 cm à la base. Les tiges deviennent liégeuses avec l’âge et le rhizome ainsi que les tiges jouent le rôle de réservoir d’eau, ce qui permet à la plante de survivre pendant la saison sèche.
Ecologie
Le tindola est présent dans la nature dans les régions semi-arides, dans les forêts sèches ou la savane arborée, souvent dans les régions côtières, mais en Ouganda, on le trouve jusqu’à 2000 m d’altitude et en Ethiopie jusqu’à 2350 m. Il est également présent parmi la végétation secondaire dans les hautes terres. Il pousse dans des types de sols très différents, mais le plus fréquemment sur des sols sablonneux.
Multiplication et plantation
Le tindola se multiplie par boutures de tige de 10–15 cm de long et de 0,5 cm de diamètre environ. Les paysans préparent des trous de plantation de 30 cm de profondeur et de 60 cm de diamètre. Ils ajoutent jusqu’à 20 kg de fumier de ferme, qu’ils mélangent à de la terre et de l’eau. Les boutures sont installées droites ou légèrement en biais pour favoriser le développement de pousses latérales. Lorsque la plantation a lieu pendant un épisode de sécheresse, les paysans doivent apporter suffisamment d’eau et continuer d’arroser régulièrement. L’écartement est d’à peu près 1 m entre les trous de plantation et de 1,2–1,6 m entre les lignes. Ce large espacement est nécessaire aux longues tiges, qui peuvent atteindre 10 m de long ou plus et qui ont besoin de tuteurage. Dans les jardins familiaux, on peut les faire grimper sur les clôtures ou les toits. L’espacement permet d’accéder facilement aux plantes pour désherber, lutter contre les ravageurs et récolter.
La reproduction par graines se pratique peu en raison de la nature dioïque du tindola : il produit 50% de plantes mâles, non productives. On estime qu’une proportion de 1 plante mâle pour 10 plantes femelles est correcte pour une bonne fécondation.
Gestion
En début de culture, le tindola peut se planter en association avec le maïs ou d’autres espèces à cycle cultural court. Lorsque les boutures commencent à croître, il faut arroser tous les 2 jours jusqu’à ce que les plantes se fortifient et qu’un arrosage deux fois par semaine suffise. On conduit les longues tiges le long d’un système de fils de fer verticaux et horizontaux reliés à des poteaux de bois.
On pratique un premier apport d’engrais entre les lignes environ 4–6 semaines après la plantation, lorsque les premières nouvelles feuilles et pousses apparaissent. Pour chaque plante, les paysans doivent employer jusqu’à 500 g d’engrais azoté, par ex. du nitrate de chaux. Une fois que les premiers fruits ont été récoltés, les plantes nécessitent un nouvel apport d’engrais, par ex. du diphosphate d’ammonium, qu’il faut épandre chaque mois.
Le désherbage se fait soit à la machette soit à la main, parce que le binage peut endommager les racines. Sur une culture établie, l’irrigation est nécessaire dès le début de la saison sèche pour prolonger la saison de récolte ; cependant, certains paysans préfèrent laisser une période de repos aux plantes, en attendant la venue des nouvelles pluies. Les feuilles se dessèchent pendant la saison sèche et il faut les ôter pour faire de la place aux nouvelles pousses. Cela est souvent réalisé en frappant sur la plante, ce qui force les feuilles à tomber. Il faut tailler régulièrement pour stimuler la repousse. Les branches les plus âgées se fanent et deviennent liégeuses et elles ne produiront plus de feuilles ni de fleurs. Pendant la saison sèche, lorsque la terre devient brûlante, il est recommandé de procéder à un paillage pour éviter que les plantes ne grillent.
Dans les pays où le tindola a été introduit et où il n’a pas de prédateurs naturels, il peut devenir une adventice gênante. Il pousse rapidement et ne tarde pas à recouvrir le sol et à étouffer les arbustes et les arbres d’une dense couverture. En venir à bout est un travail fastidieux ; il est difficile d’arracher toute la plante, parce que les morceaux de rhizome qui restent la régénèrent. C’est la raison pour laquelle les propriétaires terriens d’Australie qui ont cette plante sur leur propriété ont l’obligation légale de la détruire.
Maladies et ravageurs
Le tindola est l’hôte de diverses maladies, dont l’oïdium (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum). Transmise par la semence, l’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) peut provoquer de lourdes pertes en fruits, en particulier pendant leur stockage ; on peut l’éliminer en pulvérisant de l’oxychlorure de cuivre. Parmi les autres maladies, il faut citer la pourriture noire (Curvularia pallescens) et la pourriture du collet (Rhizoctonia solani). Des maladies d’origine virale, comme le virus de la mosaïque de la pastèque (WMV), peuvent affecter la plante. Les symptômes en sont, entre autres, des marbrures, des cloques vertes, un enroulement du bord des feuilles et une déformation des fruits.
Un fléau important du tindola cultivé au Kenya est une punaise Coréidée qui se nourrit des nouvelles pousses et des jeunes fruits. Lorsqu’elles sucent les fruits, ces punaises provoquent leur déformation ou leur chute ; et si l’invasion est massive, cela peut faire dépérir les pousses. La pyrale de la citrouille (Diaphania indica) peut aussi être un grave ravageur du tindola. Des pucerons (Myzus persicae et Aphis gossypii) se nourrissent des fleurs et affectent le développement de nouveaux fruits. Des mouches des fruits peuvent également être de sérieux ravageurs. Les pesticides ne doivent être employés qu’en cas de nécessité, car ils peuvent tuer aussi les insectes auxiliaires. Les autres ravageurs que l’on rencontre au Kenya sont un charançon (Acythopeus cocciniae) et une sésie (Melittia oedipus), dont les larves creusent des galeries dans les tiges qui les font s’effondrer. Ces deux ennemis naturels sont aujourd’hui utilisés en lutte biologique dans les régions où le tindola est une adventice nuisible.
Récolte
Les paysans récoltent deux fois par semaine.
Rendement
Le rendement est de l’ordre de 7–10 kg de fruits immatures par plante et par an ; on peut récolter 10–13 t/ha par an. Le pic de production se situe entre la seconde et la quatrième année ; ensuite, la production décline, sauf si l’on donne de l’engrais, si l’on arrose et si l’on taille les plantes régulièrement. Il n’existe pas de données sur les rendements en feuilles.
Traitement après récolte
On étale les fruits le soir, en couche simple ou double, sur des sacs propres. S’ils sont couverts ou conservés dans un sac, ils ont tendance à jaunir à l’extérieur et à rosir ou rougir à l’intérieur. Seuls les fruits frais et verts qui sont blanchâtres à vert pâle à l’intérieur peuvent être vendus. Les commerçants utilisent des chambres froides pour préserver leur fraîcheur. Si on les conserve au réfrigérateur, les fruits durent jusqu’à deux semaines. Avant de les emporter au marché, on les met dans des cartons d’une contenance d’environ 7,5 kg. Ce sont les mêmes cartons qui servent à l’exportation.
Ressources génétiques
Coccinia grandis n’est représenté que de façon très dispersée dans les collections de ressources génétiques de certains instituts de recherche indiens. Les travaux de sélection menés en Inde ont débouché sur plusieurs cultivars intéressants à saveur douce. Aucun institut africain n’en conserve des ressources génétiques. Toutefois, partout dans son aire de répartition naturelle, il présente une grande diversité à l’état sauvage.
Sélection
Les sélectionneurs devraient chercher à produire des plantes compactes à courts entre-nœuds. La parthénocarpie, qui fait que les fleurs femelles forment des fruits sans fécondation, est connue chez l’espèce. Il semble que les plantes cultivées en Afrique de l’Est soient parthénocarpiques, tandis qu’en Asie de l’Est, les plantes mâles sont nécessaires à la fructification.
Perspectives
La demande locale en tindola est limitée et pourrait être satisfaite grâce aux populations sauvages, tandis que la production destinée aux communautés asiatiques a de fortes chances de demeurer à son faible niveau actuel. Il faudra davantage de recherches pour déterminer les perspectives du tindola comme légume cultivé destiné à des consommateurs africains, ou comme plante médicinale.
Références principales
- Bates, D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C. (Editors), 1990. Biology and utilization of the Cucurbitaceae. Cornell University Press, New York, United States. 485 pp.
- Boonkerd, T., Na Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993. Coccinia grandis (L.) Voigt. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 150–151.
- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.
- Jeffrey, C., 1967. Cucurbitaceae. In: Milne-Redhead, E. & Polhill, R.M. (Editors). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 157 pp.
- Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999. Wild food plants and mushrooms of Uganda. Technical Handbook No 19. Regional Land Management Unit/SIDA, Nairobi, Kenya. 490 pp.
- Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999. Traditional food plants of Kenya. Kenya Resource Centre for Indigenous Knowledge (KENRIK), Nairobi, Kenya. 270 pp.
- Peter, K.V., Sadhu, M.K., Mini Raj & Prasunna, K.P., 1998. Improvement and cultivation of bitter gourd, snake gourd, pointed gourd and ivy gourd. In: Nayar, N.M. & More, T.A. (Editors). Cucurbits. Science Publishers, Enfield, United States. 340 pp.
- Schippers, R.R., 2002. African indigenous vegetables, an overview of the cultivated species 2002. Revised edition on CD-ROM. National Resources International Limited, Aylesford, United Kingdom.
- SEPASAL, 1999. Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands. [Internet] Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. http://www.kew.org/ ceb/sepasal/. 6 April 2001.
Autres références
- Adam, J.G., Echard, N. & Lescot, M., 1972. Plantes médicinales Hausa de l’Ader. Journal d’Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée 19(8–9): 259–399.
- Jeffrey, C., 1980. A review of the Cucurbitaceae. Botanical Journal of the Linnean Society 81: 233–247.
- Maggs, G.L., 1998. Genetic resources and agricultural potential of indigenous cucurbitaceae in Namibia. PhD thesis. Department of Agricultural Science, The Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg, Denmark.
- van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000. People’s plants: a guide to useful plants of southern Africa. Briza Publications, Pretoria, South Africa. 351 pp.
- Williamson, J., 1955. Useful plants of Nyasaland. The Government Printer, Zomba, Nyasaland. 168 pp.
Sources de l'illustration
- Boonkerd, T., Na Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993. Coccinia grandis (L.) Voigt. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 150–151.
Auteur(s)
- M.D. Imbumi, Kenya Resource Centre for Indigenous Knowledge (KENRIK), P.O. Box 40658, Nairobi, Kenya
Consulté le 31 mai 2025.