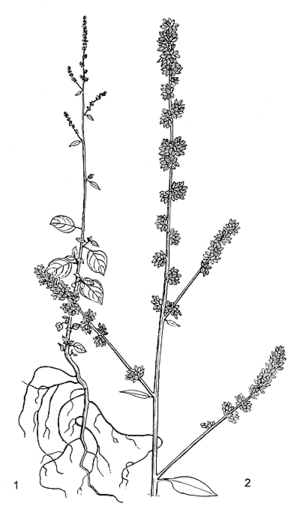Celosia trigyna (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Médicinal | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
- Protologue: Mant. pl. 2 : 212 (1771).
- Famille: Amaranthaceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 18
Synonymes
- Celosia laxa Schumach. & Thonn. (1827),
- Celosia digyna Suess. (1951).
Noms vernaculaires
- Célosie, crête de coq (Fr).
- Silver spinach, woolflower, cock’s comb (En).
- Bóróbóró déo (Po).
- Mfungu (Sw).
Origine et répartition géographique
Celosia trigyna est présent dans presque toute l’Afrique tropicale, ainsi qu’en Afrique du Sud et au sud de l’Arabie, souvent comme adventice. Il est signalé au Bénin et au sud du Nigeria comme légume-feuilles, mais également en Afrique du Sud. Celosia trigyna a été introduit aux Etats-Unis, où il s’est naturalisé localement.
Usages
Les feuilles de Celosia trigyna sont consommées comme légume, finement coupées dans des soupes, des ragoûts et des sauces. Ses feuilles légèrement amères sont appréciées des Yorubas au sud-ouest du Nigeria, où la plante est connue sous le nom de “aje fo wo”.
La plante est employée en médecine traditionnelle. En Sierra Leone, on s’en sert pour soigner les troubles cardiaques, tandis qu’au nord du Nigeria, elle sert à traiter les éruptions pustuleuses de la peau. Au Ghana, on l’applique sur les plaies et les furoncles. La pulpe des feuilles est utilisée pour traiter les douleurs intercostales, les troubles de poitrine, les maux d’estomac et les troubles de l’urètre. La plante entre dans la composition de plusieurs préparations médicinales utilisées pour soigner les maladies et les problèmes gynécologiques, par ex. les problèmes ovariens en R.D. du Congo et les flux menstruels excessifs en Ethiopie. Les feuilles et les fleurs servent à traiter la diarrhée. Le bétail broute la plante mais les avis quant à son appétibilité sont contradictoires.
Production et commerce international
Celosia trigyna est un légume secondaire vendu sur les marchés locaux et urbains. Il n’existe pas de données sur sa production.
Propriétés
La composition nutritionnelle des feuilles de Celosia trigyna, par 100 g de partie comestible, est : eau 89 g, énergie 138 kJ (33 kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,4 g, glucides 6,4 g, fibres 1,4 g, Ca 154 mg, P 32 mg, Fe 5,0 mg, ß-carotène 1,9 mg, riboflavine 0,1 mg, acide ascorbique 10 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Celosia trigyna a montré des propriétés vermifuges chez les humains ; des extraits méthanoliques de la plante entière ont montré des propriétés acaricides.
Falsifications et succédanés
Les feuilles de Celosia trigyna utilisées en soupes peuvent se remplacer par les feuilles de Celosia argentea L. et de plusieurs espèces d’Amaranthus.
Description
- Plante herbacée annuelle érigée atteignant 120(–180) cm de haut ; tige simple ou ramifiée, cannelée ou striée, glabre ou portant quelques poils, habituellement marron rosé.
- Feuilles alternes, simples, sans stipules ; pétiole atteignant 5(–8) cm de long ; limbe largement ovale à étroitement lancéolé, de (1–)2–8,5(–10) cm × (0,5–)1–4(–5) cm, atténué à tronqué à la base, aigu à acuminé à l’apex, entier, glabre ou un peu courtement poilu en dessous, à nervures pennées.
- Inflorescence : épi axillaire ou terminal, simple ou ramifié, de 6,5–35 cm de long, formé de glomérules de fleurs éloignés ou proches, munis de bractées, argenté à rose.
- Fleurs petites, bisexuées, régulières, 5-mères ; tépales libres, ovales-elliptiques, de 2–3 mm de long, brièvement mucronés ; étamines soudées à la base ; ovaire supère, 1-loculaire, style très court, stigmates 2–3.
- Fruit : capsule ovoïde d’environ 2 mm de long, à déhiscence circulaire, contenant peu de graines.
- Graines lenticulaires, d’environ 1 mm de long, noires et luisantes, faiblement réticulées.
Autres données botaniques
Le genre Celosia, qui comprend environ 50 espèces, est présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Celosia trigyna est probablement l’espèce la plus répandue en Afrique tropicale. Elle diffère de nombreuses autres espèces de Celosia par son nombre de chromosomes, étant diploïde, et elle est considérée avoir une place isolée au sein du genre.
Autres espèces
Plusieurs autres espèces sont souvent confondues avec Celosia trigyna, et sont probablement utilisées aussi comme légume : Celosia globosa Schinz (que l’on trouve du Nigeria à l’Ouganda), Celosia isertii C.C.Towns. (dans toute l’Afrique tropicale sauf la partie nord-est), Celosia leptostachya Benth. (du Sierra Leone à la R.D. du Congo) et Celosia pseudovirgata Schinz (du Nigeria à la R.D. du Congo).
Croissance et développement
La graine germe 4–5 jours après le semis. La période de croissance est de 90–120 jours, de la plantation à la maturité des graines. Les fleurs sont pollinisées par les insectes.
Ecologie
Celosia trigyna est présent dans les clairières de forêt et les savanes herbeuses, aux abords des routes et des rivières, ainsi que comme adventice dans les champs, jusqu’à 1500(–2000) m d’altitude. Il a besoin d’une pluviométrie annuelle jusqu’à 2500 mm et de températures maximales de 25–30°C pour pousser de façon optimale et il ne supporte pas les températures inférieures à 15°C. Il pousse sur de nombreux types de sols, mais préfère les sols limoneux fertiles et bien drainés.
Multiplication et plantation
Celosia trigyna se multiplie par graines, que l’on sème soit à la volée soit en sillons, directement sur les planches. Les graines sont petites, le poids de 1000 graines étant d’environ 0,3 g. Une quantité de 8 kg/ha de semences est donnée comme correcte. Avant le semis, on mélange les graines à du sable ou à de la terre finement tamisée pour réaliser une distribution uniforme et permettre une bonne installation de la plante. Le semis à la volée est préférable pour la production de feuilles. On éclaircit les plantes à un espacement d’environ 15 cm ; avec des espacements plus larges, elles deviennent très buissonnantes, avec des branches qui dépassent. Un semis en sillons espacés de 0,8–1,0 m convient davantage à la production de semences.
Gestion
Celosia trigyna demande un sol fertile pour pousser convenablement. Dans les sols pauvres ou modérément fertiles, il est recommandé d’incorporer de l’engrais organique à la dose de 20–25 t/ha avant de planter. Une autre possibilité est d’épandre de l’engrais NPK (20–10–10) à raison de 300–400 kg/ha : ceci convient à une récolte unique par arrachage, tandis qu’une dose plus élevée de 500–700 kg/ha peut être employée si on veut faire plusieurs cueillettes. Le désherbage est essentiel au début du développement des semis et il faut arroser régulièrement pendant les périodes de sécheresse.
Celosia trigyna devient souvent une mauvaise herbe dans les autres cultures. On peut lutter contre elle assez facilement, aussi bien mécaniquement qu’avec des herbicides.
Maladies et ravageurs
Les cas de maladies ne sont pas nombreux chez Celosia trigyna et on ne dispose d’aucune donnée sur l’existence de maladies importantes. Parmi les ravageurs signalés, il faut citer le mille-pattes et l’adulte et la larve de la chrysomèle Cassida tosta, qui se nourrissent des feuilles. Dans le sud-ouest du Nigeria, on a noté l’existence de quelques insectes destructeurs sur la plante. Les individus adultes de Gasteroclisus rhomboidalis attaquent la tige et les adultes d’Anacatantops notatus attaquent les feuilles. Les larves de Sceliodes laisalis et Hymenia recurvalis sont destructrices pour les feuilles.
Récolte
Celosia trigyna peut être récolté soit en arrachant les plantes jeunes et vigoureuses ou en faisant des coupes répétées. La première récolte de feuilles intervient environ 8 semaines après le semis et il est possible de faire jusqu’à 8 cueillettes de jeunes pousses en 2 mois, avant que la floraison ne réduise la croissance. La taille des rameaux latéraux et des tiges à 5 cm au-dessus du niveau du sol favorise la ramification.
Rendement
Une récolte hebdomadaire sur environ 2 mois produit près de 4–5 t/ha de légumes frais.
Traitement après récolte
Les feuilles fraîches sont utilisées directement après la récolte pour la consommation familiale ou pour la vente, ou bien on les fait sécher pour une utilisation ultérieure. Les tiges fraîches sont liées en petites bottes avant de les emporter sur les marchés pour les vendre.
Ressources génétiques
La diversité au sein de Celosia trigyna est considérable, mais elle ne semble pas avoir fait l’objet de collecte, de conservation ou de caractérisation. On ne dispose pas de cultivars améliorés. Il n’y a pas de menace d’érosion génétique dans les peuplements naturels car Celosia trigyna est répandu et commun dans les milieux perturbés.
Perspectives
Celosia trigyna présente actuellement peu d’importance comme légume-feuilles en comparaison avec Celosia argentea, mais la disponibilité de types génétiquement améliorés, ainsi que de pratiques agronomiques adaptées, pourraient faire augmenter rapidement la production de ce légume-feuilles savoureux.
Références principales
- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.
- Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968. Food composition table for use in Africa. FAO, Rome, Italy. 306 pp.
- Mander, M., 1998. Marketing of indigenous medicinal plants in South Africa. A case study in Kwazulu-Natal. FAO, Rome, Italy. 151 pp.
- Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 136 pp.
- Townsend, C.C., 1988. Amaranthaceae. In: Launert, E. (Editor). Flora Zambesiaca. Volume 9, part 1. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 28–133.
- Townsend, C.C., 2000. Amaranthaceae. In: Edwards, S., Mesfin Tadesse, Demissew Sebsebe & Hedberg, I. (Editors). Flora of Ethiopia and Eritrea. Volume 2, part 1. Magnoliaceae to Flacourtiaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 299–335.
- van Epenhuijsen, C.W., 1974. Growing native vegetables in Nigeria. FAO, Rome, Italy. 113 pp.
Autres références
- Akinlosotu, T.A., 1983. Destructive and beneficial insects associated with vegetables in southwestern Nigeria. Acta Horticulturae 123: 217–230.
- Badra, T., 1993. Lagos spinach. In: Williams, J.T. (Editor). Pulses and vegetables: underutilized crops. Chapman & Hall, London, United Kingdom. pp. 131–163.
- Cavaco, A., 1974. Amaranthaceae. Flore du Cameroun. Volume 17. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. 65 pp.
- Dupriez, H. & De Leener, P., 1989. African gardens and orchards, growing vegetables and fruits. MacMillan Press, London, United Kingdom. 333 pp.
- Eluwa, M.C., 1977. Studies on Gasteroclisus rhomboidalis, Coleoptera: Curculionidae, a pest of the African spinach. Journal of Natural History 11(4): 417–424.
- Gbile, Z.O., 1983. Indigenous and adapted African vegetables. Acta Horticulturae 123: 71–80.
- Lowe, J. & Soladoye, M.O., 1990. Some changes and corrections to names of Nigerian plants since publication of Flora of West Tropical Africa Ed. 2 and Nigerian trees. Nigerian Journal of Botany 3: 1–24.
- Townsend, C.C., 1975. The genus Celosia (subgenus Celosia) in tropical Africa. Hooker's Icones Plantarum 38: 1–123.
- Townsend, C.C., 1993. Amaranthaceae. In: Thulin, M. (Editor). Flora of Somalia. Volume 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae (Annonaceae-Fabaceae). Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. pp. 140–167.
Sources de l'illustration
- Townsend, C.C., 1975. The genus Celosia (subgenus Celosia) in tropical Africa. Hooker's Icones Plantarum 38: 1–123.
Auteur(s)
- O.A. Denton, National Horticultural Research Institute, P.M.B. 5432, Idi-Ishin, Ibadan, Nigeria
Consulté le 31 mai 2025.