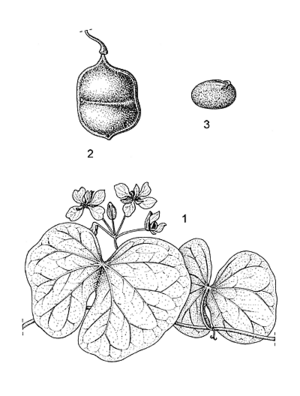Tylosema esculentum (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Céréale / légume sec | |
| Glucides / amidon | |
| Médicinal | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
Tylosema esculentum (Burch.) Schreib.
- Protologue: Mitt. Bot. Staatssamml. München 3 : 611 (1960).
- Famille: Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
- Nombre de chromosomes:
Synonymes
- Bauhinia esculenta Burch. (1824).
Noms vernaculaires
- Marama (Fr).
- Marama bean, morama bean, gemsbok bean, camel’s foot (En).
Origine et répartition géographique
Le marama est originaire du désert du Kalahari et des régions sablonneuses voisines d’Angola, de Namibie, du Botswana et d’Afrique du Sud, mais il est également présent en Zambie et au Mozambique. Sa culture a été essayée avec succès au Kenya, en Afrique du Sud, en Australie, en Israël et aux Etats-Unis (Texas).
Usages
Le marama constitue une part importante du régime alimentaire des Khoïsans au Kalahari, où l’agriculture de subsistance est une activité marginale en raison de la sécheresse et de la fertilité limitée des sols ; il est aussi un mets de choix chez d’autres populations d’Afrique australe. Ses graines se consomment cuites à l’eau ou grillées. Elles peuvent être cuites à l’eau avec de la fécule de maïs ou réduites en farine pour préparer une bouillie ou une boisson qui rappelle le café ou le cacao. Des graines grillées sont parfois vendues localement, mais seulement à petite échelle. Les maramas possèdent une agréable saveur sucrée lorsqu’ils sont cuits à l’eau ou grillés, qui évoque celle des noix de cajou ou des amandes grillées ; mais on en connaît des types amers. Ces graines grillées ont pu servir autrefois en cuisine de substitut de l’amande chez les Européens d’Afrique australe. Les graines immatures et les tiges peuvent se consommer cuites comme légume ou en soupe. L’huile des graines s’emploie au Botswana en cuisine et pour faire du beurre. Les jeunes tubercules sont consommés rôtis, bouillis ou grillés comme légume. Mais passé 2 ans, ils deviennent fibreux et amers et ne sont pas habituellement consommés ; ils demeurent toutefois une importante source d’eau en cas de besoin pour l’homme et les animaux. Il est fait état d’une consommation des gousses et des tubercules par les animaux, mais on ne sait pas bien s’ils broutent le feuillage, car les rapports divergent à ce sujet. Le marama pourrait avoir un potentiel comme plante de couverture ou comme plante ornementale.
Propriétés
Les graines mûres écossées de marama contiennent par 100 g : eau 3,9 g, énergie 2660 kJ (635 kcal), protéines 31,8 g, lipides 42,2 g et glucides 18,9 g (Bower et al., 1988). La teneur en protéines du marama est comparable à celle du soja, et sa teneur en huile deux fois plus élevée que celle du soja et comparable à celle de l’arachide. La composition en acides aminés essentiels, par 100 g d ;aliment, est : tryptophane 219 mg, lysine 1119 mg, méthionine 257 mg, phénylalanine 874 mg, thréonine 822 mg, valine 1149 mg, leucine 1774 mg et isoleucine 1119 mg (FAO, 1970). Les graines ont une activité inhibitrice de trypsine relativement élevée, à laquelle on peut remédier par la cuisson. L’huile des graines, jaune doré, à odeur de noisette et à saveur agréable mais légèrement amère, a été comparée à l’huile d’amande pour sa consistance et son goût. Ses principaux acides gras sont l’acide oléique (48–49%), l’acide linoléique (19–26%), l’acide palmitique (12–14%), l’acide stéarique (7–10%) et l’acide arachidique (3%). Par 100 g de poids sec, la farine de graines dégraissée contient : énergie 194 kJ (46 kcal), protéines 55,0 g, amidon disponible 13,0 g et fibres 1,6 g. Par 100 g, les tubercules d’une plante âgée de 5 mois contiennent : eau 92,1 g, protéines 2,1 g, lipides 0,1 g et glucides 4,4 g. Lorsqu’ils sont jeunes, les tubercules ont un goût sucré et agréable et leur texture serait semblable à celle de l’artichaut. Séchés, ils prennent une couleur rougeâtre.
Description
- Plante herbacée vivace ou arbuste, à racine tubérisée ; tiges prostrées et rampantes, atteignant 6 m de long, herbacées ou ligneuses dans ses parties inférieures, à poils de couleur rouille et à vrilles axillaires et fourchues de 1–4 cm de long.
- Feuilles alternes, simples ; stipules de 3–5 mm × 2–3 mm ; pétiole de 1,5–3,5 cm de long ; limbe 2-lobé sur plus de la moitié de sa longueur, glabre ou pubescent en dessous ; lobes réniformes, de 3,5–5 cm × 5–6,5 cm.
- Inflorescence : grappe latérale atteignant 16 cm de long ; pédoncule de 2–4 cm de long.
- Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères, hétérostylées ; pédicelle de 2–4,5 cm de long ; sépales libres mais les 2 supérieurs soudés, de 8–12 mm × 2–3 mm, à poils de couleur rouille ; pétales inégaux, les 4 plus grands de 1,5–2,5 cm × 1–1,5 cm et atténués en onglet basal, celui du haut plus petit, jaunes virant au rougeâtre avec l’âge ; étamines 2, libres, à filet de 6–12 mm de long, staminodes 8, à filet de 3–6 mm de long ; ovaire supère, de 5–6 mm de long, 1-loculaire, style allongé, stigmate petit.
- Fruit : gousse ovoïde à oblongue de 3,5–6 cm × 3–4 cm, aplatie, ligneuse, à 1–2(–6) graines, comprimée entre les graines.
- Graines ovoïdes à globuleuses, de 1,3–2,5 cm × 1,2–1,5 cm, rougeâtres à noir brunâtre.
Autres données botaniques
Le genre Tylosema, qui comprend 5 espèces, est présent dans le sud et l’est de l’Afrique. Certains taxinomistes ne considèrent pas Tylosema comme un genre distinct, mais l’incluent dans Bauhinia. Tylosema fassoglense (Schweinf.) Torre & Hillc., qui possède également des graines et des tubercules comestibles, a des feuilles à long pétiole et à lobes moins profonds.
Croissance et développement
Lors d’essais au champ au Kenya, les graines du marama ont commencé à germer 9–10 jours après le semis. Une fois germés, les semis se développent rapidement. On a noté qu’il ne commençait à fleurir que la 3e ou la 4e année après le semis, mais au cours d’essais réalisés au Texas, la floraison a débuté au bout de 2 ans et des fruits et des graines se sont formés au bout de 3,5 ans. Dans sa région d’origine, le marama fleurit d’octobre à mars. Il est essentiellement allogame et peut-être auto-incompatible ; il est pollinisé par les insectes. Lorsqu’il est cultivé, la formation de fruits et de graines a tendance à être faible. En Afrique australe, les tiges meurent pendant la période sèche et fraîche (mai–août), mais les tubercules restent viables et produisent de nouvelles tiges lorsque la température s’élève. Le marama ne forme pas de nodules racinaires et dépend de l’azote du sol. Ses mécanismes d’adaptation à la sécheresse reposent entre autres sur la fermeture des feuilles, une surface foliaire qui reste verte pendant la sécheresse grâce à la fermeture précoce des stomates et le recours aux réserves en eau du tubercule (qui se rapetisse beaucoup au cours des années sèches). Le marama est une plante à longues tiges rampantes qui traînent au niveau du sol, évitant ainsi les effets des fortes tempêtes destructives du Kalahari.
Ecologie
Le marama est présent à l’état sauvage dans un milieu extrême à températures élevées (maximum diurne typique de 37°C pendant la saison de croissance), faibles précipitations ( 100–900 mm) et longues périodes de sécheresse. On le trouve sur les sols sableux et calcaires (y compris la dolomite), mais pas sur les sols formés sur du granite ou du basalte. Le marama est présent dans la savane herbeuse et la savane arborée. On le rencontre en populations localisées.
Multiplication et plantation
La multiplication du marama se fait par graines. On dit parfois que la scarification améliorerait la germination. Un trempage tue les graines et il ne faut pas les semer dans des sols saturés d’eau. Le poids de 1000 graines se situe à 2–3 kg. Des résultats préliminaires obtenus en laboratoire montrent que la multiplication végétative est possible en utilisant des pousses.
Récolte
Dans sa région d’origine, les graines de marama sont récoltées dans la nature et à la main. Les tubercules sont déterrés à la main lorsqu’il pèsent environ 1 kg.
Rendement
Au Kalahari, ce sont les jeunes tubercules de marama de 1 an et d’environ 1 kg qui sont les plus prisés. Au bout de quelques années, les tubercules peuvent atteindre 10 kg et on a signalé des poids de 300 kg ; un tubercule de 277 kg contenait 224 l d’eau. On ne dispose pas de données sur les rendements en graines du marama.
Traitement après récolte
Les graines crues de marama se conservent bien et restent comestibles pendant des années. Un stockage au sec est préférable. L’huile s’extrait des graines soit par pression classique soit par extraction au solvant. Pour recueillir l’eau du tubercule, on gratte la peau et on perce un trou. On écrase la chair située dans le trou et autour avec un bâton, jusqu’à obtenir une consistance de bouillie. Cette bouillie est ensuite enveloppée dans un morceau de tissu et on presse des deux mains pour faire sortir l’eau. L’eau peut également être extraite des tubercules en pilant des morceaux dans un récipient.
Ressources génétiques
Le marama n’est pas considéré comme une espèce rare ou menacée. Aucune collection de ressources génétiques n’a été signalée. L’Institut international de recherche sur le bétail (ILRI) d’Addis Abeba en Ethiopie, le National Genebank de Muguga, au Kenya, et le Plant Genetic Resources Unit, Agricultural Research Council de Pretoria, en Afrique du Sud, détiennent chacun une entrée. Au stockage, les graines du marama se comportent de façon orthodoxe.
Sélection
On a signalé que des programmes d’amélioration du marama sont en cours aux Etats-Unis, en Australie et en Israël. L’analyse RAPD de 3 populations issues de diverses régions du Botswana a fait apparaître l’existence d’une grande diversité génétique, bien plus intra- que inter-population. Il est possible de trouver une diversité génétique suffisante pour la sélection en procédant à l’échantillonnage de 30–40 plantes prises sur 1 ou 2 populations.
Perspectives
On estime que le marama possède un potentiel considérable comme plante cultivée pour les régions arides et semi-arides ; il fait l’objet de recherches en Australie, en Israël et aux Etats-Unis (Texas). Il offre des possibilités pour ses graines grillées et son huile. Mais avant de pouvoir encourager sa culture à grande échelle, il est nécessaire de réunir davantage de données sur ses besoins écologiques, son aptitude à la culture et ses caractéristiques agronomiques. Par ailleurs, il faut porter attention à son amélioration génétique et à la collecte de ressources génétiques, et des recherches doivent être menées sur la présence de composants toxiques ou de facteurs antinutrionnels dans les graines et les tubercules.
Références principales
- Bower, N., Hertel, K., Oh, J. & Storey, R., 1988. Nutritional evaluation of marama bean (Tylosema esculentum, Fabaceae): analysis of the seed. Economic Botany 42(4): 533–540.
- Dakora, F.D., Lawlor, D.W. & Sibuga, K.P., 1999. Assessment of symbiotic nitrogen nutrition in marama bean (Tylosema esculentum L.) a tuber-producing underutilized African grain legume. Symbiosis 27: 269–277.
- Keegan, A.B. & van Staden, J., 1981. Marama bean, Tylosema esculentum, a plant worthy of cultivation. South African Journal of Science 77: 387.
- Ladizinsky, G. & Smartt, J., 2000. Opportunities for improved adaptation via further domestication. In: Knight, R. (Editor). Linking research and marketing opportunities for pulses in the 21st Century. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. pp 257–263.
- Monaghan, B.G. & Halloran, G.M., 1996. RAPD variation within and between natural populations of morama (Tylosema esculentum (Burchell) Schreiber) in southern Africa. South African Journal of Botany 62(6): 287–291.
- National Academy of Sciences, 1979. Tropical legumes: resources for the future. National Academy of Sciences, Washington, D.C., United States. 331 pp.
- Powell, A.M., 1987. Marama bean (Tylosema esculentum, Fabaceae) seed crop in Texas. Economic Botany 41: 216–220.
- Ross, J.H., 1977. Fabaceae, subfamily Caesalpinioideae. In: Ross, J.H. (Editor). Flora of southern Africa. Volume 16, part 2. Botanical Research Institute, Department of Agricultural Technical Services, Pretoria, South Africa. 142 pp.
- van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000. People’s plants: a guide to useful plants of southern Africa. Briza Publications, Pretoria, South Africa. 351 pp.
- Wickens, G.E., 1998. Ecophysiology of economic plants in arid and semi-arid lands. Springer Verlag, Berlin, Germany. 343 pp.
Autres références
- Brummitt, R.K. & Ross, J.H., 1976. A note on Tylosema (Leguminosae - Caesalpinioideae) from southern Africa. Kew Bulletin 31(2): 219–220.
- Chandel, K.P.S. & Singh, B.M., 1984. Some of our under-utilized plants. Indian Farming 34(2): 23–29.
- FAO, 1970. Amino-acid content of foods and biological data on proteins. FAO Nutrition Studies No 24, Rome, Italy. 285 pp.
- Francis, C.M. & Campbell, M.C., 2003. New high quality oil seed crops for temperate and tropical Australia. Rural Industries Research & Development Corporation Publication No 03/045. RIRDC, Canberra, Australia. 27 pp.
- Graham, P.H. & Vance, C.P., 2003. Legumes: importance and constraints to greater use. Plant Physiology 131: 872–877.
- Hao Gang, Zhang, D.X., Zhang, M.Y., Guo, L.X. & Li, S.J., 2003. Phylogenetics of Bauhinia subgenus Phanera (Leguminosae: Caesalpinioideae) based on ITS sequences of nuclear ribosomal DNA. Botanical Bulletin of Academia Sinica Taipei 44(3): 223–228.
- Hartley, M.L., Tshamekeng, E. & Thomas, S.M., 2002. Functional heterostyly in Tylosema esculentum (Caesalpinioideae). Annals of Botany 89: 67–76.
- Hornetz, B., 1993. On the development and acceptance of agropastoral (agrosilvipastoral) systems in the semiarid areas of northern Kenya. In: Baum, E., Wolff, P. & Zöbisch, M.A. (Editors). Acceptance of soil and water conservation strategies and technologies. Topics in applied resource management in the tropics. Volume 3. pp. 413–453.
- ILDIS, 2002. World database of Legumes, Version 6,05. International Legume Database & Information Service. [Internet] http://www.ildis.org/. April 2004.
- IPGRI, undated. Directory of Germplasm Collections. [Internet] http://www.ipgri.cgiar.org. April 2004.
- Keith, M.E. & Renew, R., 1975. Notes on some edible wild plants found in the Kalahari. Koedoe 18: 1–12.
- Ketshajwang, K.K., Holmback, J. & Yeboah, S.O., 1998. Quality and compositional studies of some edible Leguminosae seed oils in Botswana. Journal of the American Oil Chemists Society 75(6): 741–743.
- Leger, S., 1997. The hidden gifts of nature: A description of today’s use of plants in West Bushmanland (Namibia). [Internet] DED, German Development Service, Windhoek, Namibia & Berlin, Germany. http://www.sigridleger.de/book/. April 2004.
- Lock, J.M., 1989. Legumes of Africa: a check-list. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 619 pp.
- Mitchell, R.A.C., Keys, A.J., Gong, Y.-H. & Lawlor, D.W., 2003. Photosynthetic nitrogen and water-use efficiency of marama bean, Tylosema esculentum, an African legume. Comparative Biochemistry and Physiology Part A 134: s166.
- Schreiber, A., 1967. Caesalpiniaceae. Prodromus einer Flora von Südwestafrika. No 59. J. Cramer, Germany. 20 pp.
- USDA, ARS & National Genetic Resources Program, 2001. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Internet] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland, United States. http://www.ars-grin.gov/. April 2004.
- Victor, J.E., undated. Tylosema esculentum (Burch.) Schreiber. [Internet] FAO Crop and Grassland Service (AGPC), Rome, Italy. http://www.fao.o g/ag/AGP/AGPC/doc/GBASE/Safricadata/tylesc.htm. June 2004.
- Vietmeyer, N.D., 1978. The plight of the humble crops. Ceres 11(2): 23–27.
- Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962. The medicinal and poisonous plants of southern and eastern Africa. 2nd Edition. E. and S. Livingstone, London, United Kingdom. 1457 pp.
Sources de l'illustration
- Powell, A.M., 1987. Marama bean (Tylosema esculentum, Fabaceae) seed crop in Texas. Economic Botany 41: 216–220.
Auteur(s)
- L.J.G. van der Maesen, Biosystematics Group, Wageningen University, Gen. Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen, Netherlands
Citation correcte de cet article
van der Maesen, L.J.G., 2006. Tylosema esculentum (Burch.) A.Schreib. In: Brink, M. & Belay, G. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 18 décembre 2024.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U.