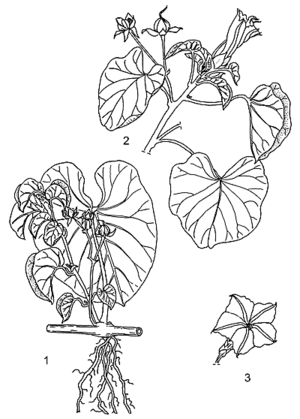Ipomoea asarifolia (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Colorant / tanin | |
| Médicinal | |
| Bois de feu | |
| Fourrage | |
| Auxiliaire | |
| Fibre | |
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
- Protologue : Syst. Veg. 4: 251 (1819).
- Famille : Convolvulaceae
- Nombre de chromosomes : 2n = 30
Synonymes
- Ipomoea repens Lam. (1791).
Noms vernaculaires
- Salsa brava, salsa da rua (Po).
Origine et répartition géographique
L’origine d’Ipomoea asarifolia n’est pas connue. On a émis l’hypothèse qu’il serait originaire du sud de l’Inde et que d’anciens visiteurs européens l’auraient disséminé dans le monde en raison de ses usages médicinaux. Selon d’autres sources, il serait originaire de l’Amérique tropicale. Il se rencontre dans presque toutes les régions tropicales, y compris l’Afrique du Nord ; en Afrique tropicale, il est présent depuis le Cap-Vert et le Sénégal jusqu’au Soudan, en passant par le Mali et le Cameroun, et vers le sud jusqu’à l’Angola, en Zambie et au Mozambique. Il semble absent en Afrique orientale et sur les îles de l’océan Indien.
Usages
Ipomoea asarifolia a de nombreux usages médicinaux dans toute l’Afrique de l’Ouest, malgré sa toxicité. Au Togo, la racine réduite en poudre dans de l’eau se boit contre les problèmes stomachiques. La décoction de racine se prend par voie orale contre les infections dues au ver de Guinée. Au Sénégal, on applique une compresse de la plante entière broyée sur des plaies, et on boit la décoction de la plante contre les hémorragies post-partum. En Côte d’Ivoire, la pâte des tiges feuillées mélangées avec du citron et de l’eau se prend comme ecbolique. Au Togo, les feuilles réduites en pâte s’appliquent en externe contre le tétanos ou la méningite. Au Mali, la cendre des tiges feuillées mélangée au beurre de karité se donne aux malades pour redonner des forces. Au Burkina Faso, la pâte des feuilles s’utilise en lotion contre les vers intestinaux. Au Bénin, la décoction des tiges feuillées avec celles de Cissus quadrangularis L. et de Borreria sp. s’utilise en bain contre les fractures ; en mélange avec d’autres plantes, elle s’applique sur les piqûres d’insectes. La décoction de feuilles se prend contre la fièvre et les convulsions. Au Nigeria, la décoction des parties aériennes s’applique contre les furoncles et s’absorbe contre les problèmes de l’estomac. La décoction de feuilles se prend en breuvage ou en lotion contre les refroidissements fébriles et les douleurs rhumatismales. Au Nigeria et en Mauritanie, les feuilles s’appliquent en cataplasme sur les plaies dues au ver de Guinée. Au Nigeria, les fleurs cuites avec des haricots se consomment en remède contre la syphilis. Dans le nord du Ghana, les bovins atteints de la maladie “garli” sont traités avec des concoctions de tiges et de racines en mélange avec celles d’autres plantes. Cette infusion est donnée à boire à l’animal, tandis que le charbon pulvérisé des plantes brûlées, mélangé au beurre de karité, est frictionné sur les articulations. La plante contient des substances toxiques et n’est pas consommée par l’homme, ni par les animaux brouteurs. Cependant, les jeunes feuilles seraient consommées en soupes pendant la saison sèche dans le nord du Bénin. Dans le nord du Nigeria, il provoquerait de la diarrhée chez les chevaux s’ils le broutent accidentellement, et il cause la folie et la mort chez les chameaux. Les chameaux au Sénégal, les moutons en Mauritanie et les poules au Soudan en consommeraient de petites quantités. Au Brésil, on a observé que la folie est un des symptômes associés à la consommation de la plante. Au Sénégal, la décoction de la plante s’utilise pour teindre les étoffes et les cheveux en noir, alors qu’en Mauritanie les cendres de la plante mélangées à l’indigo fournissent un colorant bleu pour les tissus. Les tiges séchées servent d’amadou, et les feuilles s’utilisent parfois pour envelopper les pieds et les mains après l’application de henné. La plante rampe sur les dunes de sable et est utile pour fixer le sable. Les longues tiges servent de cordes.
Production et commerce international
Ipomoea asarifolia n’est vendu que localement.
Propriétés
L’extrait des feuilles contient des glucides, des tanins, des saponines, des terpènes et des stéroïdes. Deux anthocyanines triacylées et tétraglucosylées, dérivées de la cyanidine, ont été isolées des fleurs. On a isolé quatre anthocyanines acylées des parties aériennes. Egalement des alcaloïdes du type ergoline ont été isolés des parties aériennes, mais on a trouvé qu’ils dérivent de champignons de la famille des Clavicipitaceae, champignons qui sont associés à la plante. Ce sont ces composés qui sont responsables pour les empoisonnements occasionnels chez les bovins, les moutons et les chèvres.
Les extraits à l’éthanol et à l’acétate d’éthyle de la plante ont montré un fort effet inhibiteur de l’acétylcholinestérase in vitro. Dans un essai de laboratoire, on a trouvé que l’extrait de feuilles contient des composés hépatoprotecteurs et même curatifs puissants contre les lésions hépatiques induites au CCl4 chez le rat, comme en témoignent les taux réduits d’enzymes indicatrices et la réduction des lésions induites au CCl4, qui est comparable à l’effet du médicament silymarine.
L’effet antinociceptif de l’extrait au méthanol des feuilles s’est montré par sa capacité à réduire le nombre des contorsions abdominales induites à l’acide acétique chez la souris. L’extrait montre une inhibition prolongée et puissante des douleurs, indication de propriétés antinociceptives ainsi qu’anti-inflammatoires.
L’analyse de la valeur nutritionnelle des feuilles d’Ipomoea asarifolia a montré la présence de quantités appréciables de protéines brutes (21 g par 100 g de matière sèche). Les niveaux de plomb, d’oxalates et de phytates dans les échantillons de la plante étaient bas comparés aux teneurs maximales permises pour ces composés. Cependant, le risque d’une intoxication qui ressemble à l’ergotisme réduit énormément la valeur de la plante comme fourrage.
Falsifications et succédanés
Ipomoea asarifolia et Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. se ressemblent beaucoup et s’utilisent souvent à des fins similaires.
Description
Plante herbacée vivace, glabre, rampante, atteignant 3 m de long, à courtes pousses érigées ; tiges épaisses, cylindriques ou anguleuses. Feuilles alternes, simples et entières ; pétiole de 3–8,5 cm de long, assez épais, profondément sillonné au-dessus, lisse ou finement muriqué ; limbe circulaire à réniforme, de 3,5–7 cm × 3,5–8,5 cm, base cordée à lobes arrondis, apex arrondi, parfois émarginé, mucronulé, coriace, plié le long de la nervure médiane. Inflorescence : cyme axillaire, souvent accompagnée d’une pousse feuillée axillaire, portant 1 à quelques fleurs ; pédoncule de 2–5 cm de long ; bractées ovales, minuscules. Fleurs bisexuées, presque régulières, 5-mères ; pédicelle de 1,5–3 cm de long ; sépales inégaux, elliptiques-oblongs, obtus, mucronulés, les sépales internes de 8–11 mm de long, les sépales externes de 5–8 mm de long, plus ou moins muriqués ; corolle en entonnoir, jusqu’à 6,5 cm de long, violet rosé avec un centre plus foncé ; étamines 5, insérées près de la base du tube de la corolle, filets filiformes, inégaux en longueur ; disque annulaire ; ovaire supère, glabre, style filiforme, inclus, stigmate 2-globuleux. Fruit : capsule globuleuse, glabre, de 1–1,5 cm de diamètre. Graines de 5–7 mm de long, noires, glabres.
Autres données botaniques
Ipomoea est un grand genre complexe de 500–600 espèces de lianes et d’arbustes, largement réparti dans toutes les régions tropicales et subtropicales.
Plusieurs autres Ipomoea spp. présentes en Afrique de l’Ouest, ont des usages médicinaux.
Ipomoea argentaurata
Ipomoea argentaurata Hallier f. est une plante herbacée annuelle poilue à feuilles lancéolées et à fleurs rose pâle avec un centre foncé ; il est présent dans toute l’Afrique de l’Ouest à l’exception des parties les plus humides, jusqu’en Centrafrique et au Gabon. En Côte d’Ivoire, on boit la décoction des parties aériennes, en mangeant les noix de cola, pour améliorer la spermatogenèse. Au Bénin, la décoction de feuilles, en combinaison avec les feuilles de Ficus vallis-choudae Delile, se boit pour traiter l’hyperthermie. La décoction de rameaux feuillés se prend pour soigner le kwashiorkor.
Ipomoea dichroa
Ipomoea dichroa Hochst. ex Choisy est une plante herbacée volubile annuelle poilue à petites fleurs violettes, qui est répandue en Afrique de l’Ouest, dans certaines parties de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, et aussi en Inde. Au Nigeria, les feuilles séchées réduites en poudre s’appliquent sur les brûlures. Les graines, en combinaison avec celles d’Hibiscus sabdariffa L., se prennent comme purgatif. Les racines épaissies servent d’amulette d’amour. La plante est broutée par le bétail dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea Jacq. (“Mexican morning glory”) est une plante herbacée vivace à fleurs bleu pâle, originaire de l’Amérique tropicale, mais il s’est répandu vers l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique tropicale, et vers certaines parties de l’Asie et de l’Australie. En Afrique tropicale, il est présent au Bénin, au Nigeria, en Ethiopie et au Soudan, mais probablement aussi ailleurs. Au Soudan, les graines grillées et réduites en poudre sont mélangées avec du yaourt et absorbées comme purgatif.
Ipomoea turbinata
Ipomoea turbinata Lag. (synonyme : Ipomoea muricata (L.) Jacq. non Cav.) est normalement une plante grimpante annuelle, originaire de l’Amérique centrale, mais largement naturalisée dans les régions tropicales et subtropicales, y compris dans les savanes herbeuses et les ripisylves en Afrique tropicale. Ses graines s’utilisent par endroits en Afrique de l’Ouest comme laxatif et succédané du café, mais aux Philippines les graines, les tiges et les feuilles ont été utilisées en médecine traditionnelle pendant des générations, notamment pour soigner le mal d’oreille, la pharyngite, la dermatite allergique, les plaies et les brûlures, ainsi que comme antidote contre l’empoisonnement. Des essais ont montré que l’extrait des graines a des propriétés analgésiques, antibactériennes et antifongiques. Ipomoea turbinata est aussi planté comme ornemental, mais dans certaines régions il est connu comme une adventice nuisible.
Croissance et développement
Dans des conditions environnementales contrôlées, Ipomoea asarifolia a produit des feuilles caractérisées par une matière sèche et une superficie foliaire élevées par rapport à la matière sèche totale de la plante dans des conditions d’illumination réduite. Dans des conditions d’illumination élevée, le taux de croissance a d’abord augmenté, puis il a plafonné. On peut trouver Ipomoea asarifolia en fleurs aussi longtemps qu’il y a assez d’eau.
Ecologie
Ipomoea asarifolia est une plante commune sur les sols hydromorphes, dans les zones basses des vallées à l’intérieur des terres ou le long des cours d’eau et sur les berges de rivières. Il est parfois adventice.
Multiplication et plantation
Ipomoea asarifolia se multiplie dans la nature par graines et par morceaux de tige. Dans un essai au Brésil pour étudier les taux de survie des graines des plantes adventices, le taux de survie des graines d’Ipomoea asarifolia était trop bas pour permettre une augmentation de leur nombre dans la banque de graines du sol. La scarification mécanique des graines a augmenté le taux de germination jusqu’à 100% au bout de 3 jours. La scarification chimique n’avait qu’un effet limité. La germination ne dépendait pas d’une exposition à la lumière.
Maladies et ravageurs
En Amérique du Sud, Ipomoea asarifolia est attaqué par des chrysomèles (Stolas sp.). La chrysomèle est fortement parasitée par la guêpe Emersonella neveipes, qui est aussi un parasite sur Chelymorpha cassidea, un ravageur de la patate douce.
Ressources génétiques
Ipomoea asarifolia est répandu et commun et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives
Ipomoea asarifolia gardera son importance en phytothérapie, bien que davantage de recherches s’imposent afin d’identifier les composés responsables pour les activités et leur pharmacologie. La symbiose avec un champignon toxique requiert plus d’études toxicologiques, ainsi que des méthodes pour nettoyer les parties aériennes avant qu’on les utilise comme médicament.
Références principales
- Austin, D.F., 2005. The enigmatic 'salsa da rua' - Ipomoea asarifolia (Convolvulaceae). Ethnobotany 17(1/2): 41–48.
- Baerts, M. & Lehmann, J., 2012. Ipomoea repens. [Internet] Prelude Medicinal Plants Database. Metafro-Infosys, Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium http://www.metafro.be/prelude. Accessed December 2012.
- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.
- Farida, T., Salawu, O.A., Tijani, A.Y. & Ejiofor, J.I., 2012. Pharmacological evaluation of Ipomoea asarifolia (Desr.) against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Journal of Ethnopharmacology 142(3): 642–646.
- Gonçalves, M.L., 1987. Convolvulaceae. In: Launert, E. (Editor). Flora Zambesiaca. Volume 8, part 1. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 9–129.
- Lawal, U., Ibrahim, H., Agunu, A. & Abdulahi, Y., 2010. Anti-inflammatory and analgesic activity of water extract from Ipomoea asarifolia Desr (Convolvulaceae). African Journal of Biotechnology 9(51): 8877–8880.
- Meira, M, Pereira da Silva, E., David, J.M. & David, J.P., 2012. Review of the genus Ipomoea: traditional uses, chemistry and biological activities. Revista Brasileira de Farmacognosia 22(3): 682–713.
- Markert, A., Steffan, N., Ploss, K., Hellwig, S., Steiner, U, Drewke, C., Li, S.M., Boland, W. & Leistner, E., 2008. Biosynthesis and accumulation of ergoline alkaloids in a mutualistic association between Ipomoea asarifolia (Convolvulaceae) and a clavicipitalean fungus. Plant Physiology 147(1): 296–305.
- Medeiros, R.M.T., Barbosa, R.C., Riet-Correa, F., Lima, E.F., Tabosa, I.M., Barros, S.S., De Gardner, D.R. & Molyneux, R.J., 2003. Tremorgenic syndrome in goats caused by Ipomoea asarifolia in northeastern Brazil. Toxicon 41: 933–935.
- Salles, H.O., Vasconcelos, I.M., Santos, L.F.L., Oliveira, H.D., Costa, P.P.C., Nascimento, N.R.F., Santos, C.F., Sousa, D.F., Jorge, A.R.C., Menezes, D.B., Monteiro, H.S.A., Gondim, D.M.F. & Oliveira, J.T.A., 2011. Towards a better understanding of Ipomoea asarifolia toxicity: Evidence of the involvement of a leaf lectin. Toxicon 58: 502–508.
Autres références
- Achigan-Dako, E.G., Pasquini, M.W., Assogba-Komlan, F., N’danikou, S., Yédomonhan, H., Dansi, A. & Ambrose-Oji, B., 2010. Traditional vegetables in Benin: diversity, distribution, ecology, agronomy, and utilisation. Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, Benin. 252 pp.
- Agaie, B.M., Salisu, A. & Ebbo, A.A., 2007. A survey of common toxic plants of livestock in Sokoto State, Nigeria. Scientific Research and Essays 2(2): 40–42.
- Dias Filho, M.B., 1999. Potential for seed bank formation of two weed species from Brazilian Amazonia. Planta Daninha 17(2): 183–188.
- Ekenyem, B.U., 2006. An assessment of Ipomoea asarifolia leaf meal as feed ingredient in grower pig diet. Pakistan Journal of Nutrition 5(1): 39–42.
- Ekenyem, B.U. & Madubuike, F.N., 2006. An assessment of Ipomoea asarifolia leaf meal as feed ingredient in broiler chick production. Pakistan Journal of Nutrition 5(1): 46–50.
- Ekpa, O.D., 1996. Nutrient composition of three Nigerian medicinal plants. Food Chemistry 57(2): 229–232.
- Feitosa, C.M., Freitas, R.M., Luz, N.N.N.., Bezerra, M.Z.B. & Trevisan, M.T.S., 2011. Acetylcholinesterase inhibition by some promising Brazilian medicinal plants. Brazilian Journal of Biology 71(3): 783–789.
- Heine, H., 1963. Convolvulaceae. In: Hepper, F.N. (Editor). Flora of West Tropical Africa. Volume 2. 2nd Edition. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. pp. 335–352.
- Jegede, I.A., Nwinyi, F.C., Ibrahim, J., Ugbabe, G., Dzarma, S. & Kunle, O.F., 2009. Investigation of phytochemical, anti inflammatory and anti nociceptive properties of Ipomoea asarifolia leaves. Journal of Medicinal Plants Research 3(3): 160–165.
- Kucht, S., Gross, J., Hussein, Y., Grothe, T., Keller, U., Basar, S., Konig, W. A., Steiner, U., & Leistner, E., 2004. Elimination of ergoline alkaloids following treatment of Ipomoea asarifolia (Convolvulaceae) with fungicides. Planta 219(4): 619–625.
- Pale, E., Kouda Bonafos, M., Nacro, M., Vanhaelen, M. & Vanhaelen-Fastre, R., 2003. Two triacylated and tetraglucosylated anthocyanins from Ipomoea asarifolia flowers. Phytochemistry 64(8): 1395–1399.
Afriref references
Sources de l’illustration
- Andrews, F.W., 1956. The flowering plants of the Anglo-Egyptian Sudan, Volume 3. Buncle, Arbroath, United Kingdom. 579 pp.
Auteur(s)
- D.E. Tsala, Department of Life and Earth Sciences, Higher Teachers’ Training College, University of Maroua I, P.O. Box 55, Maroua, Cameroon
Citation correcte de cet article
Tsala, D.E., 2013. Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. In: Schmelzer, G.H. & Gurib-Fakim, A. (Editeurs). Prota 11(2): Medicinal plants/Plantes médicinales 2. PROTA, Wageningen, Pays Bas. Consulté le 31 mars 2025.
- Voir cette page sur la base de données Prota4U