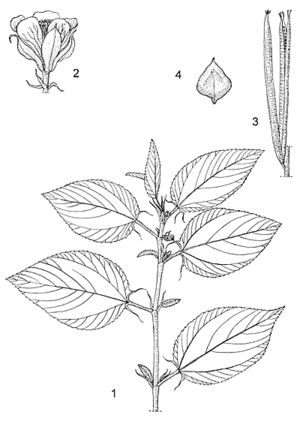Corchorus olitorius (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Médicinal | |
| Fourrage | |
| Fibre | |
| Sécurité alimentaire | |
- Protologue: Sp. pl. 1 : 529 (1753).
- Famille: Tiliaceae (APG: Malvaceae)
- Nombre de chromosomes: 2n = 14
Noms vernaculaires
- Corète potagère, jute potager, mauve des Juifs, craincrain, krinkrin (Fr).
- Jew’s mallow, jute mallow, krinkrin, tossa jute, bush okra, West African sorrel (En).
- Coreté, caruru da Bahia (Po).
- Mlenda (Sw).
Origine et répartition géographique
L’origine géographique de Corchorus olitorius est souvent controversée, car on le cultive depuis des siècles tant en Asie qu’en Afrique, et il est présent à l’état sauvage sur les deux continents. Certains auteurs considèrent l’Inde ou la région indo-birmane comme le centre d’origine de Corchorus olitorius et de plusieurs autres espèces de Corchorus. Cependant, la présence en Afrique d’un plus grand nombre d’espèces sauvages de Corchorus et la plus grande diversité génétique intraspécifique de Corchorus olitorius indiquent que l’Afrique serait le premier centre d’origine du genre, avec un centre secondaire de diversité dans la région indo-birmane. Actuellement, Corchorus olitorius est largement répandu dans toutes les régions tropicales, et il est probablement présent dans tous les pays d’Afrique tropicale.
En Afrique tropicale, il est signalé comme légume sauvage ou cultivé dans de nombreux pays. C’est un légume-feuilles important en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, au Soudan, au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. La corète potagère est également cultivée comme légume-feuilles dans les Caraïbes, au Brésil, en Inde, au Bangladesh, en Chine, au Japon, en Egypte et au Proche-Orient. Elle est cultivée pour la production de jute en Asie (Inde, Bangladesh, Chine) comme Corchorus capsularis L., mais en Afrique elle ne joue aucun rôle en tant que plante à fibres, même si on peut faire un usage domestique de cette fibre.
Usages
La corète potagère est utilisée comme légume-feuilles mucilagineux. Les feuilles cuites donnent une sauce gluante, comparable à celle de gombo. Au Nigeria, on trouve que cette sauce accompagne bien la consommation des boulettes féculentes faites avec du manioc, de l’igname ou du mil. Pendant la saison sèche, on utilise la poudre des feuilles séchées pour préparer cette sauce. Les fruits immatures, qu’on appelle “bush okra” (“gombo de brousse”), sont également séchés et réduits en poudre en vue de la préparation de cette sauce gluante. En Afrique de l’Est, il existe plusieurs recettes : la corète potagère peut être cuite avec du niébé, du potiron, des feuilles de taro, de la patate douce, du lait et du beurre, de la viande, et relevée avec du piment et du citron.
Le jute a été pendant plus de 100 ans la fibre la plus largement utilisée pour l’emballage grâce à sa solidité et à sa durabilité, ses faibles coûts de production, sa facilité de fabrication et sa disponibilité en grandes quantités homogènes. Néanmoins, la production de jute est insignifiante en Afrique. Les types de Corchorus olitorius utilisés comme légume-feuilles sont assez différents de ceux utilisés pour la production de jute. Les tiges entières de jute sont adaptées à servir de matériel de base pour la pâte à papier. Cependant, lorsque le jute est utilisé pour la pâte, c’est normalement sous forme de chutes de la fabrication de toile d’emballage, de sacs à sucre anciens et d’autres emballages. La pâte qui en résulte est transformée en papier épais et dur, adapté aux cartes et étiquettes. Le cœur central ligneux (“stick”) qui reste après l’enlèvement du liber peut également être transformé en papier, carton et cellulose.
Des lamelles de racines de corète potagère sont utilisées au Kenya pour traiter les maux de dents, une décoction de racine sert de tonique, les pousses feuillées servent contre les troubles cardiaques au Congo, une infusion de feuilles est absorbée contre la constipation en Tanzanie, et les graines servent de purgatif et de fébrifuge au Nigeria.
Production et commerce international
La corète potagère est un des principaux légumes-feuilles dans de nombreux pays et elle est fréquemment cultivée et commercialisée. Aucune donnée statistique sur sa production ou sa vente n’est disponible. Il existe un commerce international, non comptabilisé, avec des pays voisins. En Europe, la corète est commercialisée en poudre en tant que produit libanais, sous son nom arabe de “meloukhia”.
La production mondiale de jute (données combinées de Corchorus olitorius et Corchorus capsularis) est stable depuis 40 ans. Dans la période 2004–2008, elle avoisinait les 2,74 millions t de fibres brutes par an. L’Inde (1,78 million t/an sur 781 000 ha) et le Bangladesh (827 000 t/an sur 414 000 ha) ensemble ont produit plus de 95% du total. Les plaines inondables dans le bas delta des rivières Gange et Brahmapoutre combinent les conditions optimales pour la culture de jute (en ce qui concerne le climat, le sol et l’eau de surface adéquate pour le rouissage) avec la disponibilité d’une main-d’œuvre agricole bon marché. D’autres pays avec une production notable de jute en 2004–2008 étaient la Chine (49 000 t/an), l’Ouzbékistan (20 000 t), le Népal (17 000 t), le Vietnam (14 000 t) et le Myanmar (14 000 t). En Afrique tropicale, le jute était produit au Soudan (3900 t/an), au Zimbabwe (2400 t) et au Cameroun (100 t). La plupart des fibres de jute sont transformées à l’intérieur des pays producteurs. En 2004–2008, les exportations mondiales de fibres brutes de jute s’élevaient à environ 450 000 t/an, principalement depuis le Bangladesh (400 000 t).
Propriétés
La composition des feuilles de Corchorus olitorius est la suivante par 100 g de partie comestible : eau 80,4 g (74,2–91,1) d’eau, énergie 243 kJ (58 kcal), protéines 4,5 g, lipides 0,3 g, glucides 12,4 g, fibres 2,0 g, Ca 360 mg, P 122 mg, Fe 7,2 mg, β-carotène 64) μg, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,53 mg, niacine 1,2 mg, acide ascorbique 80 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Cette composition correspond à celle d’autres légumes-feuilles vert foncé, mais la teneur en matière sèche des feuilles fraîches de la corète est plus élevée que la moyenne. La composition et en particulier la teneur en micronutriments sont fortement influencées par des facteurs externes tels que la fertilité du sol et la fertilisation. L’utilisation d’engrais azoté améliore largement la teneur en micronutriments, par ex. le Fe, le P, le Ca, le carotène et la vitamine C.
Le polysaccharide mucilagineux des feuilles est riche en acide uronique (65%) et est composé de rhamnose, de galactose, de glucose, d’acide galacturonique et d’acide glucuronique dans un rapport molaire de 1,0:0,2:0,2:0,9:1,7 en plus des 3,7% de groupements acétyles.
Les fibres de jute proviennent du liber. Leur utilisation se limite à la fabrication de produits grossiers, car le rapport longueur/diamètre des filaments de jute n’est que de 100–120, bien au-dessous du minimum de 1000 nécessaire pour avoir une bonne qualité de filage. Les cellules individuelles des fibres font (0,5–)2–2,5(–6,5) mm de long et (9–)15–20(–33) μm de diamètre. La longueur des cellules fibreuses diminue du sommet vers la base de la tige, tandis que la largeur augmente. La largeur du lumen est très variable sur la longueur de la cellule fibreuse, le lumen se fermant de temps en temps. Les cellules des fibres sont collées entre elles en filaments atteignant 250 mm de long. La résistance à la traction, l’allongement à la rupture, et le module de Young des fibres de jute sont de 187–775 N/mm², de 1,4–3,1% et de 3000–55 000 N/mm² respectivement.
Le jute a une température d’inflammation faible de 193°C, ce qui présente un risque non négligeable d’incendie dans les entrepôts. Les fibres de jute contiennent 45–84% d’α-cellulose, 12–26% d’hémicelluloses, 5–26% de lignine, 0,2% de pectine et 1–8% de cendres. Les fibres de jute peuvent être traitées avec un alcali fort (“woollenization”), ce qui réduit leur longueur, leur donne une douceur au toucher et les rend plissées ou ondulées, aboutissant à leur donner une apparence laineuse. Le cœur central ligneux a une durabilité médiocre dans des conditions exposées. Les fibres du cœur central font de 0,5–0,8 mm de long et 29–42 μm de large.
Les feuilles de Corchorus olitorius contiennent des composés phénoliques antioxydants, dont le plus important est l’acide 5-cafféoylquinique. Certains ionone glucosides ont également été isolés des feuilles ; ils ont montré une activité inhibitrice de libération d’histamine à partir de cellules d’exsudat péritonéal du rat induite par réaction antigène-anticorps. Les graines sont toxiques pour les mammifères et les insectes. Elles contiennent des hétérosides cardiaques.
Falsifications et succédanés
On peut remplacer Corchorus olitorius dans les sauces gluantes par d’autres espèces de Corchorus (qu’on appelle également corète), à savoir : les formes sauvages et cultivées de Corchorus tridens L. et les espèces sauvages Corchorus asplenifolius Burch., Corchorus fascicularis Lam., Corchorus trilocularis L. et Corchorus aestuans L.
Les fibres de kénaf (Hibiscus cannabinus L.) et de roselle (Hibiscus sabdariffa L.) sont plus grossières et moins onéreuses que celles de jute. Elles sont des substituts acceptables pour le jute dans la fabrication de produits d’emballage grossiers. D’autres fibres libériennes qui peuvent servir de substituts au jute sont celles de jute du Congo (Urena lobata L.) et de l’abrome (Abroma augusta (L.) L.f.). Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le jute a dû faire face à une substitution en tant que matériel pour la fabrication de sacs par des fibres synthétiques telles que le polypropylène et le polyéthylène.
Description
- Plante herbacée annuelle érigée jusqu’à 2(–4) m de haut, habituellement fortement ramifiée ; tiges rougeâtres, fibreuses et dures.
- Feuilles alternes, simples ; stipules étroitement triangulaires avec une longue pointe ; pétiole de (0,5–)1–7 cm de long ; limbe étroitement ovale, ovale ou elliptique, de 4–15(–20) cm × 2–5(–11) cm, cunéiforme ou obtus et muni d’appendices sétacés jusqu’à 2,5 cm de long à la base, acuminé à aigu à l’apex, à bord denté en scie ou crénelé, presque glabre, habituellement vert foncé brillant, à 3–7 nervures partant de la base.
- Inflorescence : fascicule axillaire de 1–4 fleurs, muni de bractées.
- Fleurs bisexuées, régulières, habituellement 5-mères, à pédicelle court ; sépales libres, étroitement obovales, de 5–7 mm de long ; pétales libres, obovales, de 5–7 mm de long, jaunes, caduques ; étamines nombreuses ; ovaire supère, habituellement 5-loculaire, style court.
- Fruit : capsule cylindrique jusqu’à 7(–10) cm de long, cannelée, avec un bec court, habituellement déhiscente par 5 valves, contenant de nombreuses graines.
- Graines anguleuses, de 1–3 mm de long, gris foncé.
- Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 1–2 cm de de long ; cotylédons foliacés, largement elliptiques à circulaires, de 3–8 mm de long.
Autres données botaniques
Le genre Corchorus contient un nombre incertain d’espèces, estimé à 40–100. Il existe deux groupes de cultivars importants de Corchorus olitorius. Les formes légumières sont groupées dans le Groupe Olitorius, caractérisé par une hauteur de la plante de moins de 2 m, souvent pas plus d’1 m, et un port plus ou moins fortement ramifié. Les formes à fibres sont classées dans le Groupe Textilis, avec des plantes hautes de 4(–5) m et seulement légèrement ramifiées en hauteur. A l’intérieur du Groupe Olitorius, il y a de nombreux cultivars locaux, par ex. à floraison précoce ou tardive, et montrant des différences dans le port de la plante et la forme des feuilles. Au Nigeria, le cultivar apprécié ‘Amugbadu’ est réputé pour son adaptation au repiquage et à la récolte par coupes échelonnées ; il a des feuilles finement dentées en scie, elliptiques-ovales, alors que ‘Oniyaya’ possède des feuilles plus petites et plus grossièrement dentées, qu’il est fortement ramifié et plus indiqué pour un semis direct et une récolte en un seul passage. Le cultivar ‘Géant de Bertoua’ au Cameroun possède de très grands limbes foliaires largement ovales. On rencontre des cultivars à feuilles profondément et irrégulièrement dentées (‘Incisifolius’) au Bénin et au Cameroun.
Corchorus capsularis
Corchorus capsularis (“jute blanc”) est une plante herbacée annuelle, érigée, atteignant 2(–4) m de haut avec des fruits globuleux ; il est probablement originaire de la Chine méridionale, d’où il a été introduit en Inde et au Bangladesh, centres actuels de sa production. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la plante a été introduite dans de nombreux pays tropicaux, mais ce n’est qu’au Brésil que l’introduction a réussi. Des essais ont été menés en Gambie, en Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria, au Soudan, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Malawi. L’échec de la culture dans d’autres pays que le Brésil a été attribué au mauvais choix des cultivars et aux contraintes en main-d’œuvre. De nouvelles tentatives pour introduire Corchorus capsularis en tant que plante cultivée en Afrique tropicale nécessiteraient des investissements considérables dans des installations pour les traitements après récolte (par ex. rubanage, rouissage, lavage), car la production ne sera pas économique sans ces équipements. Les fibres de Corchorus capsularis sont moins fines, moins douces et moins brillantes que celles de Corchorus olitorius. Le premier a des fibres habituellement blanches, tandis que le second a des fibres jaunâtres à rougeâtres.
Croissance et développement
La croissance des plantes de Corchorus olitorius est rapide. En situation de jours courts, la floraison débute environ un mois après la levée et se poursuit pendant environ 1–2 mois, selon le type et le milieu. Les fleurs sont habituellement autogames, mais il y a une fécondation croisée de près de 10%. Après environ 3–4 mois, les fruits sont mûrs, les feuilles tombent et la plante meurt.
Ecologie
Les formes sauvages de Corchorus olitorius poussent dans la savane, les jachères ou les champs abandonnés, souvent à proximité des marécages, des rivières et des lacs, jusqu’à une altitude de 1250(–1750) m. La corète potagère se développe bien en milieu chaud et humide. Dans les zones de la savane et du Sahel, elle pousse particulièrement bien pendant la chaude saison des pluies. Elle est cultivée là où la pluviométrie annuelle est de 600–2000 mm. La température optimale est de 25–32°C. Sa croissance s’arrête en-dessous de 15°C. La corète potagère est une espèce de jours courts. Au Nigeria, une journée longue de 12,5 heures a donné une croissance végétative beaucoup plus importante, exprimée en poids de racines, de tiges et de feuilles, qu’une journée de 11,5 heures, mais la production de fruits et de graines était plus élevée avec une photopériode de 11,5 heures. La corète potagère préfère des sols de limon sableux riches en matières organiques et pousse difficilement sur de l’argile lourde.
Multiplication et plantation
En général, les paysans n’ont pas accès aux semences améliorées, mais récoltent leurs propres semences. Dans ce but, ils gardent quelques plantes dans leur jardin ou dans leur champ jusqu’à la maturité des fruits. Pour un bon rendement en graines de 25 g par plante, on recommande un écartement de 50 cm entre les lignes et sur la ligne. Une production de semences commerciales peut atteindre 600 kg/ha. Les graines sont mûres lorsque toutes les feuilles sont tombées. Pour une production de semences à la ferme, on récolte les tiges avec les fruits, et après séchage au soleil on les conserve jusqu’à la saison suivante. Dans les villages du nord de la Côte d’Ivoire, les femmes conservent les fruits dans la cuisine au-dessus du foyer. Les fruits des plantes abandonnées au champ contiennent également toujours des semences viables jusqu’à la saison des pluies suivante. Ces fruits s’ouvrent dès le début des pluies et les graines s’éparpillent. Des graines bien séchées gardent une forte capacité de germination pendant plusieurs années. Un g contient environ 470 graines. Les graines fraîches et parfois aussi les graines anciennes sont dormantes à cause de l’imperméabilité de leurs téguments. C’est un problème important pour la culture de la corète potagère. Afin de lever la dormance, il est recommandé d’emballer les graines dans un morceau de tissu en coton pour les immerger pendant 5 secondes dans de l’eau presque bouillante avant de les semer. Une autre méthode consiste en une scarification avec du papier de verre.
En culture traditionnelle au champ, les paysans sèment à la volée sans tenir compte de la densité optimale. Ils cultivent souvent la corète potagère en association avec d’autres légumes ou cultures vivrières telles que le gombo, la tomate, la pastèque, l’arachide ou l’igname.
Les producteurs de légumes péri-urbains cultivent la corète potagère sur planches en culture pure. Le semis direct est surtout pratiqué pour une récolte unique par arrachage ou par fauchage au ras du sol. Le semis est effectué en lignes écartées de 30–50 cm avec un espacement de 10–15 cm sur la ligne. Pour la récolte plus courante par coupes échelonnées, on sème 10–20 g de graines par 10 m² en pépinière dans un sol bien ameubli. Lorsque les plants atteignent 5–10 cm de haut, ils sont repiqués à un espacement de 10–20 cm sur la ligne et de 30–50 cm entre les lignes. Dans des essais au Ghana, on a obtenu le rendement le plus élevé, 50 kg de pousses commercialisables ou 29 kg de feuilles comestibles sur 10 m², avec un écartement de 10 cm × 45 cm.
Gestion
La corète potagère est habituellement cultivée sans grand soin comme culture pluviale. En production péri-urbaine, les producteurs pratiquent une irrigation manuelle pendant la saison sèche d’au moins 6 mm chaque jour. On peut appliquer jusqu’à 20 t/ha d’engrais organique. Une application de fond avec du NPK (par ex. 15–15–15 à 400 kg/ha) et un complément d’azote sont recommandés en vue d’un rendement optimal. L’azote nitrique donne un meilleur résultat que l’azote ammoniacal.
Maladies et ravageurs
La corète potagère résiste plutôt bien aux maladies et aux ravageurs. Sclerotium rolfsii, responsable de la pourriture du pied et d’un flétrissement, représente parfois un problème. Des espèces de Curvularia donnent des taches noires sur les feuilles, et des Cercospora des taches circulaires sur les feuilles. Ces maladies fongiques sont contenues par une culture sur des planches bien drainés et par un espacement large. Une maladie virale transmise par des cicadelles et causant une déformation des feuilles et un retard de croissance a été identifiée au Nigeria.
Les ravageurs les plus nuisibles sont le criquet puant (Zonocerus variegatus), des chenilles (Acrea spp.), la légionnaire (Spodoptera littoralis) et des altises (Podagrica spp.). Pendant la saison sèche, des acariens rouges (Tetranychus cinnabarinus) attaquent souvent les feuilles. La lutte par pulvérisation avec des pesticides recommandés est rarement appliquée.
La corète potagère est très sensible aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.). Les méthodes de lutte comprennent la rotation des cultures, en évitant de mettre en culture des plantes sensibles aux nématodes à galles pendant au moins un an, et le maintien d’une bonne teneur du sol en matière organique.
Récolte
La première récolte a lieu environ 4–6 semaines après le repiquage en coupant des pousses longues de 20–30 cm à une hauteur de 10–20 cm au-dessus du sol. Cette coupe favorise le développement de rejets latéraux. Ensuite, on peut effectuer une coupe toutes les 2–3 semaines, avec un total de 2–8 coupes. Pour une récolte unique d’une culture en semis direct, les plantes sont arrachées ou coupées au ras du sol lorsqu’elles font 30–40 cm de haut, 3–5 semaines après la levée et avant le développement des fruits. Les plantes sont mises en bottes pour la vente. Dans les systèmes de culture associée, les paysans ont tendance à récolter à intervalles irréguliers. La corète potagère sauvage est récoltée dans la nature au fur et à mesure des besoins, et habituellement pour la consommation domestique.
Une culture pour la production de jute est généralement récoltée 100–120 jours après le semis, lorsque les plantes commencent à fructifier.
Rendement
Au Nigeria, le cultivar ‘Amugbadu’ peut donner un rendement de 20–25 kg par planche de 10 m² avec 3–9 coupes sur une période de 3–4 mois. Dans un essai au Cameroun, un rendement de 38 t/ha a été obtenu avec le cultivar ‘Ewondo’ sur une parcelle bien fertilisée. Les paysans, cependant, obtiennent habituellement des rendements moyens de 5–15 t/ha.
Le rendement mondial moyen de jute est environ de 2,2 t de fibres brutes par ha, mais des rendements de 5 t/ha ont été obtenus au Bangladesh avec des cultivars améliorés cultivés avec des pratiques agronomiques optimales.
Traitement après récolte
Les feuilles de la corète potagère ne peuvent être conservées longtemps. Le produit est souvent vendu le jour de la récolte, et on le maintient constamment humide. S’il est refroidi à 20°C on peut le garder environ 1 semaine, et en chambre froide plusieurs semaines. Si les feuilles sont séchées et réduites en poudre, le produit peut être stocké pendant au moins 6 mois.
Les tiges de jute sont rouies dans l’eau pendant une période d’environ (8–)15–20(–30) jours afin de libérer les fibres de l’écorce. Lorsque le rouissage est terminé, les fibres sont extraites manuellement des tiges, puis lavées et séchées, et enfin calibrées et emballées.
La mise en pâte des déchets tels que les chutes de toile d’emballage et de sacs anciens se fait principalement par des procédés chimiques tels que le procédé à la soude. Les fibres rouies peuvent être mises en pâte de manière satisfaisante avec le procédé au raffineur/réducteur en pâte mécanique (RMP) ; le traitement avec le champignon de la pourriture blanche Ceriporiopsis subvermispora avant le raffinage donne des économies considérables en énergie et des propriétés de résistance accrue. Les fibres libériennes non rouies ont été réduites en pâte à l’échelle expérimentale par le procédé neutre au sulfite-anthraquinone (NS-AQ), mais les rendements étaient faibles et les intrants de produits chimiques élevés en comparaison avec la réduction en pâte de fibres rouies. Les cœurs centraux peuvent se réduire en pâte par différents procédés chimiques et chimio-mécaniques. Les essais de réduction en pâte des tiges entières ont démontré que le procédé à la soude-amine (procédé à la soude avec des amines comme additifs) donne des rendements plus élevés et de meilleures propriétés physiques que le procédé à la soude et le procédé kraft.
Ressources génétiques
Le risque d’érosion génétique est négligeable car il n’existe pratiquement pas de commerce de graines de cultivars améliorés. Au Nigerian Horticultural Research Institute (NIHORT) à Ibadan, une collection de types locaux est maintenue. La banque de gènes du Bangladesh Jute Research Institute à Dacca a la responsabilité de la conservation des ressources génétiques mondiales de jute. Elle a une collection de presque 1500 entrées de Corchorus olitorius résultant de divers projets de prospection de ressources génétiques en Asie et en Afrique de l’Est.
Sélection
Les paysans sélectionnent les plantes les plus vigoureuses avec les meilleures propriétés mucilagineuses. Lorsqu’ils préfèrent avoir de petites feuilles, les paysans sélectionnent en vue d’une ramification abondante. Au NIHORT à Ibadan, des sélections ont été effectuées pour une croissance précoce rapide, une grande taille de feuilles, des feuilles vert foncé brillantes et une floraison tardive. Le croisement manuel s’est avéré difficile à cause de la chute des fleurs après castration.
La sélection de jute avec comme objectifs des rendements plus élevés, une qualité de fibres plus fine, la résistance aux maladies, une maturité précoce et une faible photosensibilité a été menée pendant de nombreuses années au Bangladesh et en Inde et a donné plusieurs bons cultivars de Corchorus olitorius.
Perspectives
La corète potagère est un légume-feuilles de grande qualité pour sa valeur marchande, son attrait auprès des consommateurs et sa valeur nutritionnelle. Des semences fiables de cultivars améliorés devraient être disponibles dans le commerce. Il est recommandé que les cultivars locaux soient collectés et évalués pour des caractères utiles comme l’adaptation à différents environnements, la résistance aux maladies et le rendement. Il apparaît impossible pour l’Afrique d’entrer en compétition pour le jute sur les marchés d’exportation, lorsqu’on considère la situation excellente de la culture de jute au Bangladesh et en Inde.
Références principales
- Burkill, H.M., 2000. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 5, Families S–Z, Addenda. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 686 pp.
- Denton, L., 1997. A review of Corchorus olitorius L. in Nigeria. In: Schippers, R.R. & Budd, L. (Editors). Proceedings of a workshop on African indigenous vegetables, Limbe, Cameroon, 13–18 January 1997. Natural Resources Institute/IPGRI, Chatham, United Kingdom. pp. 25–30.
- Edmonds, J.M., 1990. Herbarium survey of African Corchorus L. species. Systematic and Ecogeographic Studies on Crop Genepools 4. IBPGR/IJO, Rome, Italy. 284 pp.
- FAO, 2011. FAOSTAT. [Internet] http://faostat.fao.org/ site/291/ default.aspx. October 2011.
- Franck, R.R. (Editor), 2005. Bast and other plant fibres. Woodhead Publishing, Cambridge, United Kingdom & CRC Press, Boca Raton, Florida, United States. 397 pp.
- Khandakar, A.L. & van der Vossen, H.A.M., 2003. Corchorus L. In: Brink, M. & Escobin, R.P. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 17. Fibre plants. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 106–114.
- Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968. Food composition table for use in Africa. FAO, Rome, Italy. 306 pp.
- Schippers, R.R., 2000. African indigenous vegetables. An overview of the cultivated species. Natural Resources Institute/ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, Chatham, United Kingdom. 214 pp.
- Stevels, J.M.C., 1990. Légumes traditionnels du Cameroun: une étude agrobotanique. Wageningen Agricultural University Papers 90–1. Wageningen Agricultural University, Wageningen, Netherlands. 262 pp.
- van Epenhuijsen, C.W., 1974. Growing native vegetables in Nigeria. FAO, Rome, Italy. 113 pp.
Autres références
- Akoroda, M.O., 1988. Cultivation of jute (Corchorus olitorius) for edible leaf in Nigeria. Tropical Agriculture 65(4): 297–299.
- Biagiotti, J., Puglia, D. & Kenny, J.M., 2004. A review on natural fibre-based composites – Part 1: structure, processing and properties of vegetable fibres. Journal of Natural Fibres 1(2): 37–68.
- Grubben, G.J.H., 1977. Tropical vegetables and their genetic resources. IBPGR, Rome, Italy. 197 pp.
- M’bah-Ngami, A.G., 1998. Coûts de production des légumes-feuilles laitue, amarante, corète potagère et morelle noire dans la zone périurbaine de la ville de Yaoundé. Student report, Deschang University, Cameroon.
- Mwaikambo, L.Y., 2006. Review of the history, properties and application of plant fibres. African Journal of Science and Technology, Science and Engineering Series 7(2): 120–133.
- Norman, J.C., 1992. Tropical vegetable crops. Arthur Stockwell, Elms Court, United Kingdom. 252 pp.
- Ohtani, K., Okai, K., Yamashita, U., Yuasa, I. & Misaki, A., 1995. Characterization of an acidic polysaccharide isolated from the leaves of Corchorus olitorius (Moroheiya). Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 59: 378–381.
- Peeler, C.H., 1967. Production of kenaf and other soft fibres in Kenya. East African Agricultural and Forestry Journal 33(2): 139–144.
- Purseglove, J.W., 1968. Tropical Crops. Dicotyledons. Longman, London, United Kingdom. 719 pp.
- Singh, D.P., 1976. Jute, Corchorus spp. Tiliaceae. In: Simmonds, N.W. (Editor). Evolution of crop plants. Longman, London, United Kingdom. pp. 290–291.
- van der Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976. Les légumes-feuilles spontanés et cultivés du Sud-Dahomey. Communication 65. Département des Recherches Agronomiques, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, Netherlands. 111 pp.
- Westphal, E., Embrechts, J., Ferwerda, J.D., van Gils-Meeus, H.A.E., Mutsaers, H.J.W. & Westphal-Stevels, J.M.C., 1985. Cultures vivrières tropicales avec référence spéciale au Cameroun. Pudoc, Wageningen, Netherlands. 514 pp.
Sources de l'illustration
- Bosser, J., 1987. Tiliacées. In: Bosser, J., Cadet, T., Guého, J. & Marais, W. (Editors). Flore des Mascareignes. Familles 51–62. The Sugar Industry Research Institute, Mauritius, l’Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, Paris, France & Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 14 pp.
Auteur(s)
- L. Fondio, CNRA/Programme Cultures Maraîchères et Protéagineuses, 01 B.P. 633, Bouaké 01, Côte d’Ivoire
- G.J.H. Grubben, Boeckweijdt Consult, Prins Hendriklaan 24, 1401 AT Bussum, Netherlands
Citation correcte de cet article
Fondio, L. & Grubben, G.J.H., 2011. Corchorus olitorius L. [Internet] Fiche de PROTA4U. Brink, M. & Achigan-Dako, E.G. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas.
Consulté le 18 décembre 2024.