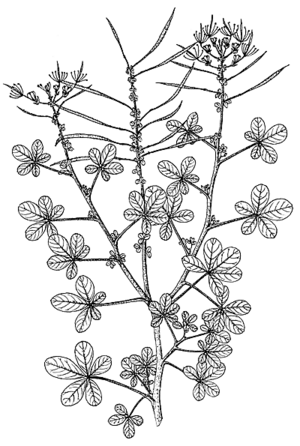Cleome gynandra (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Oléagineux | |
| Glucides / amidon | |
| Médicinal | |
| Ornemental | |
| Fourrage | |
| Sécurité alimentaire | |
- Protologue: Sp. pl. 2 : 671 (1753).
- Famille: Capparaceae (APG: Brassicaceae)
- Nombre de chromosomes: 2n = 30, 32, 34, 36
Synonymes
- Cleome pentaphylla L. (1763),
- Gynandropsis pentaphylla (L.) DC. (1824),
- Gynandropsis gynandra (L.) Briq. (1914).
Noms vernaculaires
- Caya blanc, brède caya, mouzambé (Fr).
- Spiderplant, cat’s whiskers, spider flower, bastard mustard (En).
- Musambe (Po).
- Mgagani, mkabili, mkabilishemsi, mwangani mgange (Sw).
Origine et répartition géographique
On ne connaît pas l’origine de Cleome gynandra. Pour certains, il serait originaire du sud de l’Asie, mais d’autres suggèrent qu’il est originaire d’Afrique ou d’Amérique centrale. On trouve Cleome gynandra dans toutes les régions tropicales et subtropicales. En Afrique, on le trouve principalement à proximité d’implantations humaines, probablement échappé d’anciennes introductions. Il est probablement présent dans tous les pays d’Afrique tropicale.
Usages
Les feuilles tendres, les jeunes pousses et parfois les fleurs sont consommées cuites à l’eau comme herbe potagère, comme condiment, en ragoût ou en accompagnement. On utilise les feuilles à l’état frais ou séchées en poudre. Les feuilles sont parfois amères, et sont alors bouillies avec du lait ou d’autres légumes-feuilles tels que les feuilles de niébé, l’amarante, les morelles (Solanum spp.) et Cleome monophylla L. Dans d’autres régions, les feuilles sont cuites à l’eau et l’eau de cuisson est jetée. Dans plusieurs pays, on ajoute de la pâte d’arachide broyée (beurre de cacahuète) pour en améliorer la saveur. Les feuilles peuvent être blanchies, façonnées en boulettes et séchées au soleil ou à l’air libre. C’est un produit apprécié en Afrique australe, pour lequel il y a un marché lorsqu’il est disponible pendant la saison des pluies. Les boulettes et la poudre de feuilles peuvent être conservées pendant près d’un an, et on les trempe dans l’eau avant de les utiliser en cuisine. Les graines peuvent être utilisées comme substitut de la moutarde.
Dans plusieurs communautés, les feuilles de caya blanc cuites à l’eau sont traditionnellement administrées aux mères avant et après l’accouchement, et de même dans d’autres situations où il y a eu perte de sang, ce qui est le cas des guerriers. Par ailleurs, on traite l’anémie avec une infusion de feuilles. Les feuilles et les graines ont des usages médicinaux comme rubéfiant et vésicant ainsi que pour traiter le rhumatisme, aussi bien à usage externe qu’interne. Une infusion de racines est utilisée comme médicament pour les douleurs de poitrine, les feuilles pour traiter la diarrhée. Lorsqu’on jette des graines de caya blanc dans l’eau, cela peut tuer les poissons qui flottent alors à la surface. Les glandes situées sur les tiges et les feuilles ont des propriétés répulsives vis-à-vis des insectes ; le chou et les espèces apparentées, cultivés en association avec le caya blanc, souffrent moins des larves de la teigne. De la même façon, en culture de haricot vert associée avec le caya blanc, les haricots sont moins affectés par les thrips des fleurs et ont ainsi une meilleure qualité pour l’exportation.
Les graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux. Les graines contiennent une huile comestible polyinsaturée, qui est extraite par simple pression et ne nécessite aucun raffinage. Le tourteau peut être utilisé comme aliment pour animaux.
Production et commerce international
En particulier en Afrique de l’Est et en Afrique australe, le caya blanc est vendu sur les marchés ruraux et urbains pendant la saison des pluies. Jusque-là, seules des quantités limitées ont été produites sous irrigation, mais la situation est apparemment en train de changer dans un certain nombre de pays, maintenant que des graines de cultivars améliorés sont commercialement disponibles. Dans les centres urbains, il est de plus en plus apprécié, et la demande dépasse souvent l’offre. Il existe un peu de commerce transfrontalier pour le produit séché, par ex. du Zimbabwe vers le Botswana. Aucune donnée statistique n’est disponible.
Propriétés
La composition de Cleome gynandra est la suivante par 100 g de partie comestible : eau 86,6 g (83,3–89,6), énergie 142 kJ (34 kcal), protéines 4,8 g, lipides 0,4 g, glucides 5,2 g, fibres 1,2 g, Ca 288 mg, P 111 mg, Fe 6,0 mg, acide ascorbique 13 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les graines contiennent des glucosinolates, la cléomine et la glucocapparine, ainsi qu’une huile volatile âcre comparable à l’huile de moutarde. L’huile essentielle est également présente dans les feuilles et est à l’origine de l’odeur et du goût du légume. Au Kenya, on a montré que Cleome gynandra possède des propriétés répulsives et acaricides sur les larves, les nymphes et les adultes des tiques Rhipicephalus appendiculatus et Amblyomma variegatum, ce qui indique un potentiel dans la lutte contre les tiques. Le carvacrol est un des principaux composés répulsifs de cette huile essentielle.
On rapporte également que le caya blanc aurait des activités anti-HIV et antibactérienne ; il inhiberait aussi la croissance du moustique Culex quinquefasciatus. La présence de glucosinolates, qui ont des propriétés irritantes au contact de la peau, explique l’utilisation du caya blanc contre les rhumatismes et comme contre-irritant en médecine traditionnelle.
Description
- Plante herbacée annuelle érigée jusqu’à 150 cm de haut, fortement ramifiée, avec une longue racine pivotante et quelques racines secondaires ; tige densément glanduleuse.
- Feuilles alternes, composées palmées à (3–)5(–7) folioles ; stipules absentes ; pétiole de 2–10 cm de long, glanduleux ; folioles presque sessiles, obovales à elliptiques ou lancéolées, de 2–10 cm × 1–4 cm, cunéiformes à la base, arrondies à obtuses, aiguës ou acuminées à l’apex, à bords finement dentés, légèrement à distinctement poilues.
- Inflorescence : grappe terminale jusqu’à 30 cm de long, munie de bractées.
- Fleurs bisexuées, blanches ou teintées de violet ; pédicelle de 1,5–2,5 cm de long ; sépales 4, libres, ovales à lancéolés, jusqu’à 8 mm de long ; pétales 4, elliptiques à obovales, jusqu’à 1,5 cm de long, pourvus d’un onglet ; androgynophore de 1–1,5 cm de long ; étamines 6, violettes ; ovaire supère, pédonculé, 2-loculaire.
- Fruit : longue capsule cylindrique, étroite, jusqu’à 12 cm × 1 cm, pédonculée et pourvue d’un bec, habituellement verte ou jaune, déhiscente depuis le bas par 2 valves, contenant de nombreuses graines.
- Graines subglobuleuses, de 1–1,5 mm de diamètre, grises à noires, irrégulièrement côtelées.
- Plantule à cotylédons oblongs ; premières feuilles 3-foliolées.
Autres données botaniques
Le genre Cleome comprend 150–200 espèces, dont environ 50 sont présentes en Afrique. Il est classé dans la sous-famille des Cleomoideae, qui est parfois considérée comme une famille séparée, les Cleomaceae. Gynandropsis a été fusionné avec Cleome, car le caractère distinctif, à savoir la connection de la base des étamines au gynophore pour former un androgynophore, n’est qu’un caractère quantitatif. Le caya blanc possède un androgynophore distinct avec des étamines et un ovaire qui dépassent largement la corolle, alors que les autres espèces africaines de Cleome utilisées comme légume n’ont pas ce type d’androgynophore.
Croissance et développement
Après le semis, les premières plantules lèvent au bout de 6–8 jours. La germination est cependant irrégulière, et s’étend sur une longue période. La dormance est fortement réduite 6 mois après que les graines aient séché, et au bout de 12 mois la plupart des graines germent facilement. La croissance initiale des semis est lente, en particulier lorsque les températures nocturnes sont basses. Un système racinaire profond est apparemment formé en premier, suivi ensuite par le développement foliaire. Le taux de croissance le plus élevé se situe 5–6 semaines après la germination. Les feuilles présentent de forts mouvements circadiens qui suivent la position du soleil. Ces mouvements sont plus forts à forte intensité lumineuse et température élevée. Comme les amarantes, le caya blanc possède un cycle en C4 avec une photosynthèse très efficace lorsque les températures, l’humidité du sol et la lumière lui sont favorables. La dominance apicale est habituellement faible, puisque les bourgeons axillaires commencent à s’ouvrir entre la seconde et la troisième semaine de croissance de la plante, mais cette caractéristique est très variable et certaines plantes ont peu de rameaux. Les plantes ont tendance à débuter leur floraison 4–6 semaines après la germination, habituellement lorsqu’elles font 60–90 cm de haut ; un stress peut déclencher la floraison même aux stades du semis. Les cueillettes régulières et la suppression des fleurs favorisent la croissance latérale, allongeant ainsi la période de récolte, qui sera de plus favorisée par un épandage superficiel d’engrais azoté et un bon apport d’eau. Après des récoltes répétées, la plante fleurit pendant une longue période jusqu’à la fin des pluies. Pendant la période reproductive, qui peut durer jusqu’à trois mois en conditions favorables, la croissance végétative décline et les feuilles deviennent vite sénescentes. Les fruits sèchent après quelques semaines et deviennent déhiscents pour libérer les graines sèches.
Cleome gynandra est à la fois auto- et allogame. Au Vénézuela, on a trouvé des populations ayant des fleurs soit mâles soit femelles. De telles populations n’ont pas été décrites en Afrique. Lors d’études menées au Zimbabwe en 2001, on a observé que certaines fleurs développaient d’abord des étamines, d’autres d’abord le pistil. On a découvert une population chez laquelle quelques plantes sont mâle-stériles, produisant des anthères courtes qui ne libèrent pas de pollen.
Ecologie
On trouve Cleome gynandra du niveau de la mer jusqu’à 2400 m d’altitude et il lui faut des conditions chaudes ; sa croissance est freinée en dessous de 15°C. Il est moins commun dans les régions à climat très humide. Il tolère un peu de sécheresse, mais le stress hydrique accélère sa maturation et sa sénescence. Il est insensible à la longueur du jour. On trouve le caya blanc sur une gamme de sols variée, le plus souvent sur du limon sableux à argileux, du moment qu’ils soient profonds et bien drainés avec un pH de 5,5–7,0. Il préfère des sols à forte teneur en matière organique et bonnes réserves minérales. Le caya blanc est une adventice des plantes cultivées dans des sols bien fertilisés.
Multiplication et plantation
Il y a environ 1250 graines par g. Traditionnellement, les nouvelles cultures de caya blanc s’établissent spontanément à partir d’ensemencements naturels. Ce système est progressivement remplacé par une véritable culture, où l’on sème les graines directement sur une planche de semis bien préparée soit à plat, soit sur billons ou sur planches. Les graines sont très petites et pour cette raison on les mélange à du sable sec selon un rapport de 1:10. Ce mélange est soit semé à la volée ou en sillons écartés de 30–60 cm. Le semis profond doit être évité car il gène la germination. Les plantules lèvent au bout de 4–8 jours. L’éclaircissage est effectué 3 semaines plus tard en vue de laisser 10–20 cm entre les plantes semées en sillons, ou 25–30 cm dans toutes les directions en cas de semis à la volée. On consomme généralement les plantes éliminées. Le repiquage n’est possible qu’à un stade très précoce car les jeunes plants ont une racine pivotante avec peu de racines latérales. On signale un repiquage à 30 cm en Côte d’Ivoire. Au Zimbabwe, l’élevage de plants en plateaux en plastique a donné des résultats encourageants.
Certains paysans, comme en Ouganda, sèment un mélange de graines de caya blanc avec de l’amarante et une espèce de morelle (Solanum) à la volée, puis récoltent d’abord l’espèce qui pousse le plus vite, ce qui laisse plus d’espace pour les autres, qui seront récoltées les semaines suivantes.
Gestion
Les plantes de caya blanc ne forment pas un couvert végétal dense, ce qui rend un désherbage nécessaire, en particulier pendant les 6 premières semaines. Des essais en Tanzanie et en Zambie ont montré que le niveau optimal d’azote sous forme de sulfate d’ammoniaque ou de nitrate d’ammoniaque calcique est de 120–130 kg/ha, mais on recommande aussi de plus fortes quantités. Après l’éclaircissage à 3–4 semaines, on peut épandre en surface jusqu’à 100 kg/ha de nitrate d’ammoniaque. Les apports d’azote retardent l’initiation de la floraison et assurent de ce fait une période de récolte plus longue. Les plantes doivent être semées à l’arrivée des pluies afin de garantir une humidité satisfaisante pendant la saison végétative. Dans les régions à pluviométrie limitée comme au Botswana et en Namibie, les paysans peuvent semer dans un sol sec avant les premières pluies. L’irrégularité habituelle de la germination fait qu’il reste assez de graines pour des pluies ultérieures si un long intervalle entre la première pluie et les suivantes tue les premiers semis. Un stress hydrique provoque une perte de rendement et de qualité ainsi qu’une sénescence anticipée. Le caya blanc peut aussi être produit pendant la saison sèche sous irrigation. Il a besoin de moins d’eau que la plupart des autres légumes conventionnels. Il ne tolère pas l’inondation.
Maladies et ravageurs
Les principales maladies fongiques sont l’oïdium (Sphaerotheca fuliginea, Oidiopsis taurica) et la cercosporiose (Cercospora uramensis). Le puceron du chou (Brevicoryne brassicae) est un ravageur important qui provoque une croissance rabougrie et un enroulement des feuilles et des bourgeons ; il transmet probablement des maladies virales. Ce puceron a récemment provoqué une perte totale de récolte en Tanzanie. Une punaise (Bagrada spp.) peut également affecter le caya blanc ; les attaques sont plus fréquentes pendant les périodes sèches, mais on peut lutter efficacement avec des insecticides. Le caya blanc peut être attaqué par de nombreux autres insectes, par ex. des pentatomidés (Acrosternum gramineum et Agonoselis nubilis) ainsi que les altises. Il est sensible aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.).
Les jeunes graines sont consommées par les tisserands. Les fruits peuvent également héberger des insectes qui consomment les jeunes graines. On trouve fréquemment des vers de la capsule à l’intérieur des fruits. Lorsque la plante est cultivée pour ses feuilles et ses graines, on peut envisager l’application d’insecticides lorsque la récolte des feuilles est terminée.
Récolte
Le caya blanc est traditionnellement récolté au début de la saison des pluies lorsque les légumes sont rares. En culture, les semis sont éclaircis lorsque les plantes atteignent une hauteur de 15 cm, ce qui constitue la première récolte. Lorsqu’un espace suffisant a été créé, la pousse terminale des plantes restantes est cueillie, ce qui permet à de nouvelles pousses latérales de se développer. Certains paysans ne cueillent que les feuilles tendres et les jeunes pousses alors que d’autres attendent que les pousses se développent et les récoltent lorsqu’elles font environ 25 cm de long. Cette récolte de repousses peut être renouvelée plusieurs fois. Pour la récolte des graines, la façon la plus simple est de collecter les fruits avant qu’ils soient entièrement mûrs et de les sécher en conditions contrôlées.
Rendement
On peut atteindre des rendements de feuilles cumulés de 30 t/ha par saison. Les rendements augmentent chaque semaine jusqu’à la 7e semaine de croissance environ, puis commencent à décliner. Vers la 10e semaine, les rendements ont diminué d’environ 90% et la récolte est arrêtée. L’amertume des feuilles augmente aussi avec l’âge. Une culture saine sur laquelle on a effectué deux ou trois cueillettes de pousses peut ensuite donner jusqu’à 500 kg de graines par ha.
Traitement après récolte
Les feuilles de caya blanc sont fragiles et se fanent rapidement lorsqu’elles sont exposées au soleil. Il est important de les maintenir au frais et de les asperger avec de l’eau pure. Les populations des zones rurales conservent une partie de la culture par séchage au soleil. Dans ce but, on laisse les feuilles se faner un peu avant de les blanchir et de les étendre pour le séchage. Au Botswana et en Namibie, les feuilles fraîches sont bouillies pendant 2 heures avec un peu de sel pour ôter l’amertume. On façonne des boulettes avec les feuilles bouillies, qui sont ensuite séchées au soleil. Ces boulettes peuvent être entreposées jusqu’à la prochaine saison des pluies. Le trempage des boulettes dans l’eau ravive les feuilles, après quoi elles peuvent être préparées pour un repas de la même façon que le produit frais. En Namibie, les feuilles transformées sont commercialisées sous forme de galettes “omuvanda”.
Ressources génétiques
Des études menées au Kenya et au Zimbabwe indiquent qu’il y a une variation significative parmi les populations de plantes pour de nombreux caractères. D’autres travaux sont nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure ces différences sont dues à des effets climatiques, de fertilité du sol ou des conditions de stress. On peut trouver des populations nettement différentes dans les régions côtières du Kenya et de la Tanzanie, avec des plantes relativement petites, très ramifiées et à fruits très foncés, presque noirs, droits et raides. Elles sont apparemment très différentes des plantes rencontrées ailleurs en Afrique, qui ont des fruits qui sont loin d’être raides et qui sont souvent verts ou jaunes à brun pâle. Des collections de ressources génétiques sont conservées au Botswana, au Kenya, en Namibie, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
Sélection
La plupart des paysans utilisent leurs propres sélections. Plusieurs producteurs de graines et instituts ont sélectionné à partir de ces variétés locales. La descendance de ces variétés s’avère plutôt variable même lorsqu’il y a eu auto-fécondation. L’AVRDC à Arusha (Tanzanie) possède des variétés à tige verte et à tige violette et leurs graines sont disponibles. De la même façon, la Zambia Seed Company a produit des graines pour les distribuer aux paysans. Au Kenya, un cultivar nommé ‘Saget’ est vendu dans les magasins grainiers et des variétés locales sont vendues sur les marchés ruraux. Il y a là clairement matière pour mener des recherches ultérieures. L’objectif de l’amélioration génétique est d’augmenter le rendement en feuilles, l’homogénéité de la plante, d’obtenir une phase végétative plus longue et une meilleure tolérance à la sécheresse. Le rendement en feuilles est fortement influencé par l’environnement et présente donc une faible héritabilité.
Perspectives
Le caya blanc est un légume fortement apprécié au sein de beaucoup de communautés en Afrique tropicale, avec un bon potentiel de développement. On sait encore peu de choses sur lui en matière d’amélioration génétique et d’agronomie. Ses propriétés médicinales et son utilisation comme répulsif contre les insectes et les tiques doivent être étudiés de plus près. L’huile des graines semble également avoir un potentiel.
Références principales
- Chayamarit, K., 1993. Cleome gynandra L. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 148–150.
- Chweya, J.A. & Mnzava, N.A., 1997. Cat’s whiskers. Cleome gynandra L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 11. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. 54 pp.
- Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968. Food composition table for use in Africa. FAO, Rome, Italy. 306 pp.
- Schippers, R.R., 2002. African indigenous vegetables, an overview of the cultivated species 2002. Revised edition on CD-ROM. National Resources International Limited, Aylesford, United Kingdom.
- Windadri, F.I., 2001. Cleome L. In: van Valkenburg, J.L.C.H. & Bunyapraphatsara, N. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 12(2): Medicinal and poisonous plants 2. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 167–171.
Autres références
- Abbiw, D.K., 1997. Traditional vegetables in Ghana. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 29–38.
- Chigumira Ngwerume, F., 2000. Survey of literature on mandate vegetable species of the SADC Plant Genetic Resources Centre, Lusaka Zambia, occurring in Zimbabwe. Regional Vegetable Crop Working Group Report, May 2000. pp. 98–99.
- Chigumira Ngwerume, F., Mvere, B. & Mhazo, M., 1998. Traditional vegetable improvement project agronomic trials. National workshop on traditional vegetables and underutilized crops/plants of Zimbabwe. Proceedings of a workshop held at Harare, Zimbabwe, September 17–18, 1998. 66 pp.
- Chweya, J.A., 1997. Genetic enhancement of indigenous vegetables in Kenya. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 86–95.
- Grubben, G.J.H., 1967. Rapport sur les cultures légumières de la Côte d’Ivoire. Mission FAO, Abidjan, Côte d’Ivoire. 81 pp.
- Kemei, J.K., Wataaru, R.K. & Seme, E.N., 1997. The role of the National Genebank of Kenya in the collecting, characterization and conservation of traditional vegetables. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 78–85.
- Kwapata, M.B. & Maliro, M.F., 1997. Indigenous vegetables in Malawi: Germplasm collecting and improvement of production practices. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 132–135.
- Madisa, M.E. & Tshamekang, M.E., 1997. Conservation and utilization of indigenous vegetables in Botswana. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 149–153.
- Malonza, M M., Dipeolu, O.O., Amoo, A.O. & Hassan, S.M., 1992. Laboratory and field observations on anti-tick properties of the plant Gynandropsis gynandra (L.) Briq. Veterinary Parasitology 42(1–2): 123–136.
- Mathenge, L., 1997. Nutritional value and utilization of indigenous vegetables in Kenya. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 76–77.
- Matlhare, T., Tsamekang, E., Taylor, F.W., Oagile, O. & Modise, D.M., 1999. The status of traditional leafy vegetables in Botswana. In: Chweya, J.A. & Eyzaguirre, P.B. (Editors): The biodiversity of traditional vegetables. IPGRI, Rome, Italy. pp. 7–22.
- Mingochi, D.S. & Luchen, S.W.S., 1997. Traditional vegetables in Zambia: genetic resources, cultivation and uses. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 136–141.
- Mirghani, K.A. & El Tahir, I.M., 1997. Indigenous vegetables of Sudan: production, utilization and conservation. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 117–121.
- Mnzava, N.A., 1997. Comparing nutritional values of exotic and indigenous vegetables. In: Schippers, R.R. & Budd, L. (Editors). Proceedings of a workshop on African indigenous vegetables, Limbe, Cameroon, 13–18 January 1997. Natural Resources Institute/IPGRI, Chatham, United Kingdom. pp. 70–75.
- Nkhoma, C.N., Mkamanga, G.Y. & Ruredzo, T.J., 1997. Conservation of traditional vegetable germplasm in the SADC region. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 122–127.
- Rubaihayo, E.B., 1997. Conservation and use of traditional vegetables in Uganda. In: Guarino, L. (Editor). Traditional African vegetables. Proceedings of the IPGRI international workshop on genetic resources of traditional vegetables in Africa: conservation and use, 29–31 August 1995, ICRAF, Nairobi, Kenya. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops 16. pp. 104–116.
Sources de l'illustration
- Chayamarit, K., 1993. Cleome gynandra L. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 148–150.
Auteur(s)
- N.A. Mnzava, Oleris Consultancy, P.O. Box 1371, Arusha, Tanzania
- F. Chigumira Ngwerume, Horticultural Research Centre, P.O. Box 810, Marondera, Zimbabwe
Consulté le 3 avril 2025.