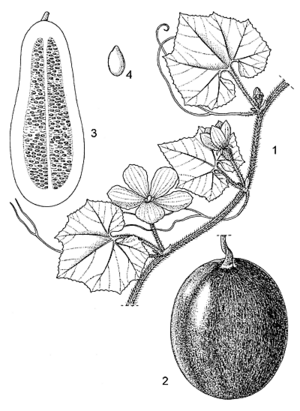Benincasa hispida (PROTA)
Introduction |
| Importance générale | |
| Répartition en Afrique | |
| Répartition mondiale | |
| Légume | |
| Médicinal | |
| Sécurité alimentaire | |
Benincasa hispida (Thunb. ex Murray) Cogn.
- Protologue: A.DC, Monogr. phan. 3 : 513 (1881).
- Famille: Cucurbitaceae
- Nombre de chromosomes: 2n = 24
Synonymes
- Cucurbita hispida Thunb. ex Murray (1784),
- Benincasa cerifera Savi (1818).
Noms vernaculaires
- Courge cireuse, bidao, courgette velue (Fr).
- Wax gourd, Chinese winter melon, white gourd, ash gourd, fuzzy melon (En).
- Abóbora d’água, comalenge (Po).
Origine et répartition géographique
La courge cireuse est une espèce cultivée probablement originaire d’Indochine. On ne la trouve pas à l’état sauvage et on ne lui connaît pas d’espèces apparentées. Elle est cultivée depuis l’antiquité en Chine méridionale, au Japon, ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est. A l’heure actuelle, la courge cireuse est très répandue en Asie tropicale et également très appréciée aux Caraïbes et aux Etats-Unis. En Afrique, c’est une culture légumière de faible importance, que l’on trouve essentiellement en Afrique orientale et australe. Jadis, elle fut cultivée à Madagascar et à l’Ile Maurice mais elle semble y avoir disparu complètement de nos jours.
Usages
La courge cireuse est cultivée à la fois pour ses fruits mûrs et immatures. Ces derniers, que nous appellerons en français “courgette velue”, ont un arôme et un goût délicats et sont préparés de la même façon que la courgette de Cucurbita pepo L. En Inde, on les emploie abondamment dans les currys. Les fruits mûrs quant à eux ont une chair juteuse, blanc verdâtre, au goût insipide. Ils sont très recherchés par les populations d’origine asiatique, mais sont aussi appréciés par de nombreux Africains. La peau est pelée ou raclée, les graines et la moelle sont retirées, et la pulpe est cuite pour en faire des soupes. En Chine, les fruits sont souvent farcis de viande, de crevettes et de légumes avant d’être cuits à la vapeur dans une cocotte. La chair ferme des vieux fruits est aussi confite au sucre et peut être séchée pour un usage ultérieur. De même, les jeunes pousses, les feuilles et les fleurs sont parfois consommées. Frites, les graines servent d’amuse-gueule. Autrefois, en Inde, la cire des fruits était raclée pour en faire des bougies. La courge cireuse est parfois utilisée comme porte-greffe du melon (Cucumis melo L.). Les fruits sont prisés pour leur vertus médicinales. En Inde et en Chine, ils sont utilisés comme vermifuge, antipériodique, aphrodisiaque, pour faire baisser la glycémie, contre l’épilepsie, l’aliénation mentale et autres maladies nerveuses, l’hémoptysie, l’hémorragie, comme diurétique, laxatif et tonique amer. Ils sont recommandés en médecine ayurvédique pour soigner les ulcères gastro-duodénaux. Les graines sont utilisées comme vermifuge.
Production et commerce international
La courge cireuse est une plante potagère relativement importante en Asie subtropicale et tropicale, et ses fruits immatures sont de plus en plus appréciés sur les marchés des villes. En Afrique, elle est cultivée de temps à autre à destination des marchés locaux et urbains ; dans les jardins péri-urbains davantage pour ses jeunes fruits, et dans les zones rurales pour les fruits mûrs. Aucune statistique n’est disponible.
Propriétés
La partie comestible de la courge cireuse représente environ 70% du poids total du fruit. La composition nutritionnelle des fruits mûrs de la courge cireuse par 100 g de partie comestible est la suivante : eau 96,1 g, énergie 54 kJ (13 kcal), protéines 0,4 g, lipides 0,2 g, glucides 3,0 g, fibres alimentaires 2,9 g, Ca 19 mg, Mg 10 mg, P 19 mg, Fe 0,4 mg, Zn 0,6 mg, absence de carotène, thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,11 mg, niacine 0,40 mg, folate 5 μg, acide ascorbique 13 mg (USDA, 2002). La teneur en micronutriments chez les jeunes fruits est probablement un peu plus élevée, en particulier en ce qui concerne l’acide ascorbique.
Des extraits de fruits de la courge cireuse ont montré une activité anti-ulcéreuse lors de tests sur la souris et le rat. Le jus de fruit a également montré une activité importante contre les symptômes de sevrage de morphine lors de tests sur la souris. Des inhibiteurs de libération de l’histamine ont été isolés des fruits de la courge cireuse ; les triterpènes alnusénol et multiflorénol se sont révélés être les inhibiteurs les plus actifs. Un activateur de l’immunité qui stimulait nettement la prolifération et la différenciation des cellules B murines a été isolé à partir des graines. Les fruits de la courge cireuse contiennent de la cucurbitacine B, connue pour avoir des propriétés cytotoxiques et anti-inflammatoires.
Falsifications et succédanés
En cuisine, la courge cireuse peut être remplacée par de jeunes fruits de courge bouteille (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.).
Description
- Plante herbacée annuelle habituellement monoïque, grimpante avec des vrilles 2–3-fides atteignant 35 cm de long ; tige atteignant 5 m de long, épaisse, cylindrique, avec des sillons longitudinaux, vert blanchâtre avec quelques poils rugueux épars.
- Feuilles alternes distiques, simples ; stipules absents ; pétioles de 5–20 cm de long ; limbe à contour largement ovale, de 10–25 cm × 10–20 cm, fortement cordé à la base, apex acuminé, bord à 5–11 angles ou lobes plus ou moins profonds et irréguliers, et irrégulièrement ondulé-crénelé ou denté, densément couvert de poils longs et étalés des deux côtés, à 5–7 nervures à partir de la base.
- Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, unisexuées, régulières, 5-mères, de 6–12 cm de diamètre ; calice campanulé, très soyeux ; pétales presque libres, jaunes ; fleurs mâles avec un pédicelle de 5–15 cm de long et 3 étamines ; fleurs femelles à pédicelle de 2–4 cm de long, ovaire infère, ovoïde ou cylindrique, très velu, et style court avec 3 stigmates recourbés.
- Fruit : baie ovoïde-oblongue, ellipsoïde ou globuleuse de 20–60(–200) cm × 10–25 cm, vert foncé à vert pâle moucheté ou glauque, hispide avant maturité, légèrement hispide ou subglabre à maturité, recouverte d’une couche de cire d’un blanc crayeux que l’on peut enlever facilement ; chair blanc verdâtre, juteuse, légèrement parfumée, spongieuse au milieu, renfermant de nombreuses graines.
- Graines ovales-elliptiques, aplaties, de 1–1,5 cm de long, jaune-brun, parfois fortement côtelées.
Autres données botaniques
Benincasa comprend une seule espèce. On en distingue de nombreux types, qui diffèrent les uns des autres surtout par la taille et la forme des fruits, la couleur, la pubescence et la quantité de cire. Une classification en 16 groupes de cultivars a été proposée, mais la distinction essentielle chez les cultivars améliorés réside entre les types adaptés à la récolte des jeunes fruits, le type “courgette velue”, et ceux cultivés pour les courges mûres, la véritable “courge cireuse”. En Inde, on utilise aussi bien les jeunes fruits que les mûrs de certains variétés locales.
Croissance et développement
La courge cireuse est très vigoureuse, mais nécessite une bonne période de 4–5 mois pour se développer. La floraison débute environ 45 jours après le semis pour les types précoces et jusqu’à 100 jours voire plus pour les tardifs. Les fleurs sont pollinisées par les insectes. Le sex-ratio est de 1 fleur femelle pour 20–33 fleurs mâles chez les types primitifs, mais les sélections modernes et les hybrides sont à prédominance femelle. La proportion de fleurs femelles par rapport aux fleurs mâles augmente quand les températures baissent et que les jours raccourcissent. Les jeunes fruits peuvent être récoltés 8 jours après l’anthèse ou plus tard, en fonction de la taille désirée par les consommateurs. Pour atteindre la pleine maturité, les fruits nécessitent 1–2 mois à partir de l’anthèse, et 50–72 jours chez les cultivars modernes améliorés. Une récolte régulière des jeunes fruits prolonge la floraison et la durée de la culture. Les fruits renferment 15–45 g de graines.
Ecologie
La courge cireuse convient bien à des zones modérément sèches sous les tropiques. Elle tolère relativement bien la sécheresse. Elle se développe bien à des températures supérieures à 25ºC, l’optimum pour sa croissance étant compris entre 23–28ºC (en moyenne sur 24 h). Elle est faite pour des conditions de basses terres tropicales et pour des altitudes allant jusqu’à 1000 m. Elle préfère les sols légers, bien drainés de pH 6,0–7,0.
Multiplication et plantation
Pour la production de fruits immatures, on pratique aussi bien le semis direct que le semis en pots suivi de repiquage, alors que seul le semis direct est utilisé pour la production de fruits mûrs. On sème directement dans des tranchées ou dans des trous de plantation remplis de fumier ou de compost. Lorsqu’elles sont palissées pour obtenir de jeunes fruits, les plantes sont espacées de 50–70 cm sur la ligne, les lignes étant distantes de 1,5–2,0 m les unes des autres, ce qui donne environ 10 000 plantes/ha, contre à peu près 5000 plantes/ha lorsqu’elles sont cultivées pour les fruits mûrs et qu’on laisse les tiges courir au sol. En culture intensive de fruits immatures, les besoins en graines sont de 400–500 g/ha en cas de repiquage et de 800–1000 g/ha pour le semis direct. Un gramme contient 12–25 graines. Les agriculteurs qui produisent des semences fermières utilisent en général jusqu’à 2 kg/ha. En Inde, les producteurs de courge cireuse pratiquent une densité de semis d’environ 5 kg/ha.
Gestion
La courge cireuse cultivée pour ses fruits mûrs est plantée à plat, tandis que le type “courgette velue” est cultivé en général à la verticale, par ex. sur des treillages. Elle nécessite un sol fertile et réagit bien à une grande quantité de matière organique, par ex. 30 t de fumure par ha. Un apport d’engrais NPK est recommandé avant le semis ainsi qu’un épandage d’engrais azoté entre les rangs à des intervalles réguliers jusqu’à la floraison. Une irrigation copieuse est nécessaire durant les périodes sèches. Pendant la saison des pluies, on peut empêcher les fruits des plantes coureuses de pourrir en les plaçant sur paille. La taille des pointes de tiges et des fleurs s’effectue parfois pour permettre une meilleure croissance des fruits.
Maladies et ravageurs
La courge cireuse est modérément sensible à l’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) et au chancre gommeux (Didymella bryoniae), pour laquelle aucune tolérance n’a encore été identifiée. Elle est aussi passablement sensible à la pourriture du fruit (Fusarium solani) et à la verticilliose (Verticillium dahliae), mais en revanche elle est plutôt résistante aux champignons des feuilles qui ravagent d’autres Cucurbitaceae tels que le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et l’oïdium (Erysiphe cichoracearum et Sphaerotheca fuliginea). Elle est sensible au virus de la mosaïque de la pastèque (WMV) transmis par les pucerons. Parmi les insectes ravageurs, on trouve le chrysomèle de la courge (Aulacophora foveicollis), les pucerons (Aphis gossypii) et les mouches des fruits (Dacus spp.). Toutefois, ces maladies et ravageurs ont rarement des effets assez graves pour justifier des pulvérisations de produits chimiques.
Les firmes semencières occidentales ont sélectionné des cultivars spéciaux de courge cireuse résistants aux maladies comme porte-greffe pour d’autres Cucurbitaceae (concombre, pastèque, melon) à cause de leur vigueur de croissance et de leur résistance au flétrissement dû au fusarium et aux nématodes à galles. C’est avec le melon que la courge cireuse se combine le mieux, mais dans la pratique, les producteurs lui préfèrent les porte-greffe provenant d’espèces de Cucurbita (des hybrides de Cucurbita moschata Duchesne et Cucurbita maxima Duchesne) et de la gourde (Lagenaria siceraria) car la courge cireuse est sensible à Phomopsis sclerotioides, qui provoque une nécrose des racines du melon et du concombre en culture protégée.
Récolte
Les fruits immatures sont récoltés d’une semaine sur l’autre lorsqu’ils atteignent entre 300–1000 g. Les fruits mûrs, eux sont ramassés entre 100–160 jours après le semis ; en fonction du cultivar, le poids des fruits récoltés oscille entre 3–40 kg, mais est en général d’environ 10 kg.
Rendement
Des rendements supérieurs à 30 t/ha pour de jeunes fruits récoltés entre 60–100 jours après le semis ont été signalés. En Inde, la courge cireuse à maturité produit environ 20 t/ha. Un rendement des semences de 100–150 kg/ha a été enregistré en Inde et de 200–300 kg/ha en Thaïlande.
Traitement après récolte
Les jeunes fruits sont assez périssables. En revanche, les fruits mûrs peuvent être emmagasinés plus d’un an s’ils sont conservés à 13–15°C et à une humidité relative de 75% grâce à la couche de cire qui les protège des micro-organismes.
Ressources génétiques
Avec la faveur croissante dont jouissent les cultivars améliorés en Asie, les cultivars locaux tendent à y disparaître. Il n’y a, à notre connaissance, aucune collection de ressources génétiques en Afrique, en revanche il en existe dans des instituts horticoles d’autres régions tropicales, essentiellement aux Philippines (Institute of Plant Breeding), en Inde (Kerala Agricultural University), en Russie (Institut Vavilov, Saint-Pétersbourg) et aux Etats-Unis (Southern Regional Plant Introduction Station, Georgie ; Cornell University, New York).
Sélection
Plusieurs firmes semencières en Inde, en Thaïlande, à Taïwan, en Chine et au Japon ont mené à bien un travail de sélection sur des cultivars locaux. Leurs critères de sélection sont la qualité des fruits, la présence de peu de graines, un fort rendement, la précocité et la résistance aux maladies. Des courges cireuses des deux types sont présentées dans les catalogues de semences. En Inde, en Thaïlande, à Taïwan, en Chine, au Japon et aux Etats-Unis, les firmes semencières offrent des cultivars améliorés de courgette velue. Plusieurs firmes dont la East West Seed Company ont mis au point des cultivars F1 vigoureux de courgette velue présentant un rendement et une qualité des fruits supérieurs comme ‘Pearl F1’, un cultivar vert pâle mi-tardif, qui peut être récolté 75 jours après le semis, et ‘Jade F1’, un cultivar précoce, récoltable 55 jours après le semis. Des cultivars de courge cireuse ont été créés à Coimbatore en Inde du Sud, par ex. ‘Co-2’, une sélection à petits fruits (3 kg) qui peut être récoltée 120 jours après le semis.
Perspectives
Bien qu’elle ait actuellement une importance négligeable en Afrique tropicale, la courge cireuse mérite toute notre attention en tant que légume peu exigeant adapté aux jardins familiaux et à la vente, et qui offre des fruits immatures ayant bon goût et des fruits mûrs dotés d’une excellente qualité de conservation.
Références principales
- Esquinas-Alcazar, J.T. & Gulick, P.J., 1983. Genetic resources of Cucurbitaceae. IBPGR, Rome, Italy. 101 pp.
- Larkcom, J., 1991. Oriental vegetables. The complete guide for garden and kitchen. John Murray, London, United Kingdom. 232 pp.
- Louvet, J., 1974. L’utilisation du greffage en culture maraichere. Pepinieristes, Horticulteurs, Maraichers 152: 13–16.
- National Academy of Sciences, 1975. Underexploited tropical plants with promising economic value. National Academy of Sciences, Washington D.C., United States. 188 pp.
- Rifai, M.A. & Reyes, M.E.C., 1993. Benincasa hispida (Thunberg ex Murray) Cogniaux. In: Siemonsma, J.S. & Kasem Piluek (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 8. Vegetables. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, Netherlands. pp. 95–97.
- Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997. Cucurbits. CAB International, Wallingford, United Kingdom. 226 pp.
- Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997. World vegetables: principles, production and nutritive values. 2nd Edition. Chapman & Hall, New York, United States. 843 pp.
- Sharma, B.R. & Tarsem Lal, 1998. Improvement and cultivation: Cucurbita and Benincasa. In: Nayar, N.M. & More, T.A. (Editors). Cucurbits. Science Publishers Inc., Enfield NH, United States. pp. 155–168.
- USDA, 2002. USDA nutrient database for standard reference, release 15. [Internet] U.S. Department of Agriculture, Beltsville Human Nutrition Research Center, Beltsville Md, United States. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp. June 2003.
- Walters, T.W. & Decker-Walters, D.S., 1989. Systematic re-evaluation of Benincasa hispida (Cucurbitaceae). Notes on economic plants. Economic Botany 43(2): 274–278.
Autres références
- Grover, J.K., Adiga, G., Vats, V. & Rathi, S.S., 2001. Extracts of Benincasa hispida prevent development of experimental ulcers. Journal of Ethnopharmacology 78(2–3): 159–164.
- Grover, J.K., Rathi, S.S. & Vats, V., 2000. Preliminary study of fresh juice of Benincasa hispida on morphine addiction in mice. Fitoterapia 71(6): 707–709.
- Mansfeld, R., 1986. Verzeichnis landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen). 2nd edition, revised by J. Schultze-Motel. 4 volumes. Springer Verlag, Berlin, Germany. 1998 pp.
- Yoshizumi, S., Murakami, T., Kadoya, M., Matsuda, H., Yamahara, J. & Yoshikawa, M., 1998. Medicinal foodstuffs. 11. Histamine release inhibitors from wax gourd, the fruits of Benincasa hispida Cogn. Yakugaku Zasshi 118(5): 188–192.
Sources de l'illustration
- Cogniaux, A. & Harms, H., 1924. Cucurbitaceae - Cucurbiteae - Cucumerinae. In: Engler, A. (Editor). Das Pflanzenreich IV.275.II. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, Germany. 246 pp.
- Ochse, J.J. & Bakhuizen van den Brink, R.C., 1980. Vegetables of the Dutch East Indies. 3rd English edition. Asher & Co., Amsterdam, Netherlands. 1016 pp.
Auteur(s)
- G.J.H. Grubben, Boeckweijdt Consult, Prins Hendriklaan 24, 1401 AT Bussum, Netherlands
Consulté le 31 mai 2025.